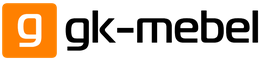Rubriques du site
Choix de l'éditeur :
- Six exemples d'une approche compétente de la déclinaison des chiffres
- Visage de l'hiver Citations poétiques pour les enfants
- Leçon de langue russe "Signe doux après le sifflement des noms"
- L'Arbre Généreux (parabole) Comment trouver une fin heureuse au conte de fées L'Arbre Généreux
- Plan de cours sur le monde qui nous entoure sur le thème « Quand viendra l'été ?
- Asie de l'Est : pays, population, langue, religion, histoire En tant qu'opposant aux théories pseudoscientifiques sur la division des races humaines en inférieures et supérieures, il a prouvé la vérité
- Classification des catégories d'aptitude au service militaire
- La malocclusion et l'armée La malocclusion n'est pas acceptée dans l'armée
- Pourquoi rêvez-vous d'une mère morte vivante: interprétations des livres de rêves
- Sous quels signes du zodiaque sont nées les personnes nées en avril ?
Publicité
| Cholokhov, le sort d'une personne, les principaux événements. Lecture en ligne du livre Le Destin d'un homme Le Destin d'un homme |
|
M.A. Sholokhov a écrit une histoire sur le sort d'un ancien prisonnier de guerre, sur la tragédie et la force de caractère d'un homme qui a subi les épreuves les plus difficiles. Pendant et immédiatement après le Grand Guerre patriotique les soldats revenant de captivité étaient considérés comme des traîtres, on ne leur faisait pas confiance et un contrôle approfondi a été effectué pour clarifier les circonstances. L'histoire "Le Destin de l'Homme" est devenue une œuvre qui permet de voir et de comprendre vérité brutale guerre. Le mot « destin » peut être interprété comme « histoire de vie » ou utilisé dans le sens de « destin, destin, coïncidence ». Dans l’histoire de Cholokhov, nous trouvons les deux, mais le héros s’est avéré n’être pas de ceux qui acceptent docilement le sort qui lui est destiné. L'auteur a montré à quel point les Russes se sont comportés avec dignité et courage en captivité. Rares étaient les traîtres qui « tremblaient pour leur propre peau ». D’ailleurs, ils se sont rendus volontairement à la première occasion. Le héros de l'histoire « Le destin de l'homme » a été blessé, choqué et fait prisonnier par les Allemands dans un état d'impuissance pendant la bataille. Dans le camp de prisonniers de guerre, Andreï Sokolov a enduré de nombreuses souffrances : brimades, passages à tabac, faim, mort de ses camarades, « tourments inhumains ». Par exemple, le commandant Müller, contournant la file de prisonniers, frappait une personne sur deux au nez avec son poing (ou plutôt avec un morceau de plomb placé dans un gant), "faisant du sang". C'était sa manière d'exprimer la supériorité aryenne, en soulignant l'insignifiance de la vie humaine pour les représentants de toutes les nations (contrairement aux Allemands). Andrei Sokolov a eu l'occasion de confronter personnellement Müller, et l'auteur a montré ce « duel » dans l'un des épisodes culminants de l'histoire. Dans le bureau de Müller, toutes les autorités du camp étaient assises autour de la table. Les Allemands célébraient une nouvelle victoire au front, buvaient du schnaps, grignotaient du saindoux et des conserves. Et Sokolov, quand il est entré, a failli vomir (le jeûne constant a eu un effet). Müller, clarifiant les paroles prononcées par Sokolov la veille, a promis qu'il l'honorerait et lui tirerait personnellement dessus. De plus, le commandant a décidé de faire preuve de générosité et a offert au soldat capturé une boisson et une collation avant sa mort. Andrei avait déjà pris un verre et une collation, mais le commandant a ajouté qu'il devait boire pour la victoire des Allemands. Cela a vraiment blessé Sokolov : « Pour que moi, un soldat russe, je boive des armes allemandes pour la victoire ?! » Andrei n'avait plus peur de la mort, alors il posa le verre et dit qu'il était abstinent. Et Müller, souriant, suggéra : « Si vous ne voulez pas boire à notre victoire, buvez à votre destruction. » Le soldat, qui n'avait rien à perdre, déclara hardiment qu'il boirait pour se débarrasser de son tourment. Il renversa le verre d'un seul coup et mit le snack de côté, même s'il mourait d'envie de manger. Quelle volonté avait cet homme ! Non seulement il ne s'est pas humilié pour une miette de saindoux ou un morceau de pain, mais il n'a pas non plus perdu sa dignité ni son sens de l'humour, ce qui lui a donné un sentiment de supériorité sur les Allemands. Il a suggéré que Müller se rende dans la cour, où l'Allemand le « signerait », c'est-à-dire signerait un arrêt de mort et lui tirerait dessus. Müller a autorisé Sokolov à prendre une collation, mais le soldat a déclaré qu'il n'avait pas pris de collation après la première. Et après le deuxième verre, il annonça qu'il ne prenait pas de collation. Lui-même l'a compris : il faisait preuve de ce courage non pas tant pour surprendre les Allemands que pour lui-même, afin qu'avant sa mort, il n'ait pas l'air d'un lâche. Par son comportement, Sokolov a fait rire les Allemands et le commandant lui a servi un troisième verre. Andreï a mordu comme à contrecœur ; Il voulait vraiment prouver qu’il était fier, « que les nazis ne l’avaient pas transformé en bête ». Les Allemands ont étonnamment apprécié la fierté, le courage et l'humour du soldat russe, et Muller lui a dit qu'il respectait les adversaires dignes et qu'il ne lui tirerait donc pas dessus. Pour son courage, Sokolov a reçu une miche de pain et un morceau de saindoux. Le soldat ne croyait pas vraiment à la générosité des nazis, attendait une balle dans le dos et regrettait de ne pas apporter la friandise tombée inopinément à ses compagnons de cellule affamés. Et encore une fois, le soldat ne pensait pas à lui-même, mais à ceux qui mouraient de faim. Il a réussi à apporter ces « cadeaux » aux prisonniers, et ils ont tout partagé à parts égales. Dans cet épisode, Cholokhov a soulevé homme ordinaire sur le piédestal d'un héros, malgré le fait qu'il soit prisonnier de guerre. Ce n’était pas la faute de Sokolov pendant sa captivité ; il n’allait pas abandonner. Et en captivité, il n'a pas rampé, n'a pas trahi les siens, n'a pas changé ses croyances. Il restait un citoyen dévoué de son pays et rêvait de reprendre ses fonctions pour lutter à nouveau contre les nazis. Cet incident de la vie d'un soldat s'est avéré décisif dans son sort : Sokolov aurait pu être abattu, mais il s'est sauvé, car il avait moins peur de la mort que de la honte. Il est donc resté en vie. Et le « surhomme » Muller a soudainement vu dans le soldat russe la fierté, le désir de préserver la dignité humaine, le courage et même le mépris de la mort, puisque le prisonnier ne voulait pas s'accrocher à vie au prix de l'humiliation et de la lâcheté. Ce fut l’une des victoires d’Andrei Sokolov dans les circonstances que le destin présentait. Quel genre de caractère faut-il avoir pour ne pas se soumettre aux circonstances ? Les habitudes d'Andrei, qui sont devenues des traits de caractère, étaient les plus courantes chez les gens de cette époque : travail acharné, générosité, persévérance, courage, capacité d'aimer les gens et la patrie, capacité de plaindre une personne, d'avoir de la compassion pour elle. . Et il était heureux de sa vie, car il avait une maison, un travail, ses enfants grandissaient et étudiaient. Seuls la vie et le sort des gens peuvent être facilement ruinés par des politiciens et des militaristes qui ont besoin de pouvoir, d’argent, de nouveaux territoires et de revenus. Une personne est-elle capable de survivre dans ce hachoir à viande ? Il s'avère que cela est parfois possible. Le sort fut impitoyable pour Sokolov : une bombe tomba sur sa maison à Voronej, tuant ses filles et sa femme. Dernier espoir pour l’avenir (rêves du mariage de son fils et de ses petits-enfants) qu’il perd à la toute fin de la guerre, lorsqu’il apprend la mort de son fils à Berlin. L'écrivain ne nous montre pas seulement les rebondissements du destin qui brisent ou renforcent une personne, Sholokhov explique pourquoi son héros agit de telle manière qu'il peut changer sa vie. Andrei Sokolov donne la chaleur de son cœur à ceux qui en ont besoin et exprime ainsi sa protestation contre le destin qui l'a condamné à la solitude. L'espoir et la volonté de vivre ont été restaurés. Il peut se dire : jetez vos faiblesses, arrêtez de vous apitoyer sur votre sort, devenez un protecteur et un soutien pour les plus faibles. C'est la particularité de l'image d'une personne avec fort caractère. Son héros s'est disputé avec le destin et a réussi à remodeler sa vie, en la dirigeant dans la bonne direction. L'écrivain Sholokhov n'a pas seulement parlé de la vie d'une personne en particulier, d'un citoyen Union soviétique Andreï Sokolov. Il a appelé son œuvre "Le destin de l'homme", soulignant ainsi que chaque personne, si elle est spirituellement riche et forte, comme son héros, est capable de résister à n'importe quelle épreuve, de créer un nouveau destin, nouvelle vie, où il aura un rôle digne. Apparemment, c'est le sens du titre de l'histoire. Avis M. Sholokhov - Grand écrivain russe, il n'y a pas de mots ! "Le destin de l'homme" en est un exemple frappant. Juste l'histoire d'un simple paysan russe, mais comme c'est écrit ! Et le film de S. Bondarchuk basé sur cette œuvre est également magnifique ! Comment il a joué Sokolov ! Cette scène où il boit de la vodka avec des verres taillés est tout simplement incomparable ! Et une rencontre avec un garçon sans abri l'a ramené à la vie, alors qu'il semblait que vivre plus longtemps ne servait à rien... Merci Zoya ! R.R. Menu des articles : La triste histoire de Mikhaïl Cholokhov « Le destin d’un homme » touche le cœur. Écrit par l'auteur en 1956, il révèle la vérité nue sur les atrocités de la Grande Guerre patriotique et ce qu'Andrei Sokolov, un soldat soviétique, a vécu en captivité allemande. Mais tout d’abord. Les personnages principaux de l'histoire :Andrei Sokolov est un soldat soviétique qui a connu beaucoup de chagrin pendant la Grande Guerre patriotique. Mais malgré l’adversité, même la captivité, où le héros a été brutalement maltraité par les nazis, il a survécu. Le sourire d'un orphelin adopté brillait comme un rayon de lumière dans l'obscurité du désespoir, lorsque le héros de l'histoire a perdu toute sa famille dans la guerre.
Irina, l'épouse d'Andrei : une femme douce et calme, une vraie épouse, aimer son mari, qui a su consoler et soutenir dans les moments difficiles. Quand Andrei est parti pour le front, j'étais très désespéré. Elle est morte avec ses deux enfants lorsqu'un obus a touché la maison. Rendez-vous au passage à niveauMikhaïl Cholokhov écrit son œuvre à la première personne. C'était le premier printemps d'après-guerre et le narrateur devait à tout prix se rendre à la gare de Bukanovskaya, située à soixante kilomètres. Nageant avec le conducteur de la voiture jusqu'à l'autre rive de la rivière appelée Epanka, il a commencé à attendre le chauffeur, parti depuis deux heures.
Le destin difficile d'AndreyQuel que soit le type de tourment qu'une personne endure au cours des terribles années de confrontation entre les nations.
La vie d'Andrei Sokolov avant la Grande Guerre patriotiqueDe violents problèmes sont arrivés au gars depuis sa jeunesse : ses parents et sa sœur sont morts de faim, de solitude, de la guerre dans l'Armée rouge. Mais dans cette période difficile, l’épouse intelligente d’Andrei, douce, calme et affectueuse, est devenue une joie pour Andrei. Et la vie semblait s'améliorer : un travail de chauffeur, de bons revenus, trois enfants intelligents qui étaient d'excellents élèves (ils ont même écrit sur l'aîné, Anatoly, dans le journal). Et enfin, maison confortable de deux pièces qu'ils ont construites avec l'argent qu'ils avaient économisé juste avant la guerre... Il est tombé subitement sur le sol soviétique et s'est avéré bien plus terrible que le précédent, civil. Et le bonheur d’Andrei Sokolov, atteint avec tant de difficulté, a été brisé en petits fragments.
Adieu à la familleAndrei est allé au front. Sa femme Irina et ses trois enfants l'ont accompagné en larmes. La femme avait le cœur particulièrement brisé : « Mon cher… Andryusha… nous ne nous reverrons plus… toi et moi… plus… dans ce… monde. Premières années au frontAu front, Andrei travaillait comme chauffeur. Deux blessures mineures ne pouvaient être comparées à ce qu'il dut subir plus tard, lorsque, grièvement blessé, il fut capturé par les nazis. CapturéQuel genre d'abus avez-vous dû subir de la part des Allemands en cours de route : ils vous ont frappé à la tête avec une crosse de fusil, et devant Andrei, ils ont tiré sur les blessés, puis ils ont conduit tout le monde dans l'église pour passer la nuit. je souffrirais encore plus personnage principal, s'il n'y avait pas eu parmi les prisonniers un médecin militaire qui a proposé son aide et a remis en place son bras luxé. Le soulagement fut immédiat. Prévenir la trahisonParmi les prisonniers se trouvait un homme qui projetait le lendemain matin, lorsqu'on lui demandait s'il y avait des commissaires, des juifs et des communistes parmi les prisonniers, de remettre son commandant de section aux Allemands. J'avais très peur pour ma vie. Andrei, ayant entendu la conversation à ce sujet, n'a pas été surpris et a étranglé le traître. Et par la suite, je ne l’ai pas regretté du tout. S'échapperDepuis sa captivité, l'idée d'une évasion vint de plus en plus à Andrei. Et donc je me suis présenté cas réel réaliser votre plan. Les prisonniers creusaient des tombes pour leurs propres morts et, voyant que les gardes étaient distraits, Andrei s'est enfui tranquillement. Malheureusement, la tentative n'a pas abouti : après quatre jours de recherche, il a été renvoyé, les chiens ont été relâchés, il a été longtemps torturé, il a été placé en cellule disciplinaire pendant un mois et, finalement, il a été envoyé en Allemagne. Dans un pays étrangerDire que la vie en Allemagne était terrible est un euphémisme. Andrei, le prisonnier numéro 331, était constamment battu, très mal nourri et forcé de travailler dur à la carrière de pierre. Et une fois, pour des paroles imprudentes prononcées par inadvertance dans la caserne sur les Allemands, il fut convoqué chez Herr Lagerführer. Cependant, Andrei n'avait pas peur : il a confirmé ce qui avait été dit plus tôt : « quatre mètres cubes de production, c'est beaucoup... » Ils voulaient d'abord l'abattre et ils auraient exécuté la sentence, mais, voyant le courage des Russes soldat qui n'avait pas peur de la mort, le commandant l'a respecté, a changé d'avis et l'a libéré de la caserne, tout en lui fournissant de la nourriture. Libération de captivitéAlors qu'il travaillait comme chauffeur pour les nazis (il conduisait un major allemand), Andrei Sokolov a commencé à réfléchir à une deuxième évasion, qui pourrait être plus réussie que la précédente. Et c’est ce qui s’est passé. Parmi leursFinalement, se retrouvant sur le territoire parmi les soldats soviétiques, Andrei put respirer tranquillement. Sa terre natale lui manquait tellement qu'il se laissa tomber sur elle et l'embrassa. Au début, ses propres gens ne l'ont pas reconnu, mais ils ont ensuite réalisé que ce n'était pas du tout Fritz qui s'était perdu, mais que son cher habitant de Voronej s'était échappé de captivité et avait même emporté des documents importants avec lui. Ils l'ont nourri, l'ont baigné dans les bains, lui ont donné un uniforme, mais le colonel a refusé sa demande de l'emmener dans l'unité de fusiliers : il était nécessaire de recevoir des soins médicaux. Terribles nouvellesAndrei s'est donc retrouvé à l'hôpital. Il était bien nourri, soigné et après Captivité allemande la vie pourrait sembler presque belle, sans un « mais ». L'âme du soldat aspirait à sa femme et à ses enfants, il a écrit une lettre à sa maison, a attendu de leurs nouvelles, mais toujours pas de réponse. Et tout à coup, une terrible nouvelle d'un voisin, un charpentier, Ivan Timofeevich. Il écrit que ni Irina ni sa plus jeune fille et son fils ne sont en vie. Leur hutte a été touchée par un obus lourd... Et après cela, l'aîné Anatoly s'est porté volontaire pour le front. Mon cœur se serra à cause d’une douleur brûlante. Après avoir quitté l'hôpital, Andrei a décidé de se rendre lui-même à l'endroit où se trouvait son maison. Le spectacle s'est avéré si déprimant - un cratère profond et des herbes jusqu'à la taille - que je n'ai pas pu ex-mari et le père de famille n’y reste pas une minute. J'ai demandé à retourner à la division. D'abord la joie, puis le chagrinParmi les ténèbres impénétrables du désespoir, une lueur d'espoir a jailli - le fils aîné d'Andrei Sokolov, Anatoly, a envoyé une lettre du front. Il s'avère qu'il est diplômé d'une école d'artillerie - et a déjà reçu le grade de capitaine, "commande une batterie de quarante-cinq personnes, possède six ordres et médailles..." Le nouveau fils de Sokolov est un garçon nommé VanyaC'était comme si quelque chose s'était brisé en Andreï. Et il n'aurait pas vécu du tout, mais simplement existé, s'il n'avait pas alors adopté un petit garçon de six ans, dont la mère et le père étaient tous deux morts à la guerre. Le célèbre ouvrage de Mikhaïl Cholokhov « Le destin d'un homme » nous raconte la vie d'un simple soldat russe. L'image d'Andrei Sokolov montre le sort de tout le peuple soviétique. La guerre qui s’est produite de manière inattendue pour tout le pays a détruit tous les rêves d’avenir de notre héros. Après avoir emmené parents et amis, ils n'ont pas permis à l'homme russe de se briser, grâce à sa forte volonté et sa ténacité de caractère. Après avoir rencontré le petit garçon Vanyusha, Sokolov s'est rendu compte qu'il y aurait encore des moments brillants et joyeux dans sa vie. L'histoire nous apprend à être courageux, à aimer et à défendre fermement notre patrie, quels que soient les coups que la vie vous lance. Il y aura toujours une personne qui vous donnera de l’amour, des soins et rendra votre vie heureuse. Récit détailléL'histoire raconte la vie difficile d'un homme - Sokolov, il a eu un destin difficile, mais il a fermement survécu à toutes les épreuves et a agi avec courage, a fait preuve de respect et d'attention envers les autres, même lorsqu'il a lui-même vécu une mauvaise période de sa vie. Le narrateur et Sokolov se sont rencontrés par hasard ; ils se sont levés et ont fumé pendant que Sokolov racontait sa vie. La première était qu’un inconnu lui avait tendu la main. La seconde - Sokolov a étranglé un homme qui voulait confier son commandant de peloton aux nazis. Troisièmement, les nazis ont tué un croyant qui ne voulait pas profaner l'église pour se soulager. Après que Sokolov ait décidé de s'échapper, le troisième jour, il a été arrêté et après avoir été placé en cellule disciplinaire, il a été envoyé en Allemagne. Une fois, Sokolov a failli être tué, mais a réussi à l'éviter. Sokolov a dit par malheur à la même personne que de petites tombes avaient été préparées pour eux. Cela a été entendu par Muller, le commandant du camp dans lequel se trouvait Sokolov. Le commandant du camp lui a ordonné de le boire pour sa propre mort, sans en prendre une bouchée (Sokolov a décidé de ne même pas prendre un morceau de pain, il était fasciste, même s'il voulait vraiment manger), en riant au nez du prisonnier, comme si humiliant sa position et montrant son plein pouvoir sur sa vie. Il but donc trois verres et le commandant, surpris par un homme aussi persistant, décida de ne pas tuer pour les paroles qu'il avait prononcées. Dans le camp de concentration, Sokolov était affamé, mais il a quand même pu survivre. Ensuite, Sokolov a de nouveau été envoyé comme chauffeur. Alors qu'il conduisait un autre major, il l'a assommé et a pris le pistolet, après quoi il a surmonté le poste et est retourné chez lui. Puis une mauvaise nouvelle l'attendait : il a perdu sa famille. Une nouvelle aussi amère a secoué Sokolova, mais pas pour longtemps. Il rassembla ses forces et décida de ne pas battre en retraite. Il réalise qu'il n'a plus rien à faire et part au front. Avant cela, j'ai regardé les restes de ma maison. Après un certain temps, Sokolov apprend que son fils Anatoly est vivant, qu'il a bien obtenu son diplôme universitaire et qu'il est allé au front (au front, il s'est bien distingué, a reçu de nombreuses récompenses et était un excellent combattant), et en 1945, il a été tué par un tireur isolé. Cette histoire enseigne que vous devez faire preuve d’humanité aux autres, quoi qu’il arrive. Sokolov, un paria, un « vrai Russe », qui a résisté au mal, était capable de regarder la peur dans les yeux. L’acte de Sokolov (quand il a accueilli le garçon) montre que les gens peuvent montrer de la sympathie pour les autres, se sentir désolés et aider. L'histoire vous apprend également à vous défendre et à maintenir l'honneur, c'est ainsi que Sokolov a défendu sa dignité lorsqu'il a bu jusqu'à sa mort, ce qui l'a aidé à s'échapper. Sokolov est un exemple de Russe qui a absorbé toutes les qualités des gens de cette époque, un indicateur que les gens ont encore de la gentillesse et du courage. Et une autre leçon vient de l’histoire selon laquelle vous devez vous battre de toutes vos forces pour votre vie, comme l’a fait Sokolov. N'ayez pas peur de l'ennemi ou de l'ennemi, mais regardez-le hardiment en face et attaquez. Après tout, il n’y a qu’une seule vie et il n’est pas nécessaire de la perdre sans combattre. Résumé Cholokhov Le sort de l'homme en chapitresAndreï SokolovAu tout début de l'histoire, nous voyons comment le narrateur monte en charrette avec un ami jusqu'au village de Bukanovskaya. L'action se déroule au début du printemps, alors que la neige commençait à peine à fondre et que la route s'avérait donc fatiguante. Au bout d'un moment, il doit traverser la rivière avec un chauffeur qui apparaît soudainement. Une fois de l’autre côté, le narrateur a dû attendre le chauffeur, qui lui a promis d’arriver dans 2 heures. Et peut-être que l'attente serait fatigante, mais soudain un homme avec un enfant s'approche du narrateur assis, qui deviendra le personnage principal de l'histoire. Andrei Sokolov, c'était son nom, prenant un inconnu pour le chauffeur, s'assoit à côté de lui et lui raconte sa vie. La vie de Sokolov avant la guerreLe personnage principal est né en 1900 dans la province de Voronej. A combattu dans l'Armée rouge. Lorsque la famine est arrivée dans le pays des Soviétiques, il est allé travailler comme ouvrier agricole, c'est pourquoi il a survécu. Après avoir enterré ses parents et sa sœur, il se rendit à Voronej, où il travailla comme charpentier et simple ouvrier dans une usine. Ayant rencontré son amour là-bas, il se maria bientôt. La femme qu'Andrey a rencontré était affectueuse, compréhensive, une vraie femme au foyer. Irina, c'était son nom, ne lui a jamais reproché d'avoir bu un verre supplémentaire ou un mot grossier. Plus tard, des enfants sont apparus dans la famille - deux filles et un fils. Et c'est alors que Sokolov a décidé d'arrêter de boire et de se mettre aux choses sérieuses. Il était surtout attiré par les voitures. Ainsi, il a commencé à travailler comme chauffeur. Une vie paisible et mesurée aurait continué ainsi sans l'attaque Allemagne fascisteà notre pays. Guerre et captivitéDire au revoir à sa famille était si difficile, comme si Sokolov pressentait qu'il ne verrait plus ses proches. Au front, il faisait également office de chauffeur. Il a été blessé deux fois. Mais la guerre ne s'est pas retirée de nos étendues natales et lui a présenté des épreuves difficiles. En 1942, lors d'une des offensives nazies, alors qu'il lançait des obus dans les tranchées, notre héros fut choqué. Ayant repris connaissance, il se rendit compte qu'il se trouvait derrière les lignes ennemies. Voulant mourir comme un vrai soldat russe, Sokolov se tenait devant les nazis, la tête haute. Ainsi, Andrei est capturé. Pendant tout le temps dont disposaient les Allemands, des événements assez importants se sont produits dans la vie de notre héros. Premièrement, se souvenant de l'honneur et de la dignité du soldat soviétique, il sauve le communiste et tue le traître. Là, un médecin militaire capturé pose le bras disloqué de Sokolov. Tous ces moments révèlent toutes sortes de comportements humains dans des circonstances désastreuses. Les épisodes où les nazis ont abattu un croyant qui avait demandé à aller aux toilettes toute la nuit et ont abattu plusieurs prisonniers de guerre m'ont fait penser à l'évasion. Une telle opportunité s’est présentée à lui. Quand tout le monde fut envoyé creuser des tombes, Andrei s'enfuit. Mais il n’était pas nécessaire d’aller bien loin. Le quatrième jour, il fut rattrapé par les Allemands. Cette fuite l’éloigne encore plus de son pays natal. Notre héros est envoyé travailler en Allemagne. Partout où il devait se rendre. Et Sokolov n'imaginait pas que seul le courage l'aidait à éviter la mort. L'un des épisodes les plus impressionnants est le séjour chez le Lagerführer Müller, qui nous montre le courage du soldat russe. En captivité, chacun a survécu du mieux qu’il a pu. Il y avait beaucoup de traîtres parmi nos soldats. Une phrase prononcée négligemment sur l'Allemagne a rapproché Andrei de la mort. Juste avant sa mort, les Allemands lui offrent à boire. Et Sokolov, faisant preuve de dignité et de courage russes, boit 3 verres de schnaps sans manger. Un tel acte suscite le respect d’un fanatique fasciste. Et non seulement il lui donne la vie, mais il lui donne aussi une miche de pain et un petit morceau de saindoux pour la caserne. La scène des interrogatoires a montré aux fascistes la résilience et le respect de soi de l’homme soviétique. Ce fut une bonne leçon pour les troupes allemandes. Libération de captivitéAprès un certain temps, ils ont commencé à faire confiance à notre héros et il a commencé à travailler comme chauffeur pour les Allemands. Au moment qui lui convient, le soldat s'enfuit, emmenant avec lui le major et un paquet de documents importants. Cette évasion aide Sokolov à se réhabiliter devant sa patrie. Après avoir été soigné à l'infirmerie, le militaire s'efforce de revoir rapidement sa famille, mais apprend que tous ses proches ont été tués lors des attentats à la bombe. Plus rien ne retenait Andreï. Il retourne au front pour venger la mort de sa femme et de ses enfants. Fils AnatolyLe bonheur et le chagrin résonnent tout au long de l'histoire. La bonne nouvelle concernant son fils aîné encourage Sokolov à de nouveaux exploits. Mais ces moments n’ont pas duré longtemps. Anatoly est tué le Jour de la Victoire contre les envahisseurs fascistes. L'après-guerreAprès les funérailles de son fils, laissé complètement seul, notre héros ne veut pas retourner dans son pays natal et se rend chez son ami, qui l'a longtemps invité chez lui à Uryupinsk. En arrivant chez lui, Andrei obtient un emploi de chauffeur avec un ami. Un jour, par pur hasard, il rencontre un garçon, orphelin. Ce petit garçon a tellement touché son cœur que, lui ayant donné toute sa chaleur et son amour, Sokolov l'adopte. C'est Vanyushka, avec sa pureté et sa franchise enfantines, qui aide à revenir à la vie et devient étoile directrice dans la triste vie du héros. Ce n'est pas un hasard si cette rencontre a lieu au début du printemps. Le soleil éclatant et les ruisseaux qui sonnent indiquent que l’apparence de Vanya a fait fondre le cœur du héros. Et la vie continue. Peut-être serait-il resté avec son fils adoptif à Uryupinsk s'il n'avait pas accidentellement renversé une vache. Andreï a été privé de son livre. Et prenant le garçon par la main, avec le meilleur espoir pour l'avenir, il se lance dans un long voyage vers la région de Kashar. En lisant les dernières lignes de l'ouvrage, on voit clairement comment, à propos de deux destins orphelins, l'auteur montre que, malgré les souffrances et les épreuves de la guerre, l'homme russe ne s'est pas brisé et, à travers son exemple dans l'image de Sokolov, aide les personnes qui ont également traversé des épreuves et du chagrin à renaître. Mais la vie continue. Et encore une fois, des maisons, des écoles, des hôpitaux sont construits, des usines fonctionnent. Les gens tombent amoureux et se marient. Et ils vivent pour le bien de la génération future, dans le cœur de laquelle règnent une chaleur et un amour sincères. Après tout, c’est en eux que résident notre force et notre pouvoir. Image ou dessin Le sort d'une personneAutres récits pour le journal du lecteur
Evgenia Grigorievna Levitskaya, membre du PCUS depuis 1903  Le premier printemps d'après-guerre sur le Haut-Don fut particulièrement amical et affirmé. Fin mars, des vents chauds soufflaient de la région d'Azov et, en deux jours, les sables de la rive gauche du Don étaient complètement exposés, les ravins et les ravins enneigés de la steppe se sont gonflés, brisant la glace, les rivières des steppes ont bondi. follement, et les routes sont devenues presque complètement impraticables. Pendant cette mauvaise période sans routes, j'ai dû me rendre au village de Bukanovskaya. Et la distance est petite - seulement une soixantaine de kilomètres - mais les surmonter n'a pas été si facile. Mon ami et moi sommes partis avant le lever du soleil. Deux chevaux bien nourris, tirant les lignes jusqu'à une ficelle, pouvaient à peine tirer la lourde chaise. Les roues s'enfonçaient jusqu'au moyeu dans le sable humide mêlé de neige et de glace, et une heure plus tard, sur les flancs et les fouets des chevaux, sous les fines ceintures des harnais, des flocons de savon blancs et moelleux apparaissaient, et dans la fraîcheur du matin Il y avait dans l'air une odeur âcre et enivrante de sueur de cheval et de goudron réchauffé, de harnais de cheval généreusement huilé. Là où c'était particulièrement difficile pour les chevaux, nous descendions de la chaise et marchions. La neige trempée coulait sous les bottes, il était difficile de marcher, mais le long des bords de la route, il y avait encore de la glace cristalline qui brillait au soleil, et il était encore plus difficile de passer par là. Seulement environ six heures plus tard, nous avons parcouru une distance de trente kilomètres et sommes arrivés au croisement de la rivière Elanka. Une petite rivière, asséchée par endroits en été, en face de la ferme Mokhovsky dans une plaine inondable marécageuse envahie d'aulnes, a débordé sur un kilomètre entier. Il fallait traverser sur une barque fragile qui ne pouvait transporter que trois personnes. Nous avons relâché les chevaux. De l'autre côté, dans la grange de la ferme collective, nous attendait une vieille « Jeep » usée, abandonnée là en hiver. Avec le chauffeur, nous sommes montés à bord du bateau délabré, non sans crainte. Le camarade est resté sur le rivage avec ses affaires. A peine avaient-ils mis les voiles que l'eau commença à jaillir en fontaines des fonds pourris en différents endroits. À l’aide de moyens improvisés, ils ont calfeutré le navire peu fiable et en ont retiré de l’eau jusqu’à ce qu’ils l’atteignent. Une heure plus tard nous étions de l’autre côté d’Elanka. Le conducteur a conduit la voiture depuis la ferme, s'est approché du bateau et a dit en prenant la rame : Si cette foutue auge ne s’effondre pas sur l’eau, nous arriverons dans deux heures, n’attendez pas plus tôt. La ferme était située très à l'écart, et près de la jetée régnait un tel silence qui n'arrive que dans les endroits déserts au plus fort de l'automne et au tout début du printemps. L'eau sentait l'humidité, l'amertume acidulée de l'aulne pourri, et des lointaines steppes de Khoper, noyées dans la brume lilas du brouillard, une légère brise portait l'arôme éternellement jeune et à peine perceptible de la terre récemment libérée de sous la neige. Non loin de là, sur le sable côtier, se trouvait une clôture effondrée. Je m'assis dessus, voulus allumer une cigarette, mais en mettant la main dans la poche droite de la couette en coton, à mon grand regret, je découvris que le paquet de Belomor était complètement trempé. Pendant la traversée, une vague a frappé le flanc d'un bateau à basse altitude et m'a aspergé d'eau boueuse jusqu'à la taille. Ensuite, je n'ai pas eu le temps de penser aux cigarettes, j'ai dû abandonner la rame et renflouer rapidement l'eau pour que le bateau ne coule pas, et maintenant, amèrement ennuyé de mon erreur, j'ai soigneusement sorti le sac détrempé de ma poche, s'accroupit et commença à l'étaler une à une sur la clôture des cigarettes humides et dorées. Il était midi. Le soleil brillait fort, comme en mai. J'espérais que les cigarettes sécheraient bientôt. Le soleil brillait si fort que je regrettais déjà d'avoir porté un pantalon militaire en coton et une veste matelassée pour le voyage. C'était la première journée vraiment chaude après l'hiver. C'était bien de s'asseoir ainsi sur la clôture, seul, se soumettant complètement au silence et à la solitude, et, enlevant les oreillettes du vieux soldat de sa tête, séchant ses cheveux mouillés après une lourde rame, dans la brise, regardant sans réfléchir le blanc aux gros seins nuages flottant dans le bleu fané. Bientôt, j'ai vu un homme sortir sur la route derrière les cours extérieures de la ferme. Il tenait par la main un petit garçon ; à en juger par sa taille, il n'avait pas plus de cinq ou six ans. Ils ont marché avec lassitude vers le passage à niveau, mais lorsqu'ils ont rattrapé la voiture, ils se sont tournés vers moi. Un homme grand et voûté, s'approchant, dit d'une voix basse sourde : Bonjour, frère ! Bonjour. - J'ai serré la grande main calleuse qui m'était tendue. L'homme se pencha vers le garçon et dit : Dis bonjour à ton oncle, mon fils. Apparemment, c'est le même conducteur que ton père. Seuls toi et moi conduisions un camion, et lui conduit cette petite voiture. Me regardant droit dans les yeux avec des yeux aussi brillants que le ciel, souriant légèrement, le garçon m'a hardiment tendu sa petite main rose et froide. Je la secouai légèrement et lui demandai : Pourquoi, mon vieux, ta main est-elle si froide ? Il fait chaud dehors, mais vous avez froid ? Avec une confiance enfantine touchante, le bébé s'est appuyé contre mes genoux et a haussé ses sourcils blanchâtres de surprise. Quel genre de vieil homme suis-je, mon oncle ? Je ne suis pas du tout un garçon et je ne gèle pas du tout, mais mes mains sont froides - parce que je faisais rouler des boules de neige. Enlevant le sac de sport fin de son dos et s'asseyant avec lassitude à côté de moi, mon père dit : J'ai des ennuis avec ce passager. C'est grâce à lui que je me suis impliqué. Dès que vous faites un grand pas, il se met à trotter, alors adaptez-vous à un tel fantassin. Là où je dois faire un pas, je fais trois pas, et ainsi nous marchons l'un de l'autre, comme un cheval et une tortue. Mais ici, il a besoin d'un œil et d'un œil. Vous vous détournez un peu et il erre déjà à travers la flaque d’eau ou casse une glace et la suce à la place d’un bonbon. Non, ce n’est pas une affaire d’homme de voyager avec de tels passagers, et ce à un rythme tranquille. « Il resta silencieux un moment, puis demanda : « Qu'est-ce que tu attends, frère, tes supérieurs ?  Il n'était pas pratique pour moi de le dissuader que je n'étais pas chauffeur, et j'ai répondu : Nous devons attendre. Viendront-ils de l’autre côté ? Vous ne savez pas si le bateau arrivera bientôt ? Dans deux heures. En ordre. Eh bien, pendant que nous nous reposons, je n'ai nulle part où me précipiter. Et je passe, je regarde : mon frère, le chauffeur, prend un bain de soleil. Laissez-moi, je pense, je vais entrer et fumer ensemble. On en a marre de fumer et de mourir. Et vous vivez richement et fumez des cigarettes. Les a-t-il endommagés, alors ? Eh bien, mon frère, le tabac trempé, comme un cheval traité, ne sert à rien. Fumons plutôt ma boisson forte. De la poche de son pantalon d'été protecteur, il sortit une pochette usée en soie framboise enroulée en tube, la déplia, et je parvins à lire l'inscription brodée sur le coin : « À un cher combattant d'un élève de 6e du secondaire de Lebedyansk École." Nous avons allumé une forte cigarette et sommes restés silencieux pendant un long moment. Je voulais lui demander où il allait avec l'enfant, quel besoin le poussait dans une telle confusion, mais il m'a devancé avec une question : Quoi, tu as passé toute la guerre au volant ? Presque tout. A l'avant ? Eh bien, là, j'ai dû, mon frère, prendre une gorgée d'amertume dans les narines et vers le haut. Il posa ses grandes mains sombres sur ses genoux et se pencha. Je l'ai regardé de côté et j'ai ressenti quelque chose de mal à l'aise... Avez-vous déjà vu des yeux, comme saupoudrés de cendres, remplis d'une mélancolie mortelle si inéluctable qu'il est difficile de les regarder ? C'étaient les yeux de mon interlocuteur aléatoire. Après avoir arraché une brindille sèche et tordue de la clôture, il la déplaça silencieusement sur le sable pendant une minute, dessinant quelques figures complexes, puis dit : Parfois tu ne dors pas la nuit, tu regardes dans l'obscurité les yeux vides et tu penses : « Pourquoi, la vie, tu m'as paralysé comme ça ? Pourquoi l’as-tu déformé comme ça ? Je n’ai pas de réponse, ni dans le noir, ni sous le soleil clair… Non, et j’ai hâte ! - Et soudain il reprit ses esprits : donnant doucement un coup de coude à son petit-fils, il dit : - Va, mon chéri, joue près de l'eau, il y a toujours une sorte de proie pour les enfants près de la grande eau. Faites juste attention à ne pas vous mouiller les pieds ! Pendant que nous fumions encore en silence, j'examinais furtivement mon père et mon petit-fils, remarquant avec surprise une circonstance qui me paraissait étrange : le garçon était habillé simplement, mais bien : et dans sa façon d'être assis, doublé d'un tapis. veste légère et usée à jupe longue, et le fait que les petites bottes ont été cousues avec l'intention de les mettre sur une chaussette en laine, et la couture très habile sur la manche autrefois déchirée de la veste - tout trahissait un soin féminin, habile mains maternelles. Mais le père avait un aspect différent : la doudoune, brûlée à plusieurs endroits, était raccommodée négligemment et grossièrement, l'écusson de son pantalon de protection usé n'était pas cousu correctement, mais plutôt cousu avec de larges points masculins ; il portait des bottes de soldat presque neuves, mais ses épaisses chaussettes de laine étaient rongées par les mites, elles n'avaient pas été touchées par la main d'une femme... Même alors, je pensais : « Soit il est veuf, soit il vit en désaccord avec sa femme. .» Mais ensuite, suivant son petit fils des yeux, il toussa sourdement, reprit la parole et je devins toute ouïe. Au début, ma vie était ordinaire. Je suis originaire de la province de Voronej, né en 1900. Pendant la guerre civile, il était dans l'Armée rouge, dans la division Kikvidze. Au cours de l’année affamée de vingt-deux ans, il se rendit au Kouban pour combattre les koulaks et c’est pourquoi il survécut. Et le père, la mère et la sœur sont morts de faim à la maison. Il n'en reste qu'un. Rodney - même si vous faites rouler une balle - nulle part, personne, pas une seule âme. Eh bien, un an plus tard, il revint du Kouban, vendit sa petite maison et partit pour Voronej. Au début, il a travaillé dans un artel de menuiserie, puis il est allé dans une usine et a appris le métier de mécanicien. Bientôt, il se maria. La femme a été élevée dans un orphelinat. Orphelin. J'ai une bonne fille ! Calme, joyeux, obséquieux et intelligent, aucun match pour moi. Depuis son enfance, elle a appris combien vaut une livre, cela a peut-être affecté son caractère. Vu de l’extérieur, elle n’était pas très distinguée, mais je ne la regardais pas de côté, mais à bout portant. Et pour moi, il n'y avait personne de plus belle et de plus désirable qu'elle, il n'y en avait pas au monde et il n'y en aura jamais ! Vous rentrez du travail fatigué et parfois en colère. Non, elle ne sera pas impolie avec vous en réponse à un mot grossier. Affectueux, calme, ne sait pas où vous asseoir, a du mal à vous préparer un morceau sucré même avec peu de revenus. Vous la regardez et vous vous éloignez avec votre cœur, et après un moment vous la serrez dans vos bras et lui dites : « Désolé, chère Irinka, j'ai été impoli avec toi. Vous voyez, mon travail ne va pas bien ces jours-ci. Et encore une fois, nous avons la paix, et j'ai l'esprit tranquille. Savez-vous, frère, ce que cela signifie pour le travail ? Le matin, je me lève, échevelé, je vais à l'usine, et tout travail entre mes mains bat son plein et fait du bruit ! C’est ce que signifie avoir une femme-amie intelligente. De temps en temps, après le jour de paie, je devais prendre un verre avec mes amis. Parfois, il vous arrivait de rentrer chez vous et de faire de tels bretzels avec vos pieds que, de l'extérieur, c'était probablement effrayant à regarder. La rue est trop petite pour vous, et même pour le coven, sans parler des ruelles. J'étais alors un homme en bonne santé et fort comme le diable, je pouvais boire beaucoup et je rentrais toujours à la maison tout seul. Mais il arrivait aussi parfois que la dernière étape se déroule en première vitesse, c'est-à-dire à quatre pattes, mais nous y sommes quand même arrivés. Et encore une fois, aucun reproche, aucun cri, aucun scandale. Mon Irinka se contente de rire, puis prudemment, pour ne pas m'offenser quand je suis ivre. Il m'enlève et me murmure : « Couche-toi contre le mur, Andryusha, sinon tu tomberas du lit en somnolent. Eh bien, je tomberai comme un sac d'avoine et tout flottera sous mes yeux. J'entends seulement dans mon sommeil qu'elle me caresse doucement la tête avec sa main et me murmure quelque chose d'affectueux, elle est désolée, ça veut dire... Le matin, elle me relèvera environ deux heures avant le travail pour que je puisse m'échauffer. Il sait que je ne mangerai rien quand j'ai la gueule de bois, eh bien, il prendra un concombre mariné ou quelque chose d'autre léger et se versera un verre de vodka coupé. "Ayez la gueule de bois, Andryusha, mais pas plus, ma chère." Mais est-il possible de ne pas justifier une telle confiance ? Je vais le boire, la remercier sans mots, avec juste mes yeux, l'embrasser et aller travailler comme une chérie. Et si elle m'avait dit un mot, ivre, crié ou maudit, et moi, comme Dieu, je me serais enivré le deuxième jour. Cela arrive dans d'autres familles où la femme est une idiote ; J'en ai assez vu de telles salopes, je sais. Bientôt, nos enfants sont partis. D'abord un petit fils est né, un an plus tard, deux autres filles... Puis je me suis séparé de mes camarades. Je ramène tout le salaire à la maison, la famille est devenue un nombre décent, il n'y a pas de temps pour boire. Le week-end, je bois un verre de bière et je termine ma journée. En 1929, j'étais attiré par les voitures. J'ai étudié le secteur automobile et je me suis assis au volant d'un camion. Puis je me suis impliqué et je n’ai plus voulu retourner à l’usine. Je pensais que c'était plus amusant au volant. Il a vécu ainsi pendant dix ans et n’a pas remarqué comment ils se passaient. Ils passèrent comme dans un rêve. Pourquoi dix ans ! Demandez à n’importe quelle personne âgée : a-t-elle remarqué comment elle vivait sa vie ? Il n'a rien remarqué ! Le passé est comme cette steppe lointaine dans la brume. Le matin, je l'ai longé, tout était clair tout autour, mais j'ai marché vingt kilomètres, et maintenant la steppe était couverte de brume, et d'ici on ne distingue plus la forêt des mauvaises herbes, les terres arables du coupe-herbe ... Pendant ces dix années, j'ai travaillé jour et nuit. Je gagnais beaucoup d'argent et nous ne vivions pas pire que les autres. Et les enfants étaient heureux : tous les trois étudiaient avec d'excellentes notes, et l'aîné, Anatoly, s'est avéré si capable en mathématiques qu'ils ont même écrit sur lui dans le journal central. D’où vient-il un tel talent pour cette science, moi-même, mon frère, je ne le sais pas. Mais c'était très flatteur pour moi, et j'étais fière de lui, si passionnément fière ! Pendant dix ans, nous avons économisé un peu d'argent et, avant la guerre, nous vous avons construit une maison avec deux pièces, un débarras et un couloir. Irina a acheté deux chèvres. De quoi avez-vous besoin de plus ? Les enfants mangent du porridge avec du lait, ont un toit, sont habillés, ont des chaussures, donc tout est en ordre. Je me suis juste aligné maladroitement. Ils m'ont donné un terrain de six acres non loin de l'usine aéronautique. Si ma cabane était dans un endroit différent, peut-être que la vie se serait déroulée différemment...  Et voilà, la guerre. Le deuxième jour, il y a une convocation du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, et le troisième, bienvenue dans le train. Mes quatre amis m'ont accompagné : Irina, Anatoly et mes filles Nastenka et Olyushka. Tous les gars se sont bien comportés. Eh bien, les filles, non sans cela, ont eu des larmes pétillantes. Anatoly a juste haussé les épaules comme à cause du froid, à ce moment-là il avait déjà dix-sept ans et Irina était à moi... Je ne l'avais jamais vue comme ça au cours de toutes les dix-sept années de notre vie ensemble. La nuit, la chemise sur mon épaule et ma poitrine n'a pas séché à cause de ses larmes, et le matin la même histoire... Nous sommes venus à la gare, mais je ne pouvais pas la regarder par pitié : mes lèvres étaient enflées à cause des larmes, mes cheveux étaient sortis de sous mon foulard, et mes yeux étaient troubles, dénués de sens, comme ceux d'une personne touchée par l'esprit. Les commandants ont annoncé le débarquement, et elle est tombée sur ma poitrine, a serré ses mains autour de mon cou et tremblait de partout, comme un arbre abattu... Et les enfants ont essayé de la persuader, et moi aussi - rien n'y fait ! D'autres femmes parlent à leurs maris et à leurs fils, mais le mien s'accrochait à moi comme une feuille à une branche, et ne faisait que trembler de partout, mais ne pouvait prononcer un mot. Je lui dis : « Ressaisis-toi, ma chère Irinka ! Dis-moi au moins un mot au revoir." Elle dit, et sanglote derrière chaque mot : « Mon cher... Andryusha... nous ne nous reverrons plus... dans ce... monde »... Ici, mon cœur se brise de pitié pour elle, et la voilà avec ces mots. J’aurais dû comprendre que ce n’était pas non plus facile pour moi de m’en séparer ; je n’allais pas manger des crêpes chez ma belle-mère. Le mal m'a amené ici ! J'ai séparé de force ses mains et je l'ai légèrement poussée sur les épaules. J'avais l'impression d'avoir poussé légèrement, mais j'avais la force ! était un imbécile; Elle a reculé, a reculé de trois pas et s'est de nouveau dirigée vers moi à petits pas en me tendant les mains, et je lui ai crié : « C'est vraiment comme ça qu'ils disent au revoir ? Pourquoi m'enterres-tu vivant à l'avance ?!" Bon, je l'ai encore serrée dans mes bras, je vois qu'elle n'est pas elle-même... Il a brusquement arrêté son histoire au milieu d'une phrase et, dans le silence qui a suivi, j'ai entendu quelque chose bouillonner et gargouiller dans sa gorge. L'excitation de quelqu'un d'autre m'a été transmise. J'ai regardé le narrateur de côté, mais je n'ai pas vu une seule larme dans ses yeux apparemment morts et éteints. Il était assis, la tête baissée avec tristesse, seules ses grandes mains mollement baissées tremblaient légèrement, son menton tremblait, ses lèvres dures tremblaient... Non, mon ami, je ne m'en souviens pas ! « J'ai dit doucement, mais il n'a probablement pas entendu mes paroles et, par un énorme effort de volonté, surmontant son excitation, il a soudainement dit d'une voix rauque et étrangement changée : Jusqu'à ma mort, jusqu'à ma dernière heure, je mourrai, et je ne me pardonnerai pas de l'avoir repoussée alors !.. Il resta silencieux pendant un long moment. J'ai essayé de rouler une cigarette, mais le papier journal s'est déchiré et le tabac est tombé sur mes genoux. Finalement, il fit d'une manière ou d'une autre une torsion, prit plusieurs bouffées gourmandes et, toussant, continua : Je me suis éloigné d'Irina, j'ai pris son visage dans mes mains, je l'ai embrassée et ses lèvres étaient comme de la glace. J'ai dit au revoir aux enfants, j'ai couru vers la voiture et, déjà en mouvement, j'ai sauté sur la marche. Le train démarra tranquillement ; Je devrais passer à côté de mon propre peuple. Je regarde, mes enfants orphelins sont blottis les uns contre les autres, ils me font des signes de la main, essayent de sourire, mais ça ne sort pas. Et Irina pressa ses mains contre sa poitrine ; ses lèvres sont blanches comme de la craie, elle murmure quelque chose avec elles, me regarde, ne cligne pas des yeux et elle se penche toute en avant, comme si elle voulait affronter un vent fort... C'est ainsi qu'elle est restée dans ma mémoire pendant tout ce temps. le reste de ma vie : ses mains pressées contre sa poitrine, ses lèvres blanches et ses yeux grands ouverts, pleins de larmes... La plupart du temps, c'est ainsi que je la vois toujours dans mes rêves... Pourquoi l'ai-je repoussée alors ? Je me souviens encore que mon cœur a l'impression d'être coupé avec un couteau émoussé... Nous avons été formés près de Bila Tserkva, en Ukraine. Ils m'ont donné un ZIS-5. Je l'ai monté vers l'avant. Eh bien, vous n'avez rien à raconter sur la guerre, vous l'avez vue vous-même et vous savez comment c'était au début. Je recevais souvent des lettres de mes amis, mais j'envoyais rarement moi-même des poissons-lions. Il arrivait que vous écriviez que tout allait bien, que nous nous battions petit à petit et que, bien que nous reculions maintenant, nous rassemblions bientôt nos forces et laissions ensuite la lumière aux Fritz. Que pourrais-tu écrire d’autre ? C’était une époque écoeurante ; il n’y avait pas de temps pour écrire. Et je dois admettre que je n'étais moi-même pas fan de jouer sur des cordes plaintives et que je ne supportais pas ces baveuses qui chaque jour, au point et pas au point, écrivaient à leurs femmes et à leurs amoureux, en étalant leur morve sur le papier . C’est dur, disent-ils, c’est dur pour lui, et à tout moment il sera tué. Et le voilà, une garce en pantalon, se plaignant, cherchant de la sympathie, baveux, mais il ne veut pas comprendre que ces malheureux femmes et enfants n'ont pas eu pire que les nôtres à l'arrière. L’État tout entier comptait sur eux ! Quel genre d'épaules nos femmes et nos enfants devaient-ils avoir pour ne pas plier sous un tel poids ? Mais ils ne se sont pas pliés, ils sont restés debout ! Et un tel fouet, une petite âme mouillée, écrira une lettre pitoyable - et une travailleuse sera comme un volant à ses pieds. Après cette lettre, c'est une misérable femme, elle va abandonner et le travail n'est pas son métier. Non! C'est pour ça que tu es un homme, c'est pour ça que tu es un soldat, pour tout endurer, pour tout endurer, s'il le faut. Et si vous avez plus un côté féminin que celui d'un homme, alors mettez une jupe froncée pour couvrir plus complètement vos fesses maigres, de sorte qu'au moins de derrière vous ressemblez à une femme, et que vous alliez désherber les betteraves ou traire les vaches, mais à l'avant tu n'es pas nécessaire comme ça, là ça pue beaucoup sans toi ! Mais je n'ai même pas eu à me battre pendant un an... J'ai été blessé deux fois pendant ce temps, mais les deux fois légèrement : une fois - dans la chair du bras, l'autre - dans la jambe ; la première fois - avec une balle d'avion, la seconde - avec un fragment d'obus. L'Allemand a fait des trous dans ma voiture sur le dessus et sur les côtés, mais mon frère, j'ai eu de la chance au début. J'ai eu de la chance et je suis arrivé jusqu'au bout... J'ai été capturé près de Lozovenki en mai 42 dans une situation très délicate : les Allemands avançaient alors fortement, et l'un de nos cent vingt-deux- les batteries d'obusiers millimétriques se sont révélées presque sans obus; Ils ont chargé ma voiture à ras bord d'obus et, pendant le chargement, j'ai moi-même travaillé si dur que ma tunique collait à mes omoplates. Il fallait se dépêcher car la bataille approchait : à gauche les chars de quelqu'un tonnaient, à droite il y avait des tirs, il y avait des tirs devant nous, et ça commençait déjà à sentir le frit... Notre commandant ! Le chef de l’entreprise demande : « Est-ce que vous réussirez, Sokolov ? Et il n'y avait rien à demander ici. Mes camarades sont peut-être en train de mourir là-bas, mais je serai malade ici ? « Quelle conversation ! - Je lui réponds. « Je dois m’en sortir et c’est tout ! « Eh bien, dit-il, soufflez ! Poussez tout le matériel ! » J'ai tout foiré. Je n’ai jamais conduit comme ça de ma vie ! Je savais que je ne transportais pas de pommes de terre, qu'avec ce chargement, il fallait être prudent en conduisant, mais comment pouvait-on être prudent quand il y avait des gars les mains vides qui se battaient, quand toute la route était traversée par des tirs d'artillerie. J'ai couru environ six kilomètres, bientôt j'ai dû tourner sur un chemin de terre pour arriver au ravin où se trouvait la batterie, puis j'ai regardé - sainte mère - notre infanterie se déversait à travers le champ ouvert à droite et à gauche de la niveleuse, et les mines explosaient déjà dans leurs formations. Que dois-je faire? Tu ne devrais pas faire demi-tour ? Je pousserai de toutes mes forces ! Et il ne restait qu'un kilomètre jusqu'à la batterie, j'avais déjà tourné sur un chemin de terre, mais je n'avais pas besoin de rejoindre mes gens, frérot... Apparemment, il en a placé une lourde près de la voiture pour moi d'un celui à longue portée. Je n’ai pas entendu d’éclat ou quoi que ce soit, c’était comme si quelque chose avait éclaté dans ma tête, et je ne me souviens de rien d’autre. Je ne comprends pas comment je suis resté en vie à ce moment-là, et je n’arrive pas à savoir combien de temps je suis resté allongé à environ huit mètres du fossé. Je me suis réveillé, mais je n'arrivais pas à me lever : ma tête tremblait, je tremblais de partout, comme si j'avais de la fièvre, il y avait de l'obscurité dans mes yeux, quelque chose craquait et craquait dans mon épaule gauche, et la douleur dans tout mon corps était la même que, disons, pendant deux jours d'affilée. Ils m'ont frappé avec tout ce qu'ils avaient. Pendant longtemps, j'ai rampé par terre sur le ventre, mais je me suis levé d'une manière ou d'une autre. Mais encore une fois, je ne comprends rien, où je suis et ce qui m’est arrivé. Ma mémoire a complètement disparu. Et j'ai peur de me recoucher. J'ai peur de m'allonger et de ne plus jamais me relever, de mourir. Je me lève et me balance d'un côté à l'autre, comme un peuplier dans la tempête. Quand j'ai repris mes esprits, j'ai repris mes esprits et j'ai bien regardé autour de moi - c'était comme si quelqu'un m'avait serré le cœur avec une pince : il y avait des obus qui traînaient, ceux que je portais, à proximité de ma voiture, tous mis en pièces, j'étais allongé la tête en bas, et la bataille, la bataille arrive déjà derrière moi... Comment ça ? Ce n’est pas un secret, c’est à ce moment-là que mes jambes ont cédé d’elles-mêmes, et je suis tombé comme si j’avais été abattu, car j’ai réalisé que j’étais prisonnier des nazis. C'est comme ça que ça se passe en temps de guerre... Oh, mon frère, ce n’est pas une chose facile de comprendre que tu n’es pas en captivité de ton plein gré. Quiconque n’a pas vécu cela sur sa propre peau ne pénétrera pas immédiatement dans son âme pour comprendre humainement ce que cela signifie. Eh bien, je suis allongé là et j'entends : les chars grondent. Quatre chars moyens allemands à plein régime m'ont dépassé là où j'étais parti avec les obus... Comment c'était de vivre cela ? Puis les tracteurs armés de canons se sont arrêtés, la cuisine de campagne est passée, puis l'infanterie est arrivée, pas trop, donc pas plus d'une compagnie battue. Je regarderai, je les regarderai du coin de l'œil et encore j'appuierai ma joue contre terre, je fermerai les yeux : j'en ai marre de les regarder, et mon cœur est malade...  J'ai cru que tout le monde était passé, j'ai levé la tête, et il y avait six mitrailleurs, ils étaient là, marchant à une centaine de mètres de moi. Je regarde, ils quittent la route et viennent droit vers moi. Ils marchent en silence. « Ici, je pense, ma mort approche. » Je me suis assis, réticent à m'allonger et à mourir, puis je me suis levé. L'un d'eux, à quelques pas de là, secoua l'épaule et ôta sa mitrailleuse. Et voilà à quel point une personne est drôle : je n'avais aucune panique, aucune timidité de cœur à ce moment-là. Je le regarde et je pense : « Maintenant, il va me tirer une courte rafale, mais où va-t-il frapper ? Dans la tête ou sur la poitrine ? Comme si cela ne m'importait pas, quelle place va-t-il coudre dans mon corps. Un jeune homme si beau, brun, avec des lèvres fines et filiformes et des yeux plissés. « Celui-ci va tuer et n’y réfléchirai pas à deux fois », me dis-je. C'est comme ça : il a levé sa mitrailleuse - je l'ai regardé droit dans les yeux, je suis resté silencieux, et l'autre, un caporal, peut-être plus âgé que lui en âge, on pourrait dire âgé, a crié quelque chose, l'a poussé de côté, s'est approché à moi, en babillant. Il plie aussi mon bras droit au niveau du coude, ce qui signifie qu'il sent le muscle. Il l’a essayé et a dit : « Oh-oh-oh ! » - et montre la route, le coucher du soleil. Stomp, petite bête de travail, travaille pour notre Reich. Le propriétaire s'est avéré être un fils de pute ! Mais le noir a regardé mes bottes de plus près, et elles avaient l'air bien, et il a fait un geste de la main : « Enlève-les. Je me suis assis par terre, j'ai enlevé mes bottes et je les lui ai tendues. Il les a littéralement arrachés de mes mains. J'ai déroulé les chaussons, je les lui ai tendus et j'ai levé les yeux vers lui. Mais il a crié, juré à sa manière et a de nouveau saisi la mitrailleuse. Les autres rient. Sur ce, ils sont repartis paisiblement. Seulement ce brun, au moment où il est arrivé sur la route, m'a regardé trois fois, ses yeux pétillaient comme un louveteau, il est en colère, mais quoi ? C'était comme si j'avais enlevé ses bottes, et non pas lui. Eh bien, mon frère, je n'avais nulle part où aller. Je suis sorti sur la route, maudit par une obscénité terrible et bouclée de Voronej et j'ai marché vers l'ouest, en captivité !.. Et puis j'étais un marcheur inutile, pas plus d'un kilomètre à l'heure. Vous voulez avancer, mais vous êtes bercé d'un côté à l'autre, conduit sur la route comme un ivrogne. Je marchai un peu, et une colonne de nos prisonniers, de la même division dans laquelle j'étais, me rattrapa. Ils sont pourchassés par une dizaine de mitrailleurs allemands. Celui qui marchait devant la colonne m'a rattrapé et, sans dire un gros mot, m'a donné un revers avec le manche de sa mitrailleuse et m'a frappé à la tête. Si j'étais tombé, il m'aurait plaqué au sol avec une rafale de feu, mais nos hommes m'ont rattrapé en fuite, m'ont poussé au milieu et m'ont retenu par les bras pendant une demi-heure. Et quand j'ai repris mes esprits, l'un d'eux a murmuré : « À Dieu ne plaise que vous tombiez ! Partez de toutes vos forces, sinon ils vous tueront. Et j'ai fait de mon mieux, mais j'y suis allé. Dès que le soleil s'est couché, les Allemands ont renforcé le convoi, ont lancé vingt autres mitrailleurs sur le camion et nous ont fait avancer dans une marche accélérée. Nos blessés graves n'ont pas pu suivre le reste et ont été abattus sur la route. Deux d’entre eux ont essayé de s’enfuir, mais ils n’ont pas tenu compte du fait que par une nuit de pleine lune, vous étiez dans un champ ouvert à perte de vue, et bien sûr, ils les ont également abattus. A minuit, nous arrivâmes dans un village à moitié incendié. Ils nous ont forcés à passer la nuit dans une église dont le dôme était brisé. Il n'y a pas un morceau de paille sur le sol en pierre, et nous sommes tous sans pardessus, vêtus seulement de tuniques et de pantalons, donc il n'y a rien à allonger. Certains d’entre eux ne portaient même pas de tunique, juste des maillots de corps en calicot. La plupart d’entre eux étaient des commandants subalternes. Ils portaient leurs tuniques de manière à ne pas pouvoir être distingués de la base. Et les artilleurs étaient sans tunique. Alors qu'ils travaillaient près des canons, dispersés, ils furent capturés. La nuit, il a plu si fort que nous avons tous été mouillés. Ici, le dôme a été détruit par un obus lourd ou une bombe lancée par un avion, et ici le toit a été complètement endommagé par des éclats d'obus, on ne pouvait même pas trouver d'endroit sec dans l'autel ; Nous avons donc flâné toute la nuit dans cette église, comme des moutons en manteau sombre. Au milieu de la nuit, j’entends quelqu’un me toucher la main et me demander : « Camarade, es-tu blessé ? Je lui réponds : « De quoi as-tu besoin, frère ? Il dit : « Je suis médecin militaire, je peux peut-être vous aider avec quelque chose ? Je lui ai plaint que mon épaule gauche craquait, était enflée et me faisait terriblement mal. Il dit fermement : « Enlevez votre tunique et votre maillot de corps. » J’ai enlevé tout ça de moi et il a commencé à sonder mon épaule avec ses doigts fins, à tel point que je n’ai pas vu la lumière. Je grince des dents et lui dis : « Vous êtes évidemment un vétérinaire, pas un médecin humain. Pourquoi appuies-tu si fort sur un point sensible, espèce d’homme sans cœur ? Et il sonde tout et répond avec colère : « C'est à vous de vous taire ! Moi aussi, il a commencé à parler. Attends, ça va faire encore plus mal maintenant. Oui, dès que ma main a été tirée, des étincelles rouges ont commencé à tomber de mes yeux. J'ai repris mes esprits et j'ai demandé : « Que fais-tu, malheureux fasciste ? Ma main est brisée en morceaux, et tu l’as secouée comme ça. Je l'ai entendu rire doucement et dire : « Je pensais que tu me frapperais avec ton droit, mais il s'avère que tu es un gars doux. Mais ta main n'était pas cassée, mais assommée, alors je l'ai remise à sa place. Eh bien, comment vas-tu maintenant, tu te sens mieux ? Et en fait, je sens en moi que la douleur s'en va quelque part. Je l'ai remercié sincèrement et il a continué à avancer dans l'obscurité en demandant doucement : « Y a-t-il des blessés ? C'est ce que veut dire un vrai médecin ! Il a accompli son grand travail en captivité et dans l’obscurité. Ce fut une nuit agitée. Ils ne nous ont laissé entrer que lorsqu'il y avait du vent, le gardien supérieur nous en avait prévenus même lorsqu'ils nous avaient rassemblés dans l'église par deux. Et comme par hasard, un de nos pèlerins a ressenti le besoin de sortir pour faire ses besoins. Il s'est renforcé et s'est renforcé, puis s'est mis à pleurer. « Je ne peux pas, dit-il, profaner le saint temple ! Je suis croyant, je suis chrétien ! Que dois-je faire, frères ? Et savez-vous quel genre de personnes nous sommes ? Certains rient, d’autres jurent, d’autres encore lui donnent toutes sortes de conseils amusants. Il nous a tous amusés, mais cette pagaille s'est très mal terminée : il a commencé à frapper à la porte et à demander à sortir. Eh bien, il a été interrogé : le fasciste a envoyé une longue file à travers la porte, sur toute la largeur de celle-ci, et a tué ce pèlerin ainsi que trois autres personnes, et en a grièvement blessé une le matin de sa mort ; Tué! Nous avons tout mis au même endroit, nous nous sommes assis, sommes devenus silencieux et réfléchis : le début n'a pas été très joyeux... Et un peu plus tard, nous avons commencé à parler à voix basse, en chuchotant : qui était d'où, de quelle région, comment ils ont été capturés ; dans l'obscurité, des camarades du même peloton ou des connaissances de la même compagnie sont devenus confus et ont commencé à s'interpeller lentement. Et j'entends une conversation si calme à côté de moi. L’un d’eux dit : « Si demain, avant de nous pousser plus loin, ils nous alignent et appellent les commissaires, les communistes et les juifs, alors, commandant de section, ne vous cachez pas ! Rien ne sortira de cette affaire. Pensez-vous que si vous enlevez votre tunique, vous pouvez passer pour un soldat ? Ça ne marchera pas ! Je n'ai pas l'intention de répondre à votre place. Je serai le premier à vous le signaler ! Je sais que vous êtes communiste et je m’ai encouragé à rejoindre le parti, alors soyez responsable de vos affaires. C'est ce que dit la personne la plus proche de moi, qui est assise à côté de moi, à gauche, et de l'autre côté de lui, la voix jeune de quelqu'un répond : « J'ai toujours soupçonné que toi, Kryjnev, tu étais une mauvaise personne. Surtout quand vous avez refusé d’adhérer au parti, invoquant votre analphabétisme. Mais je n'ai jamais pensé que tu pourrais devenir un traître. Après tout, vous êtes diplômé de l’école de sept ans ? Il répond paresseusement à son commandant de peloton : « Eh bien, j’ai obtenu mon diplôme, et alors ? Ils restèrent silencieux pendant un long moment, puis, se basant sur sa voix, le commandant du peloton dit doucement : « Ne me trahissez pas, camarade Kryjnev. Et il rit doucement. « Les camarades, dit-il, sont restés derrière la ligne de front, mais je ne suis pas votre camarade, et ne me le demandez pas, je vous le signalerai quand même. Votre propre chemise est plus proche de votre corps. Ils se sont tus et j’ai eu des frissons à cause d’une telle subversivité. « Non, je pense – je ne te laisserai pas, fils de pute, trahir ton commandant ! Tu ne quitteras pas cette église, mais ils te tireront dehors comme un salaud ! C'est juste un peu levé - je vois : à côté de moi, un gars au grand visage est allongé sur le dos, les mains derrière la tête, et assis à côté de lui en maillot de corps, serrant ses genoux, il est si maigre, un type au nez retroussé et très pâle. «Eh bien», je pense, «ce type ne sera pas capable de s'occuper d'un si gros hongre. Je vais devoir le terminer. Je l'ai touché avec ma main et lui ai demandé à voix basse : « Êtes-vous un chef de section ? Il ne répondit pas, il se contenta de hocher la tête. « Est-ce que celui-ci veut vous trahir ? - Je montre le type qui ment. Il hocha la tête en arrière. "Eh bien," dis-je, "tiens ses jambes pour qu'il ne donne pas de coups de pied !" Venez vivre ! - et je suis tombé sur ce type, et mes doigts se sont figés sur sa gorge. Il n'a même pas eu le temps de crier. Je l'ai tenu sous moi pendant quelques minutes et je me suis levé. Le traître est prêt, et sa langue est à son côté !  Avant cela, je ne me sentais pas bien après cela et j'avais vraiment envie de me laver les mains, comme si je n'étais pas une personne, mais une sorte de reptile rampant... Pour la première fois de ma vie, j'ai tué, puis le mien ... Mais quel genre de personne est-il ? Il est pire qu'un étranger, un traître. Je me suis levé et j’ai dit au commandant du peloton : « Sortons d’ici, camarade, l’église est magnifique. » Comme l'a dit Kryjnev, le matin, nous étions tous alignés près de l'église, entourés de mitrailleurs, et trois officiers SS ont commencé à sélectionner les personnes qui leur étaient nuisibles. Ils ont demandé qui étaient les communistes, les commandants, les commissaires, mais il n'y en avait pas. Il n’y avait même pas un salaud qui pouvait nous trahir, car près de la moitié d’entre nous étaient des communistes, il y avait des commandants et, bien sûr, il y avait des commissaires. Sur plus de deux cents personnes, quatre seulement ont été retirées. Un juif et trois soldats russes. Les Russes ont eu des ennuis parce que tous les trois étaient bruns et bouclés. Alors ils arrivent à cela et demandent : « Yude ? Il dit qu’il est russe, mais ils ne veulent pas l’écouter. "Sortez" - c'est tout. Vous voyez, quelle affaire, frère, dès le premier jour, j'ai prévu d'aller vers mon peuple. Mais je voulais absolument partir. Jusqu'à Poznan, où nous avons été placés dans un vrai camp, je n'ai jamais eu d'opportunité convenable. Et dans le camp de Poznan, un tel cas a été constaté : fin mai, ils nous ont envoyés dans les bois près du camp pour creuser des tombes pour nos propres prisonniers de guerre morts, puis beaucoup de nos frères mouraient de dysenterie ; Je creuse de l'argile de Poznan, je regarde autour de moi et j'ai remarqué que deux de nos gardes se sont assis pour prendre une collation et que le troisième somnolait au soleil. J'ai arrêté! pelle et est allé tranquillement derrière le buisson... Et puis - courez en vous tenant droit vers le lever du soleil... Apparemment, ils ne s’en sont pas rendu compte de sitôt, mes gardes. Mais où, si maigre, j'ai trouvé la force de marcher près de quarante kilomètres par jour - je ne sais pas. Mais mon rêve n'a rien donné : le quatrième jour, alors que j'étais déjà loin du foutu camp, ils m'ont rattrapé. Les chiens détecteurs ont suivi ma trace et m'ont trouvé dans l'avoine non coupée. À l'aube, j'avais peur de traverser un champ ouvert et la forêt était à au moins trois kilomètres, alors je me suis allongé dans l'avoine pour la journée. J'ai écrasé les grains dans mes paumes, je les ai mâchés un peu et je les ai versés dans mes poches en réserve, puis j'ai entendu un chien aboyer et une moto craquait... Mon cœur se serra, car les chiens se rapprochaient de plus en plus. Je me suis allongé à plat et je me suis couvert de mes mains pour qu’elles ne me rongent pas le visage. Eh bien, ils ont couru et en une minute ils m'ont enlevé tous mes haillons. Je suis restée dans ce que ma mère avait donné naissance. Ils m’ont roulé dans l’avoine comme ils voulaient, et à la fin un mâle s’est tenu sur ma poitrine avec ses pattes avant et a visé ma gorge, mais ne m’a pas encore touché. Les Allemands sont arrivés sur deux motos. Au début, ils m'ont battu librement, puis ils ont lancé les chiens sur moi, et seules ma peau et ma viande sont tombées en lambeaux. Nu, couvert de sang, ils l’ont amené au camp. J'ai passé un mois dans une cellule disciplinaire pour m'être évadé, mais toujours en vie... Je suis resté en vie !.. C’est difficile pour moi, frère, de me souvenir, et encore plus difficile de parler de ce que j’ai vécu en captivité. Comme vous vous souvenez des tourments inhumains que vous avez dû endurer là-bas en Allemagne, comme vous vous souvenez de tous les amis et camarades qui sont morts, torturés là-bas dans les camps, votre cœur n'est plus dans votre poitrine, mais dans votre gorge, et cela devient difficile respirer... Ils vous battent parce que vous êtes russe, parce que vous regardez toujours le monde, parce que vous travaillez pour eux, ces salopards. Ils vous battent également si vous regardez dans le mauvais sens, si vous marchez dans le mauvais sens ou si vous tournez dans le mauvais sens. Ils l'ont battu simplement, afin de le tuer un jour, afin qu'il s'étouffe avec son dernier sang et meure sous les coups. Il n’y avait probablement pas assez de poêles pour nous tous en Allemagne. Et ils nous ont nourris partout de la même manière : cent grammes et demi d'ersatz de pain, moitié-moitié avec de la sciure de bois et de la bouillie liquide de rutabaga. De l'eau bouillante - où ils l'ont donnée et où ils ne l'ont pas donnée. Que dire, jugez par vous-même : avant la guerre, je pesais quatre-vingt-six kilos, et à l'automne je ne pesais plus plus de cinquante. Seule la peau restait sur les os, et il leur était impossible de porter leurs propres os. Et donnez-moi du travail, et ne dites pas un mot, mais un tel travail que ce ne soit pas l'heure d'un cheval de trait. Début septembre, nous, cent quarante-deux prisonniers de guerre soviétiques, avons été transférés d'un camp près de la ville de Küstrin au camp B-14, non loin de Dresde. A cette époque, nous étions environ deux mille dans ce camp. Tout le monde travaillait dans une carrière de pierre, ciselant, coupant et émiettant manuellement la pierre allemande. La norme est de quatre mètres cubes par jour et par âme, remarquez, pour une telle âme, qui ne tenait déjà qu'à peine à un fil dans le corps. C’est là que tout a commencé : deux mois plus tard, sur les cent quarante-deux personnes de notre échelon, nous étions cinquante-sept. Comment ça, frérot ? Fameusement? Ici, vous n'avez pas le temps d'enterrer le vôtre, puis des rumeurs se sont répandues dans le camp selon lesquelles les Allemands avaient déjà pris Stalingrad et se dirigeaient vers la Sibérie. Un chagrin après l'autre, et ils vous plient tellement que vous ne pouvez pas lever les yeux du sol, comme si vous demandiez d'aller là-bas, dans un pays étranger, allemand. Et les gardes du camp boivent tous les jours, chantent des chansons, se réjouissent, se réjouissent. Et puis un soir, nous sommes rentrés du travail à la caserne. Il a plu toute la journée, c'était suffisant pour essorer nos haillons ; Nous étions tous glacés comme des chiens dans le vent froid, une dent ne toucherait pas une dent. Mais il n'y a nulle part où se sécher, se réchauffer - c'est la même chose, et en plus, ils ont non seulement faim, mais pire encore. Mais le soir, nous n’étions pas censés manger. J'ai enlevé mes chiffons mouillés, je les ai jetés sur la couchette et j'ai dit : « Ils ont besoin de quatre mètres cubes de production, mais pour la tombe de chacun de nous, un mètre cube par les yeux suffit. C'est tout ce que j'ai dit, mais un scélérat s'est trouvé parmi les siens et a rapporté au commandant du camp mes paroles amères. Notre commandant de camp, ou, selon leurs termes, Lagerführer, était l'Allemand Müller. Il était petit, trapu, blond et tout blanc : les cheveux sur sa tête étaient blancs, ses sourcils, ses cils, même ses yeux étaient blanchâtres et exorbités. Il parlait russe comme vous et moi, et s'appuyait même sur le « o » comme un natif de la Volga. Et il était un terrible maître dans l'art de jurer. Et où diable a-t-il appris ce métier ? Autrefois, il nous alignait devant le bloc - c'est ainsi qu'on appelait la caserne - il marchait devant la file avec sa meute de SS, en tenant sa main droite en vol. Il l'a dans un gant en cuir, et il y a un joint en plomb dans le gant pour ne pas s'abîmer les doigts. Il frappe une personne sur deux au nez, faisant couler du sang. Il a appelé cela « la prévention de la grippe ». Et ainsi chaque jour. Il n’y avait que quatre blocs dans le camp, et maintenant il donne la « prévention » au premier bloc, demain au deuxième, et ainsi de suite. C'était un sacré salopard, il travaillait sept jours sur sept. Il n'y avait qu'une chose que lui, imbécile, n'arrivait pas à comprendre : avant d'aller mettre la main sur lui, afin de s'enflammer, il jura pendant dix minutes devant la formation. Il jure en vain, et cela nous réconforte : c'est comme si nos paroles étaient les nôtres, naturelles, comme si le vent soufflait de notre côté natal... Si seulement il savait que ses jurons nous font grand plaisir, il ne jurerait pas en russe, mais uniquement dans votre propre langue. Un seul de mes amis moscovites était terriblement en colère contre lui. "Quand il jure", dit-il, "je ferme les yeux et c'est comme si j'étais assis dans un pub à Moscou, sur Zatsepa, et j'ai tellement envie de bière que même ma tête tourne."  Alors ce même commandant, le lendemain de mon discours sur les mètres cubes, m'appelle. Le soir, un traducteur et deux gardes viennent à la caserne. « Qui est Andreï Sokolov ? J'ai répondu. "Marchez derrière nous, vous demande Herr Lagerführer lui-même." Il est clair pourquoi il l’exige. En pulvérisation. J'ai dit au revoir à mes camarades, ils savaient tous que j'allais mourir, j'ai soupiré et je suis parti. Je marche dans la cour du camp, je regarde les étoiles, je leur dis au revoir et je pense : « Alors tu as souffert, Andrei Sokolov, et dans le camp - le numéro trois cent trente et un. D'une manière ou d'une autre, j'ai eu pitié d'Irinka et des enfants, puis cette tristesse s'est calmée et j'ai commencé à rassembler mon courage pour regarder sans crainte dans le trou du pistolet, comme il sied à un soldat, afin que les ennemis ne voient pas à ma dernière minute que je J'ai dû abandonner ma vie après tout, c'est difficile. Dans la chambre du commandant il y a des fleurs aux fenêtres, c'est propre, comme dans notre bon club. A la table se trouvent toutes les autorités du camp. Cinq personnes sont assises, buvant du schnaps et grignotant du saindoux. Sur la table, ils ont une énorme bouteille ouverte de schnaps, du pain, du saindoux, des pommes trempées, des bocaux ouverts contenant diverses conserves. J'ai immédiatement regardé toute cette bouffe et - vous ne le croirez pas - j'étais tellement malade que je ne pouvais pas vomir. J'ai faim comme un loup, je ne suis pas habitué à la nourriture humaine, et ici il y a tant de bonté devant vous... D'une manière ou d'une autre, j'ai réprimé la nausée, mais avec une grande force, j'ai arraché mes yeux de la table. Un Muller à moitié ivre est assis juste devant moi, jouant avec un pistolet, le lançant de main en main, et il me regarde et ne cligne pas des yeux, comme un serpent. Eh bien, mes mains sont à mes côtés, mes talons usés claquent et je déclare à haute voix : « Le prisonnier de guerre Andreï Sokolov, sur vos ordres, Herr Commandant, est apparu. » Il me demande : « Alors, Ivan le Russe, quatre mètres cubes de production, c'est beaucoup ? "C'est vrai", dis-je, "Herr Commandant, beaucoup." - "Est-ce qu'un seul suffit pour ta tombe ?" - "C'est vrai, Herr Commandant, c'est bien suffisant et cela restera même." Il s'est levé et a dit : « Je vous ferai un grand honneur, maintenant je vais personnellement vous tirer dessus pour ces mots. Ce n’est pas pratique ici, allons dans la cour et signons là-bas. «Votre volonté», lui dis-je. Il est resté là, a réfléchi, puis a jeté le pistolet sur la table et a versé un plein verre de schnaps, a pris un morceau de pain, a mis une tranche de bacon dessus et m'a tout donné et a dit : « Avant de mourir, Russe Ivan, bois à la victoire des armes allemandes. J'ai pris le verre et le snack de ses mains, mais dès que j'ai entendu ces mots, ce fut comme si j'étais brûlé par le feu ! Je me dis : « Pour que moi, soldat russe, je boive des armes allemandes pour la victoire ?! » Y a-t-il quelque chose que vous ne voulez pas, Herr Commandant ? Bon sang, je suis en train de mourir, alors tu iras au diable avec ta vodka ! J'ai posé le verre sur la table, posé le snack et dit : « Merci pour la friandise, mais je ne bois pas. Il sourit : « Voudriez-vous boire à notre victoire ? Dans ce cas, buvez jusqu’à la mort. Qu'avais-je à perdre ? «Je boirai jusqu'à ma mort et à la délivrance des tourments», lui dis-je. Sur ce, j'ai pris le verre et je l'ai versé en deux gorgées, mais je n'ai pas touché à l'apéritif, j'ai poliment essuyé mes lèvres avec ma paume et j'ai dit : « Merci pour la friandise. Je suis prêt, Herr Commandant, venez me signer. Mais il regarde attentivement et dit : « Au moins, mange une bouchée avant de mourir. » Je lui réponds : « Je ne prends pas de collation après le premier verre. » Il en verse un deuxième et me le donne. J'ai bu le deuxième et encore une fois je ne touche pas au snack, j'essaie d'être courageux, je pense : "Au moins, je vais me saouler avant de sortir dans la cour et de donner ma vie." Le commandant haussa ses sourcils blancs et demanda : « Pourquoi ne prends-tu pas une collation, Ivan le Russe ? Ne soyez pas timide ! Et je lui ai dit : « Désolé, Herr Commandant, je n’ai pas l’habitude de grignoter même après le deuxième verre. » Il a gonflé ses joues, a reniflé, puis a éclaté de rire et, à travers son rire, il a dit rapidement quelque chose en allemand : apparemment, il traduisait mes paroles à ses amis. Ils riaient aussi, bougeaient leurs chaises, tournaient leur visage vers moi et, j'ai remarqué, ils me regardaient d'une manière ou d'une autre différemment, apparemment plus doux. Le commandant me sert un troisième verre et ses mains tremblent de rire. J'ai bu ce verre, j'ai pris une petite bouchée de pain et j'ai posé le reste sur la table. Je voulais leur montrer, les damnés, que même si je mourais de faim, je n'allais pas m'étouffer avec leurs aumônes, que j'avais ma dignité et ma fierté russes, et qu'ils ne m'avaient pas transformé en bête, peu importe à quel point ils ont essayé. Après cela, le commandant devint sérieux, redressa deux croix de fer sur sa poitrine, sortit de derrière la table sans arme et dit : « C'est quoi, Sokolov, tu es un vrai soldat russe. Vous êtes un brave soldat. Je suis aussi un soldat et je respecte les adversaires dignes. Je ne te tirerai pas dessus. De plus, aujourd'hui, nos vaillantes troupes ont atteint la Volga et ont complètement capturé Stalingrad. C'est une grande joie pour nous, c'est pourquoi je vous donne généreusement la vie. Va dans ton bloc, et ceci est pour ton courage, » et de la table il me tend une petite miche de pain et un morceau de saindoux. J'ai pressé le pain contre moi de toutes mes forces, je tenais le saindoux dans ma main gauche, et j'étais tellement confus par un virage si inattendu que je n'ai même pas dit merci, je me suis retourné vers la gauche, je' Je vais vers la sortie, et j'ai moi-même pensé : « Il va briller entre mes omoplates maintenant, et je n'apporterai pas cette bouffe aux gars. Non, ça a marché. Et cette fois, la mort m'a échappé, seul un frisson en est sorti... Je quittai le bureau du commandant d'un pied ferme, mais dans la cour je fus emporté. Il est tombé dans la caserne et est tombé sur le sol en ciment sans aucun souvenir. Nos gars m'ont réveillé dans le noir : "Dis-moi !" Eh bien, je me suis souvenu de ce qui s'était passé dans la chambre du commandant et je leur ai raconté. « Comment allons-nous partager la nourriture ? » - demande mon voisin de couchette, et sa voix tremble. « Part égale pour tout le monde », lui dis-je. Nous avons attendu l'aube. Le pain et le saindoux étaient coupés avec un fil dur. Tout le monde a reçu un morceau de pain avec boîte d'allumettes, chaque miette a été prise en compte, enfin, et le saindoux, vous savez, juste pour oindre vos lèvres. Cependant, ils ont partagé sans offense. Bientôt, nous avons été transférés, environ trois cents hommes parmi les plus forts, pour assécher les marais, puis dans la région de la Ruhr pour travailler dans les mines. J'y restai jusqu'en l'an quarante-quatre. À cette époque, la nôtre avait déjà tourné la pommette de l’Allemagne et les nazis avaient cessé de mépriser les prisonniers. D’une manière ou d’une autre, ils nous ont alignés pendant toute la journée, et un lieutenant en chef en visite a dit par l’intermédiaire d’un interprète : « Celui qui a servi dans l’armée ou travaillé comme chauffeur avant la guerre est un pas en avant. » Sept d'entre nous, l'ancien chauffeur, sont intervenus. Ils nous ont donné des combinaisons usées et nous ont envoyés sous escorte jusqu'à la ville de Potsdam. Ils sont arrivés là-bas et nous ont tous secoués. J'ai été affecté à Todt - les Allemands avaient un tel bureau sharashka pour la construction de routes et de structures défensives. J'ai conduit un ingénieur allemand ayant le grade de major de l'armée dans l'Oppel Admiral. Oh, et c'était un gros fasciste ! Petite, ventrue, de même largeur et longueur, et large d'épaules dans le dos, comme une bonne femme. Devant lui, trois mentons pendent au-dessus du col de son uniforme, et trois plis épais sur la nuque. Comme je l’ai déterminé, il y avait au moins trois livres de graisse pure. Il marche, souffle comme une locomotive à vapeur et s'assoit pour manger - tenez bon ! Il mâchait et sirotait du cognac dans une fiole toute la journée. Parfois, il me donnait quelque chose à faire : m'arrêter sur la route, couper des saucisses, du fromage, prendre une collation et boire ; quand il est de bonne humeur, il m’en jette un morceau, comme un chien. Je ne l'ai jamais donné à personne, non, je le considérais comme faible pour moi. Mais quoi qu’il en soit, il n’y a pas de comparaison avec le camp, et petit à petit j’ai commencé à ressembler à une personne, petit à petit, mais j’ai commencé à aller mieux. Pendant deux semaines, j'ai conduit mon major de Potsdam à Berlin et retour, puis ils l'ont envoyé sur la ligne de front pour la construction lignes défensives contre le nôtre. Et puis j'ai finalement oublié comment dormir : toute la nuit, j'ai pensé à la façon dont je pourrais m'échapper vers mon peuple, vers ma patrie. Nous sommes arrivés dans la ville de Polotsk. A l'aube, pour la première fois depuis deux ans, j'ai entendu notre artillerie tonner, et sais-tu, frère, comment mon cœur s'est mis à battre ? L'homme célibataire sortait toujours avec Irina, et même alors, ça n'a pas frappé comme ça ! Les combats se déroulaient déjà à environ dix-huit kilomètres à l'est de Polotsk. Les Allemands de la ville sont devenus en colère et nerveux, et mon gros homme a commencé à s'enivrer de plus en plus souvent. Pendant la journée, nous sortons de la ville avec lui, et il décide comment construire des fortifications, et la nuit, il boit seul. Tout enflé, des poches qui pendent sous les yeux... "Eh bien", je pense, "il n'y a plus rien à attendre, mon heure est venue !" Et je ne devrais pas m’enfuir seul, mais emmène mon gros bonhomme avec moi, il sera bon pour le nôtre ! J'ai trouvé un poids de deux kilogrammes dans les ruines, je l'ai enveloppé dans un chiffon de nettoyage, au cas où je devrais le frapper pour qu'il n'y ait pas de sang, j'ai ramassé un morceau de fil téléphonique sur la route, j'ai préparé avec diligence tout ce dont j'avais besoin, et je l'ai enterré sous le siège avant. Deux jours avant de dire au revoir aux Allemands, le soir, alors que je venais d'une station-service, j'ai vu un sous-officier allemand marcher, ivre comme de la terre, se tenant au mur avec ses mains. J'ai arrêté la voiture, je l'ai conduit dans les ruines, je l'ai secoué pour lui enlever son uniforme et j'ai enlevé sa casquette. Il a également mis tous ces biens sous le siège et est parti. Le 29 juin au matin, mon major ordonne qu'il soit emmené hors de la ville, en direction de Trosnitsa. Là, il supervisa la construction des fortifications. Nous sommes partis. Le major somnole tranquillement sur la banquette arrière et mon cœur bondit presque hors de ma poitrine. Je roulais vite, mais en dehors de la ville, j'ai ralenti, puis j'ai arrêté la voiture, je suis descendu et j'ai regardé autour de moi : loin derrière moi, il y avait deux camions de marchandises. J'ai retiré le poids et j'ai ouvert la porte plus grand. Le gros homme se renversa sur son siège, ronflant comme s'il avait sa femme à ses côtés. Eh bien, je l'ai frappé à la tempe gauche avec un poids. Lui aussi baissa la tête. Bien sûr, je l’ai encore frappé, mais je ne voulais pas le tuer à mort. J'ai dû le délivrer vivant, il a dû dire beaucoup de choses à notre peuple. J'ai sorti le Parabellum de son étui, je l'ai mis dans ma poche et j'ai enfoncé le pied-de-biche dans le dos. banquette arrière, le fil téléphonique a été passé autour du cou du major et attaché avec un nœud aveugle sur un levier. Ceci afin qu'il ne tombe pas sur le côté ou ne tombe pas lors d'une conduite rapide. Il a rapidement enfilé son uniforme et sa casquette et a conduit la voiture directement là où la terre bourdonnait, là où se déroulait la bataille. La ligne de front allemande se glissait entre deux bunkers. Les mitrailleurs ont sauté hors de l'abri et j'ai délibérément ralenti pour qu'ils puissent voir que le major arrivait. Mais ils ont commencé à crier, à agiter les bras, en disant qu'on ne pouvait pas y aller, mais je n'ai pas semblé comprendre, j'ai mis les gaz et je suis parti à plein régime. Jusqu'à ce qu'ils reprennent conscience et commencent à tirer avec des mitrailleuses sur la voiture, et j'étais déjà dans le no man's land entre les cratères, zigzaguant comme un lièvre. Ici, les Allemands me frappent par derrière, et ici leurs silhouettes tirent vers moi avec des mitrailleuses. Le pare-brise était percé à quatre endroits, le radiateur était percé par des balles... Mais maintenant il y avait une forêt au-dessus du lac, nos gens couraient vers la voiture, et j'ai sauté dans cette forêt, j'ai ouvert la portière, je suis tombé par terre et je l'ai embrassé, et je ne pouvais pas respirer... Un jeune homme, portant sur sa tunique des bretelles de protection comme je n'en ai jamais vu, est le premier à courir vers moi en montrant les dents : « Ouais, putain de Fritz, tu t'es perdu ? J'ai arraché mon uniforme allemand, j'ai jeté ma casquette à mes pieds et je lui ai dit : « Mon cher claqueur de lèvres ! Cher fils ! Quel genre de Fritz pensez-vous que je suis quand je suis un résident naturel de Voronej ? J'étais prisonnier, d'accord ? Maintenant, détachez ce porc assis dans la voiture, prenez sa mallette et emmenez-moi chez votre commandant. Je leur ai remis le pistolet et je suis passé de main en main, et le soir je me suis retrouvé avec le colonel - le commandant de division. À ce moment-là, ils m'ont nourri, m'ont emmené à la banque, m'ont interrogé et m'ont donné des uniformes, alors je me suis présenté à la pirogue du colonel, comme prévu, propre d'âme et de corps, et en uniforme complet. Le colonel s'est levé de table et s'est dirigé vers moi. Devant tous les officiers, il m'a serré dans ses bras et m'a dit : « Merci, soldat, pour le cher cadeau que j'ai apporté des Allemands. Votre major et sa mallette valent pour nous plus de vingt « langues ». Je demanderai au commandement de vous proposer pour un prix gouvernemental. Et à cause de ses paroles, de son affection, j'étais très inquiet, mes lèvres tremblaient, je n'obéissais pas, tout ce que je pouvais extraire de moi-même était : « S'il vous plaît, camarade colonel, enrôlez-moi dans l'unité de fusiliers. Mais le colonel a ri et m'a tapoté l'épaule : « Quel genre de guerrier es-tu si tu peux à peine tenir debout ? Je t'enverrai à l'hôpital aujourd'hui. Là-bas, ils vous soigneront, vous nourriront, après quoi vous rentrerez chez votre famille pour un mois de vacances, et quand vous reviendrez chez nous, nous verrons où vous loger. Le colonel et tous les officiers qu'il avait dans la pirogue m'ont dit au revoir avec émotion par la main, et je suis parti complètement agité, car en deux ans je n'étais plus habitué au traitement humain. Et remarquez, mon frère, que pendant longtemps, dès que je devais parler aux autorités, par habitude, je mettais involontairement ma tête contre mes épaules, comme si j'avais peur qu'elles me frappent. C'est ainsi que nous avons été éduqués dans les camps fascistes... Depuis l'hôpital, j'ai immédiatement écrit une lettre à Irina. Il a tout décrit brièvement, comment il était en captivité, comment il s'était échappé avec le major allemand. Et, je vous en prie, d'où vient cette vantardise d'enfance ? Je n'ai pas pu m'empêcher de dire que le colonel me l'avait promis ! présent pour le prix... J'ai dormi et mangé pendant deux semaines. Ils m’ont nourri petit à petit, mais souvent, sinon, s’ils m’avaient donné assez à manger, j’aurais pu mourir, c’est ce que disait le médecin. J'ai gagné pas mal de force. Et après deux semaines, je ne pouvais plus prendre un morceau de nourriture dans ma bouche. Il n’y a eu aucune réponse de chez moi et je dois admettre que je me sentais triste. La nourriture ne me vient même pas à l'esprit, le sommeil m'échappe, toutes sortes de mauvaises pensées me viennent à l'esprit... La troisième semaine, je reçois une lettre de Voronej. Mais ce n’est pas Irina qui écrit, mais mon voisin, le charpentier Ivan Timofeevich. À Dieu ne plaise que quiconque reçoive de telles lettres !.. Il rapporte qu'en juin 1942, les Allemands ont bombardé une usine d'avions et qu'une bombe lourde a touché ma petite maison. Irina et ses filles étaient juste à la maison... Eh bien, elle écrit qu'elles n'ont trouvé aucune trace d'elles, et à la place de la cabane il y avait un trou profond... Je n'ai pas lu la lettre au terminer cette fois. Ma vision s’assombrit, mon cœur se serra en boule et ne voulut pas se desserrer. Je me suis allongé sur le lit, je me suis allongé un moment et j'ai fini de lire. Un voisin écrit qu'Anatoly était dans la ville lors du bombardement. Le soir, il retourna au village, regarda la fosse et retourna dans la ville la nuit. Avant de partir, il a dit à son voisin qu'il demanderait à se porter volontaire pour le front. C'est ça.  Lorsque mon cœur a éclaté et que le sang a commencé à rugir dans mes oreilles, je me suis souvenu à quel point il était difficile pour mon Irina de se séparer de moi à la gare. Cela signifie que même alors, le cœur d’une femme lui disait que nous ne nous reverrons plus dans ce monde. Et puis je l'ai repoussée... J'avais une famille, ma propre maison, tout cela était mis en place depuis des années, et tout s'est effondré en un instant, je suis resté seul. Je pense : « Ne viens-je pas de rêver de ma vie difficile ? Mais j'étais en captivité presque toutes les nuits, je me parlais tout seul, bien sûr, et avec Irina et les enfants, je les encourageais, ils disaient : je reviendrai, ma famille, ne t'inquiète pas pour moi, je suis forte, Je survivrai, et encore une fois nous serons tous ensemble... Alors ça fait deux ans que je parle aux morts ?! Le narrateur resta silencieux pendant une minute, puis dit d'une voix différente, intermittente et calme : Allez, mon frère, allons fumer, sinon je me sens étouffé. Nous avons commencé à fumer. Dans une forêt inondée d'eau creuse, un pic tapait bruyamment. Le vent chaud remuait encore paresseusement les boucles d'oreilles sèches de l'aulne ; Les nuages flottaient encore dans le bleu élevé, comme sous des voiles blanches et serrées, mais le vaste monde, se préparant aux grands accomplissements du printemps, à l'affirmation éternelle du vivant dans la vie, me paraissait différent dans ces moments de silence lugubre. C'était difficile de garder le silence, alors j'ai demandé : Quelle est la prochaine étape ? - le narrateur a répondu à contrecœur. - Ensuite, j'ai reçu un mois de congé du colonel, une semaine plus tard j'étais à Voronej. J'ai marché à pied jusqu'à l'endroit où vivait autrefois ma famille. Entonnoir profond rempli de eau rouillée, des mauvaises herbes jusqu'à la taille tout autour... Désert, silence de cimetière. Oh, c'était dur pour moi, frère ! Il resta là, le cœur affligé, et retourna à la gare. Je ne pouvais pas rester là une heure ; le jour même, je suis retourné à la division. Mais trois mois plus tard, la joie m'a envahi, comme le soleil derrière un nuage : Anatoly a été retrouvé. Il m'a envoyé une lettre au front, apparemment d'un autre front. J'ai appris mon adresse d'un voisin, Ivan Timofeevich. Il s'avère qu'il s'est d'abord retrouvé dans une école d'artillerie ; C’est là que ses talents en mathématiques se sont révélés utiles. Un an plus tard, il obtient son diplôme universitaire avec mention, part au front et écrit maintenant qu'il a reçu le grade de capitaine, commande une batterie de «quarante-cinq», possède six ordres et médailles. En un mot, il a repris les parents de partout. Et encore une fois, j'étais terriblement fier de lui ! Quoi qu'on en dise, mon propre fils est capitaine et commandant de batterie, ce n'est pas une blague ! Et même avec de telles commandes. C'est normal que son père transporte des obus et autres équipements militaires dans une Studebaker. Les affaires de mon père sont dépassées, mais pour lui, le capitaine, tout est en avance. Et la nuit, j'ai commencé à rêver comme un vieil homme : comment la guerre finirait, comment j'épouserais mon fils et vivrais avec les jeunes, travaillerais comme charpentier et allaiterais mes petits-enfants. En un mot, toutes sortes de trucs de vieux. Mais même ici, j'ai eu un raté complet. Pendant l'hiver, nous avons avancé sans répit et nous n'avons pas eu le temps de nous écrire très souvent, mais vers la fin de la guerre, déjà près de Berlin, j'ai envoyé une lettre à Anatoly le matin, et le lendemain j'ai reçu une réponse. . Et puis j'ai réalisé que mon fils et moi approchions de la capitale allemande par des itinéraires différents, mais que nous étions proches l'un de l'autre. J’ai hâte, j’ai vraiment hâte de prendre le thé quand nous le rencontrerons. Eh bien, nous nous sommes rencontrés... Exactement le 9 mai, au matin, le jour de la Victoire, un tireur d'élite allemand a tué mon Anatoly... Dans l'après-midi, le commandant de compagnie m'appelle. J'ai vu un lieutenant-colonel d'artillerie, que je ne connaissais pas, assis à côté de lui. Je suis entré dans la pièce et il s'est levé comme devant un homme âgé. Le commandant de ma compagnie dit : « À toi, Sokolov », et il se tourna vers la fenêtre. Cela m'a pénétré comme si choc électrique parce que j'ai senti quelque chose de mauvais. Le lieutenant-colonel s'est approché de moi et m'a dit doucement : « Courage, père ! Votre fils, le capitaine Sokolov, a été tué aujourd'hui à la batterie. Viens avec moi!" J'ai vacillé, mais je suis resté debout. Maintenant, comme dans un rêve, je me souviens comment je chevauchais avec le lieutenant-colonel sur grosse voiture Comment nous avons parcouru les rues jonchées de décombres, je me souviens vaguement de la formation des soldats et du cercueil recouvert de velours rouge. Et je vois Anatoly comme toi, frère. Je m'approche du cercueil. Mon fils y réside et n'est pas le mien. Le mien est toujours un garçon souriant, aux épaules étroites, avec une pomme d'Adam pointue sur son cou maigre, et ici repose un jeune, aux larges épaules, bel homme, ses yeux sont mi-clos, comme s'il regardait quelque part au-delà de moi, dans une distance lointaine et inconnue de moi. Seulement au coin de ses lèvres restait à jamais le sourire du vieux fils Tolka, que j'ai connu autrefois... Je l'ai embrassé et je me suis écarté. Le lieutenant-colonel a prononcé un discours. Les camarades et amis de mon Anatoly essuient leurs larmes, mais mes larmes non versées semblent avoir séché dans mon cœur. C'est peut-être pour ça que ça fait si mal ?... J'ai enterré mes dernières joies et mes derniers espoirs dans un pays étranger, allemand, la batterie de mon fils a frappé, accompagnant son commandant dans un long voyage, et c'était comme si quelque chose se brisait en moi... Ce n'est pas moi qui suis arrivé à mon unité. Mais ensuite j'ai été rapidement démobilisé. Où aller ? Est-ce vraiment à Voronej ? Certainement pas! Je me suis souvenu que mon ami vivait à Uryupinsk, démobilisé en hiver en raison d'une blessure - il m'a invité une fois chez lui - je me suis souvenu et je suis allé à Uryupinsk. Mon ami et sa femme n’avaient pas d’enfants et vivaient dans leur propre maison à la périphérie de la ville. Même s'il souffrait d'un handicap, il travaillait comme chauffeur dans une entreprise automobile et j'y ai également trouvé un emploi. Je suis resté chez un ami et ils m'ont hébergé. Charges diverses Nous les avons transférés dans les régions et, à l'automne, nous nous sommes tournés vers l'exportation de céréales. C'est à cette époque que j'ai rencontré mon nouveau fils, celui-là qui joue dans le sable. Autrefois, lorsque vous reveniez en ville après un vol, bien sûr, la première chose que vous faisiez était d'aller dans un salon de thé : prendre quelque chose et, bien sûr, boire cent grammes de ce qui restait. Je dois dire que je suis déjà devenue complètement accro à cette activité néfaste... Et puis une fois je vois ce type près du salon de thé, et le lendemain je le revois. Une sorte de petit vagabond : son visage est couvert de jus de pastèque, couvert de poussière, sale comme de la poussière, négligé, et ses yeux sont comme des étoiles la nuit après la pluie ! Et je suis tellement tombée amoureuse de lui que, miraculeusement, il commençait déjà à me manquer, et j'étais pressé de descendre de l'avion pour le voir au plus vite. Près du salon de thé, il se nourrissait - qui donnerait quoi. Le quatrième jour, directement de la ferme d'État, chargé de pain, je me suis présenté au salon de thé. Mon garçon est assis là sur le porche, bavardant avec ses petites jambes et apparemment affamé. Je me suis penché par la fenêtre et lui ai crié : « Hé, Vanyushka ! Montez vite dans la voiture, je vous emmène à l’ascenseur, et de là nous reviendrons ici pour déjeuner. Il tressaillit à mon cri, sauta du porche, monta sur la marche et dit doucement : « Comment sais-tu, mon oncle, que je m'appelle Vanya ? Et il a ouvert grand les yeux, attendant que je lui réponde. Eh bien, je lui dis que je suis une personne expérimentée et que je sais tout. Il est entré par le côté droit, j'ai ouvert la porte, je l'ai assis à côté de moi et nous sommes partis. Un gars tellement intelligent, mais soudain, il est devenu silencieux pour quelque chose, perdu dans ses pensées, et non, non, et m'a regardé sous ses longs cils recourbés vers le haut et a soupiré. Un si petit oiseau, mais qui a déjà appris à soupirer. Est-ce son affaire ? Je demande : « Où est ton père, Vanya ? Chuchotement : « Il est mort au front. » - "Et maman ?" - "Maman a été tuée par une bombe dans le train alors que nous voyagions." - « D'où veniez-vous ? » - "Je ne sais pas, je ne me souviens pas..." - "Et tu n'as personne de famille ici ?" - "Personne." - "Où passes-tu la nuit ?" - "Là où il le faut." Une larme brûlante s’est mise à bouillir en moi et j’ai immédiatement décidé : « Nous ne devons pas disparaître séparément ! Je le prendrai comme mon enfant. Et immédiatement, mon âme s'est sentie légère et en quelque sorte légère. Je me suis penché vers lui et lui ai demandé doucement : « Vanyushka, sais-tu qui je suis ? Il a demandé en expirant : « Qui ? Je lui dis tout aussi doucement : « Je suis ton père. » Mon Dieu, que s'est-il passé ici ! Il s'est précipité vers mon cou, m'a embrassé sur les joues, les lèvres, le front, et comme un jaseur, il a crié si fort et si faiblement que même dans la cabine, il était étouffé : « Cher papa ! Je le savais! Je savais que tu me trouverais ! Vous le trouverez de toute façon ! J'ai attendu si longtemps que tu me trouves ! Il se serra contre moi et trembla de partout, comme un brin d'herbe au vent. Et il y a du brouillard dans mes yeux, et je tremble aussi de partout, et mes mains tremblent... Comment n'ai-je pas perdu le volant à ce moment-là, vous vous demandez peut-être ! Mais il a quand même accidentellement glissé dans un fossé et a coupé le moteur. Jusqu'à ce que le brouillard dans mes yeux disparaisse, j'avais peur de conduire, de peur de croiser quelqu'un. Je suis resté ainsi pendant environ cinq minutes, et mon fils se blottit toujours plus près de moi de toutes ses forces, restait silencieux et frissonnait. je l'ai serré dans mes bras main droite, le pressa lentement contre lui, fit demi-tour avec sa main gauche et retourna à son appartement. Quel genre d'ascenseur y a-t-il pour moi, alors je n'ai pas eu le temps de prendre l'ascenseur. J'ai laissé la voiture près du portail, j'ai pris mon nouveau fils dans mes bras et je l'ai porté jusqu'à la maison. Et il a enroulé ses bras autour de mon cou et ne s’est pas arraché jusqu’au bout. Il pressa sa joue contre ma joue mal rasée, comme coincée. Alors je l'ai apporté. Le propriétaire et l'hôtesse étaient exactement chez eux. Je suis entré, j'ai cligné des yeux et j'ai dit joyeusement : « Alors j'ai trouvé ma Vanyushka ! Bienvenue-nous de bonnes personnes! Ils, qui n'avaient pas d'enfants tous les deux, ont immédiatement compris ce qui se passait, ils ont commencé à s'agiter et à courir partout. Mais je ne peux pas m’arracher mon fils. Mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai persuadé. Je lui ai lavé les mains avec du savon et je l'ai assis à table. L'hôtesse a versé de la soupe aux choux dans son assiette, et quand elle a vu avec quelle gourmandise il mangeait, elle a fondu en larmes. Il se tient près du poêle et pleure dans son tablier. Ma Vanyushka a vu qu'elle pleurait, a couru vers elle, a tiré sur son ourlet et a dit : « Tante, pourquoi pleures-tu ? Papa m'a trouvé près du salon de thé, tout le monde ici devrait être content, mais tu pleures. Et celui-là - à Dieu ne plaise, il déborde encore plus, il est littéralement tout mouillé ! Après le déjeuner, je l'ai emmené chez le coiffeur, je lui ai coupé les cheveux et, à la maison, je l'ai baigné dans une auge et je l'ai enveloppé dans un drap propre. Il m'a serré dans ses bras et s'est endormi dans mes bras. Il l'a soigneusement posé sur le lit, s'est rendu à l'ascenseur, a déchargé le pain, a conduit la voiture jusqu'au parking - et a couru vers les magasins. Je lui ai acheté un pantalon en tissu, une chemise, des sandales et une casquette faite d'un gant de toilette. Bien entendu, tout cela s’est avéré à la fois insuffisant en taille et de mauvaise qualité. L'hôtesse m'a même grondé pour mon pantalon. « Vous, dit-il, êtes fous d'habiller un enfant avec des pantalons en tissu par une telle chaleur ! Et instantanément - machine à coudre sur la table, fouillé dans la poitrine, et une heure plus tard, ma Vanya avait préparé sa culotte en satin et une chemise blanche à manches courtes. Je me suis couché avec lui et pour la première fois depuis pendant longtemps s'est endormi paisiblement. Cependant, la nuit, je me suis levé quatre fois. Je me réveillerai et il sera blotti sous mon bras, comme un moineau à l'abri, ronflant doucement, et mon âme se sentira si heureuse que je ne pourrai même pas l'exprimer avec des mots ! Vous essayez de ne pas bouger pour ne pas le réveiller, mais vous ne pouvez toujours pas résister, vous vous levez lentement, allumez une allumette et l'admirez... Je me suis réveillé avant l'aube, je ne comprends pas pourquoi je me sentais si étouffé ? Et c'est mon fils qui a rampé hors du drap et s'est allongé sur moi, s'est étendu et a pressé sa petite jambe contre ma gorge. Et c'est agité de coucher avec lui, mais j'y suis habitué, je m'ennuie sans lui. La nuit, on le caresse endormi, ou on sent les poils de ses mèches, et son cœur s'éloigne, s'adoucit, sinon il se transforme en pierre à cause du chagrin... Au début, il faisait des voyages avec moi en voiture, puis j’ai réalisé que ça ne suffirait pas. De quoi ai-je besoin seul ? Un morceau de pain et un oignon avec du sel, et le soldat fut nourri toute la journée. Mais avec lui, c’est une autre affaire : il a besoin de lait, puis il a besoin de faire bouillir un œuf, et encore une fois, il ne peut pas vivre sans quelque chose de chaud. Mais les choses n'attendent pas. J'ai rassemblé mon courage, je l'ai laissé aux soins de sa maîtresse, et il a versé des larmes jusqu'au soir, et le soir, il a couru vers l'ascenseur pour me rencontrer. J'y ai attendu jusque tard dans la nuit. Au début, c'était difficile pour moi avec lui. Une fois que nous nous sommes couchés avant la nuit, j'étais très fatigué pendant la journée, et il gazouillait toujours comme un moineau, puis il gardait le silence sur quelque chose. Je demande : « À quoi penses-tu, mon fils ? Et il me demande en regardant lui-même le plafond : « Papa, où vas-tu avec ton manteau de cuir ? Je n'ai jamais possédé de manteau en cuir de ma vie ! J'ai dû esquiver : « Il reste à Voronej », lui dis-je. "Pourquoi m'as-tu cherché si longtemps?" Je lui réponds: "Mon fils, je te cherchais en Allemagne, en Pologne et dans toute la Biélorussie, mais tu es arrivé à Uryupinsk." - « Uryupinsk est-elle plus proche de l'Allemagne ? Quelle est la distance entre notre maison et la Pologne ? » Alors on discute avec lui avant de se coucher. Pensez-vous, frère, qu'il a eu tort de poser des questions sur le manteau en cuir ? Non, tout cela n’est pas sans raison. Cela signifie qu'il était une fois son vrai père qui portait un tel manteau, alors il s'en souvenait. Après tout, la mémoire d’un enfant est comme un éclair d’été : elle s’enflamme, éclaire brièvement tout, puis s’éteint. Ainsi sa mémoire, comme l’éclair, fonctionne par éclairs. Peut-être aurions-nous pu vivre encore un an avec lui à Uryupinsk, mais en novembre, un péché m'est arrivé : je conduisais dans la boue, dans une ferme, ma voiture a dérapé, puis une vache est arrivée et je l'ai renversée. Eh bien, comme vous le savez, les femmes ont commencé à crier, les gens ont couru et l'inspecteur de la circulation était là. Il m’a pris mon livret de conduite, même si je lui demandais d’avoir pitié. La vache s'est levée, a levé la queue et s'est mise à galoper dans les allées, et j'ai perdu mon livre. J'ai travaillé comme menuisier pendant l'hiver, puis j'ai pris contact avec un ami, également collègue - il travaille comme chauffeur dans votre région, dans le district de Kasharsky - et il m'a invité chez lui. Il écrit que si vous travaillez pendant six mois dans la menuiserie, alors dans notre région, on vous donnera un nouveau livre. Mon fils et moi partons donc en voyage d'affaires à Kashary. Oui, comment puis-je vous le dire, et si je n'avais pas eu cet accident avec la vache, j'aurais quand même quitté Uryupinsk. La mélancolie ne me permet pas de rester longtemps au même endroit. Quand mon Vanyushka grandira et que je devrai l'envoyer à l'école, alors peut-être que je me calmerai et m'installerai au même endroit. Et maintenant nous marchons avec lui sur le sol russe. C’est difficile pour lui de marcher », dis-je. Du coup, il ne marche pas beaucoup sur ses propres pieds, il monte de plus en plus sur moi. Je vais le mettre sur mes épaules et le porter, mais s’il veut se perdre, il me lâche et court sur le bord de la route en donnant des coups de pied comme un enfant. Tout cela, mon frère, aurait été bien, d'une manière ou d'une autre nous aurions vécu avec lui, mais mon cœur balançait, il faut changer le piston... Parfois, il s'accroche et appuie si fort que la lumière blanche dans mes yeux s'estompe. J'ai peur qu'un jour je meure dans mon sommeil et que je fasse peur à mon petit-fils. Et voici un autre problème : presque toutes les nuits, je vois mes chers morts dans mes rêves. Et c'est de plus en plus comme si j'étais derrière les barbelés et qu'ils étaient libres, de l'autre côté... Je parle de tout avec Irina et les enfants, mais dès que je veux pousser le fil avec mes mains, ils s'éloignent de moi, comme s'ils fondaient sous mes yeux... Et voici une chose étonnante : pendant la journée, je me tiens toujours fermement, on ne peut pas me faire sortir un « ooh » ou un soupir, mais à la nuit, je me réveille et tout l'oreiller est mouillé de larmes... Un inconnu, mais devenu proche de moi, se leva et me tendit une large main, dure comme un arbre : Au revoir frère, vie heureuse à toi ! Et vous êtes heureux d'atteindre Kashar. Merci. Hé mon fils, allons au bateau.  Le garçon courut vers son père, se positionna à droite et, s’agrippant au bas de la veste matelassée de son père, trottina à côté de l’homme qui faisait de grands pas. Deux orphelins, deux grains de sable, jetés à l'étranger par un ouragan militaire d'une force sans précédent... Qu'est-ce qui les attend ? Et j'aimerais penser que cet homme russe, un homme à la volonté inflexible, endurera et grandira à côté de l'épaule de son père, celui qui, ayant mûri, sera capable de tout endurer, de tout surmonter sur son chemin, si sa Patrie l'appelle à cela. Avec une grande tristesse, je les ai soignés... Peut-être que tout se serait bien passé si nous nous séparions, mais Vanyushka, s'éloignant de quelques pas et tressant ses maigres jambes, s'est tourné vers moi tandis qu'il marchait et a agité sa petite main rose. Et soudain, comme si une patte douce mais griffue me serrait le cœur, je me détournai précipitamment. Non, ce n’est pas seulement dans leur sommeil que pleurent les hommes âgés, devenus gris pendant les années de guerre. Ils pleurent en réalité. L'essentiel ici est de pouvoir se détourner à temps. Le plus important ici est de ne pas blesser le cœur de l'enfant, pour qu'il ne voie pas une larme d'homme brûlante et avare couler sur votre joue... |
Populaire:
Nouveau
- Visage de l'hiver Citations poétiques pour les enfants
- Leçon de langue russe "Signe doux après le sifflement des noms"
- L'Arbre Généreux (parabole) Comment trouver une fin heureuse au conte de fées L'Arbre Généreux
- Plan de cours sur le monde qui nous entoure sur le thème « Quand viendra l'été ?
- Asie de l'Est : pays, population, langue, religion, histoire En tant qu'opposant aux théories pseudoscientifiques sur la division des races humaines en inférieures et supérieures, il a prouvé la vérité
- Classification des catégories d'aptitude au service militaire
- La malocclusion et l'armée La malocclusion n'est pas acceptée dans l'armée
- Pourquoi rêvez-vous d'une mère morte vivante: interprétations des livres de rêves
- Sous quels signes du zodiaque sont nées les personnes nées en avril ?
- Pourquoi rêvez-vous d'une tempête sur les vagues de la mer ?