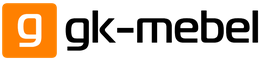Rubriques du site
Choix de l'éditeur :
- Six exemples d'une approche compétente de la déclinaison des chiffres
- Visage de l'hiver Citations poétiques pour les enfants
- Leçon de langue russe "Signe doux après le sifflement des noms"
- L'Arbre Généreux (parabole) Comment trouver une fin heureuse au conte de fées L'Arbre Généreux
- Plan de cours sur le monde qui nous entoure sur le thème « Quand viendra l'été ?
- Asie de l'Est : pays, population, langue, religion, histoire En tant qu'opposant aux théories pseudoscientifiques sur la division des races humaines en inférieures et supérieures, il a prouvé la vérité
- Classification des catégories d'aptitude au service militaire
- La malocclusion et l'armée La malocclusion n'est pas acceptée dans l'armée
- Pourquoi rêvez-vous d'une mère morte vivante: interprétations des livres de rêves
- Sous quels signes du zodiaque sont nées les personnes nées en avril ?
Publicité
| Lecteur en sociologie. Sociologie générale. Lecteur. Comp. Zdravomyslov A.G., Lapin N.I. Sur la division du travail social |
|
Ce lecteur fait partie du complexe pédagogique du cours « Sociologie générale », préparé dans le cadre d'un projet (dirigé par N.I. Lapin), qui a reçu le soutien à la suite d'un concours conjoint entre la Fondation humanitaire russe et le ministère de l'Éducation de la Fédération de Russie. Ce complexe comprend un Manuel, un Atelier et une Lecteur*. Ce dernier fournit la base de sources nécessaire à ce cours. Ces dernières années, plusieurs anthologies de sociologie ont été publiées en Russie - générales et spécialisées. Pourtant, les enseignants et les étudiants ont du mal à trouver des sources dans de nombreux domaines de la sociologie générale. Ce Lecteur contient une sélection systématique de plus de 100 textes importants, leurs auteurs sont 70 sociologues étrangers et nationaux. Il s'agit de textes compacts provenant de sources classiques et modernes, étrangères et nationales ; ensemble, ils justifient des concepts et des termes, des approches et des points de vue sur le sujet du cours, y compris alternatifs. Dans la mesure du possible, leur évolution est retracée. Une notice biographique est fournie sur chaque auteur des textes. Dans certains cas, les compilateurs ont donné leurs noms aux textes, expliquant leur lien avec les objectifs du Lecteur ; ces noms sont mis entre crochets. Les sources dont sont issus les textes sont indiquées sous forme de notes sous le titre de chaque texte. Le contenu du Lecteur exprime la logique générale du cours, qui est structurée selon les principes de l'approche anthroposociétale étayés dans le Manuel. Il comprend une section introductive et méthodologique et trois parties principales : « Personne contre société », « Structure de la société » et « Dynamique de la société » ; Chaque partie est divisée en sections - au total, avec la section d'introduction, 6 sections. À leur tour, les textes de chaque section sont regroupés en petites sous-sections thématiques. Tout cela encourage les étudiants à comprendre de manière autonome les sujets du cours. Une aide supplémentaire pour une telle compréhension est contenue dans l’atelier. Lors de la sélection des textes, les compilateurs ont été guidés par plusieurs considérations. Tout d'abord, le Lecteur présente des auteurs qui offrent leur propre point de vue sur la société dans son ensemble, ou la société dans son ensemble. C’est le niveau sociétal, ou plus précisément anthroposociétal, de considération des problèmes sociologiques. Les points de vue des différents auteurs sur ces problèmes diffèrent sensiblement les uns des autres ; pris ensemble, ils offrent au lecteur l’opportunité de se familiariser avec la réelle diversité des positions théoriques de la sociologie classique et moderne, qui constituent la base d’une vision du monde pluraliste. Bien entendu, ces points de vue doivent être considérés comme complémentaires et non mutuellement exclusifs. La préférence est donnée aux auteurs qui considèrent la société comme un ensemble de relations, un système de relations sociales entre les personnes. Ce système n’est cependant pas statique, mais dynamique. Il possède son propre ressort interne de développement personnel. La sociologie moderne considère le monde des relations sociales comme une réalité dans laquelle les circonstances objectives et les intentions subjectives s'entrelacent et se réalisent dans l'ensemble des actions des individus et des groupes sociaux, motivées par leurs besoins, leurs intérêts et leurs préférences de valeurs. Les compilateurs ont cherché à mettre à la disposition des lecteurs les œuvres de célèbres sociologues occidentaux, qui n'ont pas encore été traduites en russe. Nous sommes heureux d'annoncer que ces ouvrages sont présentés de manière assez complète et représentent environ 40 % du volume du Lecteur. Ainsi, un extrait des « Essais sur l'économie politique » de D.S. Mill, contemporain et correspondant d'O. Comte, est donné. Mill est l'un des fondateurs de la doctrine libérale sur les questions de relation entre l'individu et l'État. La formule bien connue selon laquelle « moins l’État s’ingère dans les intérêts privés, mieux c’est » s’est largement répandue dans l’opinion publique russe. Le texte de Mill montre le caractère intenable d'une telle interprétation, même pour les représentants classiques de la doctrine libérale. Il souligne un éventail assez large de fonctions qui, dans ces relations, appartiennent à l'État et sont mises en œuvre au nom du bien public. Le nom d'un autre penseur anglais - A. Marshall - est presque inconnu du lecteur russe. Cependant, les travaux de cet auteur sont liés à la justification du tournant de la science économique des processus macroéconomiques vers l'étude de « l'humanité dans la vie quotidienne des affaires ». Grâce à ce tournant, T. Parsons, dans « The Structure of Social Action » (1937), inclut A. Marshall parmi les fondateurs de la sociologie moderne. Et aussi le penseur italien V. Pareto, dont les opinions ne nous sont connues qu'en les racontant. C'est pourquoi nous avons inclus dans le Lecteur un texte dans lequel son idée de la circulation des élites est formulée comme la plus reconnue de la sociologie moderne. L'ouvrage de l'auteur français E. Goblo "Niveau et barrière. Une étude sociologique de la bourgeoisie française moderne" est totalement inconnu de la littérature russe. Il semble enregistrer le résultat des transformations révolutionnaires de la France qui ont eu lieu au XIXe siècle. L'analyse de la structure de classe de la société française présentée en 1925 est d'une grande importance pour évaluer les perspectives de développement de la Russie, qui conduisent à de nouvelles relations entre les classes dirigeantes, les masses laborieuses et les représentants des professions libérales. le travail est la caractéristique du mode de vie des principaux groupes sociaux de la société française à travers leur attitude envers le travail physique comme moyen de subsistance. Le nom de Robert Morrison MacIver est également, en fait, introduit pour la première fois dans la circulation scientifique. Ce célèbre sociologue américain de la période pré-parsonienne nous intéresse en tant que représentant de l’évolutionnisme, non encore exposé à l’influence des concepts postmodernes. Ce qui séduit dans le passage publié, c’est la clarté de la position théorique, basée sur la foi dans le progrès de l’humanité. Au moins quatre des textes présentés dans le Reader sont liés au domaine en développement rapide de la sociologie économique en Russie. C'est le déjà mentionné A. Marshall, qui examine le problème cardinal de la relation entre les besoins et les types d'activité humaine, en soulignant la priorité de ces dernières. Le second - Joseph Schumpeter - est mieux connu comme un économiste exceptionnel, représentant de la soi-disant école autrichienne d'économie. Le passage que nous avons choisi présente une analyse sociologique, sans simplification, des motivations de l'activité entrepreneuriale, particulièrement importante pour comprendre la situation russe moderne, où le cœur du développement économique est la lutte entre les grandes et moyennes (petites) entreprises. Frank Knight propose une sorte d'analyse systématique des fonctions de base de toute organisation économique. Enfin, le Reader inclut des éléments du livre de F. Roethlisberger et W. Dixon, qui donnent une idée adéquate de la célèbre expérience Hawthorne. Une innovation importante du Reader est une sélection de matériaux de la célèbre école de sociologie de Chicago et un certain nombre de textes qui représentent minutieusement la direction de l'interactionnisme symbolique. Il convient de noter que cette direction de la sociologie américaine s'oppose dans une certaine mesure aux classiques de l'analyse structurale-fonctionnelle. En termes sociaux, l'interactionnisme symbolique s'est développé sur la base d'une synthèse des connaissances sociologiques et psychologiques ; il s'est tourné vers l'étude des ressources du comportement personnel et de la motivation personnelle dans le contexte des conflits réellement en cours dans la société américaine. Les textes présentés ici par V. Thomas, F. Znaniecki, D. Mead, M. Bloomer, E. Goffman en témoignent de manière assez éloquente. La crise de la société se caractérise par le fait que, pour la plupart des gens, le paradigme habituel d'interaction entre l'individu et l'environnement est détruit. Et c’est la sociologie qui offre une nouvelle perspective sur ce problème. La société américaine du début du XXe siècle se révèle à bien des égards similaire à la société russe, qui a traversé de nombreuses situations de crise. La perte des repères sociaux, la criminalité endémique, l'afflux d'immigrés, la recherche de nouvelles formes d'organisation du travail et la nécessité de développer un sens de la responsabilité sociale non seulement envers la société dans son ensemble, mais aussi envers ses proches - envers sa famille , aux parents et aux enfants, à son cercle d'amis. Dans la société se pose le problème de la consolidation autour d'un certain système de valeurs. C'est la base de la stabilité au niveau macro et en même temps une garantie de bien-être personnel. C’est d’ailleurs le problème que la sociologie américaine s’efforce de résoudre depuis le début du XXe siècle. Et ce problème est intuitivement reconnu principalement par les représentants de ce qu'on appelle l'École de Chicago. V. Thomas est l'un des fondateurs de cette école, qui a proposé de passer d'une vision de la société comme une sorte d'abstraction à des problèmes sociaux vécus par les individus comme leurs propres problèmes. Il s'intéresse à des sujets tels que le sort d'une jeune fille célibataire, la situation et la souffrance des enfants en Amérique et le sort d'un grand nombre d'immigrés. C'est sur cette base qu'est née sa collaboration avec le sociologue polonais F. Znanecki. Un autre fondateur de l'école de Chicago, George Herbert Mead, est l'auteur du livre publié à titre posthume « Mind, Self and Society », qui met en lumière l'idée du conditionnement social de la conscience individuelle. Mais cela n'est pas conditionné par les conditions environnementales notoires, mais par le contenu symbolique de la conscience elle-même, l'ensemble des symboles perçus qui sont utilisés par les gens dans le processus de communication et d'activités communes. Le mérite de Mead était d'avoir mis au premier plan le problème de la conscience de soi personnelle : la perception de son propre « je » à travers « l'Autre » et la découverte du « dialogue interne » comme source indépendante de motivation. Mead montre l'importance de l'espace symbolique (culturel) de l'individu dans lequel les gens interagissent. Chaque chose et chaque action – une parole, un acte, un geste – est un acte de communication symbolique adressé à « l'Autre ». Mais « l'Autre », utilisant le même langage de symboles, dit à « Moi » qui il est : un ami, un ennemi, prêt à venir à la rescousse ou prêt à pousser celui qui tombe. Cette idée sera développée davantage par Herbert Bloomer et Erwin Goffman, l'auteur de la sociologie dramatique. Ils sont également présentés dans le Reader. Dans le cadre de l'École de Chicago, une théorie est en cours d'élaboration pour étudier la dépendance de la conscience et du comportement individuels à l'égard de la conscience du groupe de communication. Parmi la variété des textes sur cette question, nous présentons ici des extraits des travaux de F. Thrasher, qui a étudié des groupes d'adolescents délinquants à Chicago, et un article de E. Hughes, qui a tenté sérieusement de comprendre les mécanismes des crimes contre l'humanité commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Hughes a montré que les motivations de ces actes criminels résident non seulement dans le domaine de l'idéologie raciste anti-humaine, mais également dans les relations intra-groupe. Randall Collins représente une nouvelle génération de théoriciens en sociologie, qui se donnent pour mission de surmonter la confrontation théorique à travers le prisme de la sociologie des conflits. Pour lui, le conflit est un fait irréductible de la réalité sociale. Marx et Weber, Durkheim et Goffman, de son point de vue, révèlent différentes facettes des relations conflictuelles dans la société. L'un des défauts courants des manuels et manuels de sociologie traduits (E. Giddens, N. Smelser, D. Ritzer, etc.) est d'ignorer le fait même de l'existence de la pensée sociologique russe. Cette lacune a été comblée dans cette édition. Dans le Livre de Lecture, plus de 20 auteurs sur 70 sont russes. Dans leur sélection, nous sommes partis non seulement de considérations de prestige national, mais aussi du côté substantiel de la question, de l'importance des œuvres d'un auteur particulier pour comprendre la situation moderne dans son ensemble. Au cours des années de transformations radicales, un rôle particulier appartient au « facteur subjectif », car chacun doit décider par lui-même dans l'ensemble des situations nouvelles qu'offre la vie. Par conséquent, la position d'A.N. est particulièrement importante pour nous. Herzen, qui dès 1861, dans la première publication d'un des chapitres de « Passé et pensées », attirait l'attention sur l'importance du choix personnel, sur le fait que l'avenir de la société dans laquelle vit une personne dépend, en premier lieu, de tout cela, sur les efforts individuels de ceux qui vivent maintenant. Il n’est pas nécessaire de rechercher les coupables dans l’état actuel, il n’est pas nécessaire de placer des espoirs dans le destin, dans le pouvoir ou dans des puissances supérieures. Il faut agir maintenant et ici, et c'est dans cette efficacité, dans son propre choix, qu'une personne trouve le sens de son existence. A.I. Herzen et P.L. Lavrov sont des penseurs sociaux qui ont été les premiers à comprendre l'intégrité de la société russe, ainsi que ses contradictions internes, guidés par une vision du monde laïque. V.O. Klyuchevsky est un historien russe exceptionnel, dont les travaux sont imprégnés de la compréhension que les changements dans les relations sociales résultent de l'interaction des principales couches de la société correspondante. M.M. Kovalevsky, P.A. Sorokin sont les premiers sociologues professionnels en Russie à recevoir une reconnaissance internationale à ce titre. Ils sont également rejoints par S.A. Boulgakov, l'un des rares philosophes à s'être intéressé aux problèmes d'organisation de la vie économique. Le Lecteur comprend des textes d'un groupe d'auteurs russes représentant les sociologues des années soixante (L.A. Gordon, B.A. Grushin, L.M. Drobizheva, T.I. Zaslavskaya, E.V. Klopov, I.S. Kon, Yu A. Levada, N.F. Naumova, G.V. Osipov, O.I. Shkaratan, V.N. Shubkin, V. A. Yadov (les compilateurs du Reader appartiennent également à ce groupe) ; N. Kozlova et M. S. Matskovsky. Les idées de ces auteurs, prises ensemble, révèlent les processus de transformation les plus complexes en cours dans la société russe. les problèmes de la crise systémique, une discussion sur ses causes et les options politiques pour aider à surmonter la crise, la stabilisation de la société. Leurs travaux démontrent également la diversité des positions théoriques et méthodologiques des auteurs, caractéristiques de la sociologie russe moderne. Il faut tenir compte du fait que ces positions expriment non seulement les caractéristiques des approches scientifiques des auteurs, mais aussi les différences dans les étapes spécifiques de l'évolution de l'atmosphère spirituelle de la société russe dans laquelle ils ont été créés. L'atmosphère à la veille de l'effondrement de l'URSS est une chose, une autre dans les conditions de la crise croissante de la société russe dans la première moitié des années 90, et sensiblement différente dans le contexte de la stabilisation émergente au tournant de le siècle. L'idée du Reader et sa structure ont été proposées par N.I. Lapin. Il a sélectionné et accompagné d'informations biographiques plus de 70 textes, pour la plupart déjà publiés en russe. A.G. Zdravomyslov a sélectionné, édité et accompagné d'informations biographiques plus de 25 textes, dont la plupart n'ont pas été traduits en russe ; ils représentaient environ 40 % du volume du Reader. Il les a également accompagnés d'articles introductifs. La traduction de la plupart de ces textes en russe a été réalisée par V.G. A noter que certains de ces textes se caractérisent par le plus haut degré de complexité. Les compilateurs expriment leur profonde gratitude à Vladislav Gennadievich. Nous remercions les professeurs de la Faculté de sociologie de l'Université d'État de Moscou A.B. Alieva, E.V. Maslennikov, T.V. Selezneva, ainsi que les sociologues L.A. Belyaeva et V.G. Nikolaeva pour leur aide dans la préparation de certains documents. Les compilateurs remercient également I.E.Akhvatkina, chercheur à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences de Russie, pour son soutien scientifique et organisationnel à la préparation du Lecteur. En conclusion de leur travail, les auteurs expriment l'espoir que les matériaux présentés dans le Lecteur seront utilisés par une nouvelle génération de sociologues tant dans l'enseignement que dans la recherche visant à étudier les problèmes sociaux actuels de la société moderne. Nous serons reconnaissants à tous les lecteurs pour leurs commentaires et suggestions. Nous exprimons notre gratitude à la Fondation scientifique humanitaire russe pour le soutien apporté à la préparation du Lecteur. Professeur A.G. Zdravomyslov. Membre correspondant de l'Académie russe des sciences, Professeur N.I. Lapin. Ippolitova T.V.Guide d'étude. Université d'État du Kazakhstan du Nord nommée d'après. M. Kozybaeva. Département d'histoire mondiale et de sciences politiques. Petropavlovsk, 2008 - 241 pp. Le manuel présente des portraits créatifs de penseurs célèbres dont les théories ont considérablement enrichi la science sociologique. Le fichier sera envoyé à votre adresse e-mail. Cela peut prendre jusqu'à 1 à 5 minutes avant de le recevoir. Le fichier sera envoyé sur votre compte Kindle. Cela peut prendre jusqu'à 1 à 5 minutes avant de le recevoir. En savoir plus. MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DES SCIENCES DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN UNIVERSITÉ D'ÉTAT DU KAZAKHSTAN DU NORD. M. KOZYBAEVA DÉPARTEMENT D'HISTOIRE MONDIALE ET DE SCIENCES POLITIQUE IPPOLITOVA T.V. LECTURE LECTURE SUR LA SOCIOLOGIE (manuel) Petropavlovsk 2008 Manuel pédagogique préparé par le Ph.D. Ippolitova T.V. Le manuel présente des portraits créatifs de penseurs célèbres dont les théories ont considérablement enrichi la science sociologique. Il comprend des informations sur les théories les plus célèbres des classiques de la sociologie. Il contient des textes provenant de sources primaires de sociologues tels que O. Comte, G. Spencer, E. Durkheim, M. Weber et d'autres. Le manuel est destiné aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur. Contenu Introduction Section 1 Portraits de sociologues Section 2 Qu'est-ce que la sociologie. et qu'étudie-t-il Comte O. L'esprit de la philosophie positive Spencer G. Fondements de la sociologie Spencer G. La sociologie comme sujet d'étude Durkheim E. Méthode de sociologie Simmel G. Le problème de la sociologie Giddings F.G. Fondements de la sociologie Znaniecki F. Données initiales de la sociologie Section 3 À propos de la société Durkheim E. Sur la division du travail social Durkheim E. Suicide Weber M. Sur certaines catégories de compréhension de la sociologie Parsons T. Le concept de société : les composantes et leurs relations Merton R.K. Fonctions manifestes et latentes Merton R.K. Structure sociale et anomie Introduction Le manuel est une collection de textes et de fragments d'œuvres de sociologues classiques. Les textes sont sélectionnés de manière à couvrir les principales problématiques de la sociologie fondamentale : la théorie de la connaissance sociologique, la théorie du développement et du fonctionnement de la société. Les manuels et supports pédagogiques sous forme de cours magistraux et d'instructions méthodologiques jouent un certain rôle dans l'élaboration des problèmes sociologiques. Cependant, tout cela donne une idée de la sociologie telle qu'interprétée par les auteurs de ces manuels et manuels. Afin d'étudier une discipline en profondeur et de manière approfondie, un étudiant doit expérimenter lui-même le monde de la pensée scientifique et se familiariser directement avec les nombreuses idées et concepts des sociologues. Dans ce cas, le rôle principal est joué par les sources primaires - les œuvres des classiques de la pensée sociologique. L'anthologie permet au lecteur de prendre connaissance de textes ou d'extraits de textes originaux. Les textes et fragments présentés dans l'anthologie reflètent diverses approches du sujet de la sociologie, des problèmes fondamentaux de la sociologie, du fonctionnement et du développement de la société et sont accessibles à la compréhension des étudiants en sociologie. La première section du manuel présente de brèves informations biographiques sur des sociologues célèbres ainsi que des informations sur les théories et les concepts qu'ils ont développés. Cela aidera les étudiants à maîtriser plus facilement le contenu du manuel. La deuxième section comprend des textes consacrés aux méthodes de la sociologie, à la structure des connaissances sociologiques et à la sociologie comme sujet d'étude. La troisième section comprend des textes dans lesquels les auteurs révèlent le contenu de leurs théories sur les problèmes de développement social, la structure de la société et les questions de compréhension de la société à travers l'exercice de certaines fonctions. Le but de ce manuel est de transmettre dans les mots des fondateurs de la sociologie le sens principal, le contenu principal de leurs enseignements, de voir l'importance de la sociologie en tant que science. Le matériel présenté peut être utilisé pour l'étude orale de sujets, ainsi que pour la rédaction d'essais et de rapports. SECTION 1 Portraits de sociologues Comte Auguste (Comte) (1798-1857) - célèbre philosophe et sociologue français, fondateur de la tradition positiviste dans les sciences sociales. Né dans la ville française de Montpellier. Depuis l'âge de 16 ans jusqu'à ses derniers jours, il a vécu dans la capitale française. Il a étudié à l'Ecole Polytechnique Supérieure de Paris, où il a reçu une formation systématique dans le domaine des sciences naturelles, qu'il a élargie et approfondie au cours d'études indépendantes. Peu à peu, il développe un intérêt pour les questions littéraires, philosophiques et sociales. Pendant 7 ans (de 1817 à 1824), Comte fut le secrétaire et l'élève de Saint-Simon, ce qui l'aida à élargir et à approfondir ses connaissances dans le domaine des sciences sociales. Même pendant la période de collaboration avec Saint-Simon, Comte publie de nombreux petits articles dont le contenu indique qu'il a sérieusement travaillé sur les problèmes sociaux. Un exemple est son article intitulé « Plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société » (1822). Cet article a été réimprimé en 1824 sous le titre « Le système de la politique positive » dans la série du Catéchisme des industriels de Saint-Simon. Comte a créé l'œuvre principale de sa vie, « Le Cours de philosophie positive », pendant 13 ans (de 1829 à 1842). Ce grand ouvrage, dont le premier volume fut publié en 1830, présente un certain nombre de philosophies de sciences individuelles, qui se succèdent dans un certain ordre : la philosophie des mathématiques est remplacée par la philosophie de l'astronomie et de la physique, de la chimie et de la biologie. .. Comte consacre les trois derniers volumes du Cours à la présentation de la « physique sociale » ou de la « sociologie ». Le premier de ces trois volumes plaide en faveur de la nécessité d’étudier les lois sociologiques et fournit les fondements théoriques de la théorie sociale. Dans les 5e et 6e volumes du Cours, il caractérise en détail la loi fondamentale de sa science de la société : la loi des trois étapes. En conclusion, Comte exprime les idées devenues fondamentales lorsqu'il a créé le « Système de Politique Positive ». Après avoir terminé le cours de philosophie positive, Comte travaille sur le Système de politique positive, dont il écrit et publie quatre volumes de 1851 à 1854. Comte expose ici ses réflexions sur les principes politiques et moraux du futur ordre social. En 1849 : Publication du Calendrier Positiviste. En 1852, Comte publie le Catéchisme positiviste, et en 1854, la Bibliothèque positiviste. Au cours des dernières années de sa vie, Comte commença à écrire un autre ouvrage intitulé Synthèse subjective. Dans ce travail, il envisageait d'inclure un système de « logique positive », un système de « moralité positive » et un système d'« industrie positive ». Mais il n’a pas réussi à réaliser ses projets. Comte croyait que grâce à la science, il était possible de comprendre les lois cachées qui régissent toutes les sociétés. Il a appelé cette approche d’abord la physique sociale, puis la sociologie (c’est-à-dire la science de la société). Comte cherchait à développer une approche rationnelle de l'étude de la société, dont la base serait l'observation et l'expérimentation. Selon Comte, cette approche ; souvent appelé positivisme, fournirait la base pratique d’un nouvel ordre social plus durable. La sociologie positiviste de Comte se compose de deux concepts principaux. L’une d’elles – la statique sociale – révèle les relations entre les institutions sociales. Selon Comte, dans la société, comme dans un organisme vivant, les parties sont harmonieusement coordonnées les unes aux autres. Mais, convaincu que les sociétés sont davantage caractérisées par la stabilité, Comte s'est également intéressé à la dynamique sociale, aux processus de changement social. L'étude de la dynamique sociale est importante car elle favorise la réforme et aide à explorer les changements naturels qui se produisent à la suite de l'effondrement ou de la reconstruction des structures sociales. Deux idées, issues des travaux de Comte, sont visibles dans le développement de la sociologie : la première est l'application de méthodes scientifiques pour étudier la société ; la seconde est l'utilisation pratique de la science pour mettre en œuvre des réformes sociales. Spencer Herbert (1820-1903) - un philosophe et sociologue anglais exceptionnel, partisan du positivisme et de l'évolutionnisme dans les sciences naturelles, est né à Derby et est décédé à Brighton. Spencer n'a reçu aucune éducation humanitaire systématique et jusqu'en 1846, il a travaillé comme ingénieur ferroviaire. Parallèlement, il élargit rapidement ses connaissances dans divers domaines, ce qui lui permet de devenir rédacteur en chef de la célèbre revue Economist en 1848. C’est à cette époque que Spencer commence à s’intéresser aux questions sociales et à leur généralisation dans le cadre de sa propre théorie. En 1850, l'ouvrage scientifique de Spencer, Social Statistics, fut publié. En tant que l'un des fondateurs de l'école organique, Spencer, à la suite d'O. Comte, a introduit l'idée de variabilité et d'évolutionnisme « doux » dans la sociologie. Les concepts de la sociologie évolutionniste de Spencer - « connectivité croissante », « transition de l'homogénéité à l'hétérogénéité », « détermination » - décrivant la structure morphologique de la société, ont permis au sociologue positiviste anglais de faire une analogie entre évolution biologique et sociale, entre organismes vivants et société. À son tour, cela a révélé la possibilité d'utiliser des méthodes scientifiques naturelles en sociologie, ce qui était l'un des objectifs de l'approche positiviste des sciences sociales. Dans l'ouvrage sociologique principal - les « Fondements de la sociologie » en trois volumes (1876-1896) - Spencer a comparé la structure de classe de la société et les diverses fonctions qui y sont inhérentes à la division des fonctions entre les organes du corps vivant. Cependant, selon Spencer, les individus disposent d’une indépendance bien plus grande que les cellules biologiques. Soulignant la propriété d'autorégulation de la matière vivante, Spencer a sur cette base remis en question l'importance des formes étatiques, les considérant davantage comme des instruments de violence que comme des agents de régulation. Le sociologue anglais a reconnu les types militaire et industriel de structure sociale comme les deux pôles de l'évolution de la société. L'évolution va dans le sens du premier vers le second. Dans la mesure où la loi de la survie du plus fort se réalise dans la dynamique sociale, la société se rapproche du type industriel, caractérisé avant tout par une différenciation fondée sur la liberté personnelle. Les révolutions sociales étaient considérées par Spencer comme une maladie de la société et la reconstruction socialiste comme contraire à l'unité organique du système social et au progrès évolutif basé sur la survie des plus forts et des plus doués. Ses œuvres les plus importantes incluent également « Principes de sociologie » et « The Coming Slavery ». Herbert Spencer est un sociologue positiviste, fondateur de l'école organique en sociologie. Spencer a été profondément influencé par la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Il pensait que cela pouvait s’appliquer à tous les aspects du développement de l’Univers, y compris l’histoire de la société humaine. Spencer a comparé les sociétés aux organismes biologiques, et les parties individuelles de la société (éducation, État, etc.) aux parties du corps (cœur, système nerveux, etc.), dont chacune influence le fonctionnement de l'ensemble. Spencer pensait que les sociétés, comme les organismes biologiques, évoluent des formes les plus simples vers des formes plus complexes. La « sélection naturelle » existe également dans la société humaine, favorisant la survie des plus forts. Le processus d'adaptation, selon Spencer, contribue à la complication de la structure sociale, à mesure que ses éléments deviennent plus spécialisés. Ainsi, les sociétés évoluent d'un état relativement simple, dans lequel toutes les parties sont interchangeables, vers une structure complexe avec des éléments complètement dissemblables. Dans une société complexe, une partie (c’est-à-dire l’institution) ne peut être remplacée par une autre. Toutes les parties doivent fonctionner pour le bénéfice du tout ; sinon la société s'effondrera. Selon Spencer, cette interdépendance constitue la base de l’intégration sociale. Spencer pensait qu'il était bénéfique pour l'humanité de se débarrasser des individus inadaptés grâce à la sélection naturelle et que le gouvernement ne devait pas s'immiscer dans ce processus. Cette philosophie était appelée « darwinisme social ». Il considérait que cette philosophie était également acceptable pour les entreprises commerciales et les institutions économiques. Spencer croyait qu'avec la non-ingérence du droit dans le processus social, sur la base d'une interaction libre entre les individus et les organisations, un équilibre naturel et stable des intérêts serait atteint. Emile Durkheim (1858-1917) - philosophe et sociologue français. Né dans la ville française d'Épinal. Après avoir obtenu son diplôme du lycée local, il entre à l'Ecole Normale Supérieure de Paris. Ayant reçu une formation de philosophe, Durkheim se lance dans l'enseignement dans les lycées de province. C'est durant cette période (1882-1887) qu'il développe un vif intérêt pour la vie sociopolitique et sa compréhension théorique. En 1885-1886 il étudie la philosophie, les sciences sociales et l'éthique à Paris puis en Allemagne. De 1887 à 1902 Durkheim enseigne les sciences sociales à l'Université de Bordeaux. Ici, en 1896, il commença à publier un annuaire sociologique, qui gagna une large reconnaissance dans une grande variété de cercles sociaux. De 1902 à 1917, il enseigne à la Sorbonne. Les œuvres majeures de Durkheim ont été écrites et publiées lors de son séjour à Bordeaux. « Sur la division du travail social » (1893) est une thèse de doctorat dans laquelle Durkheim révèle les principes théoriques et socio-politiques de sa théorie. L'une des œuvres principales de Durkheim est « Les règles de la méthode sociologique » (1895). Il y expose son célèbre concept de « sociologie ». Le troisième ouvrage de Durkheim - « Le suicide : une étude sociologique » (1897) - est considéré comme un exemple classique de l'application de principes théoriques à l'analyse de la pratique de la réalité sociale. Déjà à Paris en 1912, fut publié un autre grand ouvrage de Durkheim intitulé « Formes élémentaires de la vie religieuse », résultat de l'étude de la religion en tant que phénomène social. Tout comme Comte fut le premier à introduire le terme « sociologie » dans l’usage scientifique, Durkheim fut le premier parmi les sociologues occidentaux à utiliser le concept de « sociologie appliquée », estimant que cette dernière devait fournir un ensemble de règles de comportement social. La tradition sociologique de Durkheim s'est poursuivie dans l'école sociologique dite française, dont les représentants (Bugle, Mauss, Halbwachs, etc.) ont développé et concrétisé les idées de leur grand maître. Mort à Paris. Emile Durkheim est le successeur de la ligne positiviste et évolutionniste de Comte et Spencer en sociologie, le fondateur de l'école sociologique française, l'auteur d'ouvrages classiques de sociologie : « De la division du travail social » ; « Règles de méthode sociologique », « Suicide » ; «Formes élémentaires de vie religieuse». Le comportement des gens n'est pas tant déterminé par les propriétés et les caractéristiques de l'individu, non par des raisons et des facteurs individuels, mais par l'ensemble dominant des faits sociaux. Dans ce cas, un fait social doit être déduit d'un autre, de la société elle-même, et non de leurs analogies avec des phénomènes physiques ou biologiques. La société et la réalité sociale sont considérées par Durkheim, d'une part, comme une partie de la nature, soumise à l'action de certaines lois, d'autre part, comme une réalité d'un genre particulier, irréductible à ses autres types. « La société est un système formé par une association d’individus et représentant une réalité dotée de propriétés particulières. » Dans le même temps, la priorité de la réalité sociale sur la réalité individuelle est proclamée, son rôle décisif dans la détermination de la conscience et du comportement de l'individu. Durkheim a divisé les faits sociaux en : 1. morphologiques (densité de population) ; 2. former le substrat matériel de la vie sociale ; 3. spirituel (conscience sociale), dont le rôle déterminant a été reconnu. Tout cela fait de Durkheim un classique de la sociologie au tournant des siècles passés et présents. Durkheim attachait la plus grande importance dans ses travaux scientifiques à l'étude des causes de l'ordre et du désordre dans la société. Il a développé le concept de conscience collective (un ensemble de croyances et d'opinions) partagée par tous les membres d'une société donnée. L'intégration sociale existe lorsque les membres d'une société (ou d'autres groupes) attachent de l'importance à ses normes et sont guidés par elles dans leur vie. Lorsqu’un individu ne veut pas suivre les normes générales, l’anomie se produit. Cette situation peut résulter de tout changement soudain dans la structure sociale (comme des booms ou des récessions économiques soudains). De nombreuses idées de Durkheim ont été façonnées par sa célèbre étude sur le suicide. Il a établi un lien entre le suicide et des facteurs tels que la nationalité, la religion, le sexe, l'âge et même la saison. Il a démontré que le nombre de suicides varie inversement avec l'intégration sociale, c'est-à-dire le suicide est caractéristique des représentants de certains groupes et devient donc un phénomène social ou, selon Durkheim, un « fait social ». « Pour expliquer un fait social », écrivait Durkheim, « nous devons clarifier sa fonction dans la création de l’ordre social ». Durkheim a étayé les principes de l'objectivisme et de l'empirisme dans l'étude des faits sociaux. La règle principale : « Les faits sociaux doivent être considérés comme des choses », c'est-à-dire reconnaître leur existence indépendamment du sujet et les étudier objectivement, comme les sciences naturelles (« positives ») étudient leur sujet. Max Weber (1864-1920) - Scientifique allemand, l'un des théoriciens de la société les plus éminents, fondateur de la compréhension de la sociologie et de la théorie de l'action sociale ; avocat de formation (universités de Heidelberg, Berlin et Göttingen), historien, économiste, philosophe social, né à Erfurt. Weber a enseigné aux universités de Fribourg, Heidelberg et Munich. Il a activement contribué à l'institutionnalisation de la sociologie en Allemagne et a laissé un riche héritage théorique qui a eu une grande influence sur le développement de la méthodologie de la cognition sociale. Les principaux ouvrages de Weber peuvent être regroupés conditionnellement par thème : 1. ouvrages sur l'histoire socio-économique (« Sur l'histoire des sociétés commerciales au Moyen Âge », 1889 ; « L'histoire agraire romaine et son importance pour le droit public et privé », 1891 ; " Raisons sociales du déclin de la culture ancienne », 1896 ; « Les relations agraires dans l'Antiquité », 1897 ; « Histoire économique », 1919-1920 ; « Ville », 1920-1921) ; 2. ouvrages sur les problèmes socio-économiques de l'Allemagne (série de publications de 1892 à 1912 sur la situation des ouvriers agricoles allemands, sur la bourse, sur la situation des ouvriers allemands dans l'industrie) ; 3. ouvrages sur la sociologie des religions (« L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme », 1904-1905, 1920 ; « Les sectes protestantes et l'esprit du capitalisme », 1906, 1920 ; « L'éthique économique des religions du monde », 1915-1916 , 1916-1917, 1918-1919, 1920 ; « Remarque préliminaire », 1920 ; « Sociologie des religions », 1922) ; 4. ouvrages sur la théorie de l'économie et de la société (préface du premier volume de « Essai sur l'économie sociale », 1914 ; « Économie et société », 1922 ; « Fondements rationnels et sociologiques de la musique », 1921) ; 5. travaux sur la méthodologie de la science (une série d'articles de 1903 à 1905 : « Rosher et Knies et les problèmes logiques de l'économie politique historique », « Objectivité des connaissances socio-scientifiques et socio-politiques », 1904 ; 6. « Études critiques dans le domaine de la logique des sciences sur la culture", 1906; "Sur certaines catégories de compréhension de la sociologie", 1913; "Le sens de la "liberté d'évaluation" dans les sciences sociologiques et économiques", 1917). L’aspect sociologique peut être souligné dans toutes les études de Weber, mais les questions sociologiques elles-mêmes sont plus pleinement représentées dans celles publiées à titre posthume : l’ouvrage fondamental « Économie et société » et les recueils d’articles sur la méthodologie des sciences. Ici sont résumés les résultats de ses recherches dans le domaine de la sociologie industrielle, de l'ethnosociologie, de la sociologie de la religion, du droit, de la politique, de la musique, du pouvoir, les fondements de la sociologie générale sont esquissés et les concepts méthodologiques de base de la compréhension, des types idéaux et de la liberté. à partir des valeurs prennent une forme relativement complète. En 1910, Weber participe à la création de la Société allemande de sociologie. L'autorité scientifique de Weber, qui s'est développée de manière inhabituelle au cours de sa vie, a ensuite fait de Weber un classique généralement reconnu de la sociologie moderne, dont l'influence a été ressentie par tous les sociologues modernes. Mort à Munich. Max Weber est le créateur de la sociologie compréhensive et de la théorie de l'action sociale, l'un des fondateurs de la sociologie du XXe siècle. L'enseignement de Weber a reçu le nom de « compréhension de la sociologie » et de « théorie de l'action sociale » en raison du fait qu'il était basé sur l'accent mis par le sociologue sur l'identification du sens des actions des gens, de leur comportement, qu'ils mettent eux-mêmes dans ces actions et comportements. La sociologie selon Weber est la science de l’action sociale significative. En suivant cette voie, on peut comprendre, croyait-il, la véritable essence de la société dans son ensemble et de sa structure. Toutes les actions humaines ne sont pas sociales. Sans lien les unes avec les autres, les actions n’agissent pas comme sociales, mais comme personnelles. Une action ne devient sociale que lorsque : · le sujet agissant y met un sens spécifique, l'action du sujet est motivée ; · l'action, le comportement des gens est corrélé avec le comportement des autres, co-orienté. M. Weber identifie deux signes de l'action sociale : 1. le sens subjectivement implicite 2. l'orientation vers le comportement des autres. Les actions sociales elles-mêmes sont divisées en 4 catégories selon le degré de rationalité : · orientées vers un objectif, · rationnelles par des valeurs, · affectives · traditionnelles. Sur la base de sa théorie du social rationalité des actions, Weber accorde presque toute son attention aux deux premiers types d'actions, car seulement, ils sont vraiment conscients, sociaux. L'action rationnelle intentionnelle est un type de société idéal et absolument rationnel. actes. Le sujet agissant est particulièrement conscient de ses objectifs, rationnellement corrélés à des moyens significatifs appropriés du point de vue du sujet pour atteindre cet objectif. Une action rationnelle en termes de valeurs est une action dont le sens ne réside pas dans la réalisation d’un objectif extérieur, mais dans la propre croyance du sujet agissant dans la valeur intrinsèque de cette action en tant que telle. Ils sont commis sans égard aux conséquences prévisibles, sur la base de croyances liées au devoir, à la dignité, à la religion et à la beauté. Dans les actions affectives et traditionnelles, la rationalité est très mal représentée subjectivement, elles sont irrationnelles. Le premier est extrêmement émotionnel, le second repose sur l'imitation, le respect des coutumes et des traditions par habitude. Avec G. Rickert et W. Dilthey, M. Weber a développé le concept de types idéaux - la définition de schémas d'images, considérés comme le moyen le plus pratique d'organiser le matériel empirique. Le concept d'idéal-type s'oppose à l'idée d'un modèle universel de développement historique et sert de justification méthodologique au pluralisme. Dans toutes ses études, Weber a poursuivi l'idée de rationalité en tant que caractéristique déterminante de la culture européenne moderne. La rationalité s’oppose aux modes traditionnels et charismatiques d’organisation des relations sociales. Le problème central de Weber est le lien entre la vie économique de la société, les intérêts matériels et idéologiques des différents groupes sociaux et la conscience religieuse. Weber considérait la personnalité comme la base de l'analyse sociologique. Il pensait que des concepts complexes tels que le capitalisme, la religion et l’État ne pouvaient être compris qu’à travers une analyse du comportement individuel. En obtenant des connaissances fiables sur le comportement individuel dans un contexte social, le chercheur peut mieux comprendre le comportement social des différentes communautés humaines. En étudiant la religion, Weber a identifié la relation entre l'organisation sociale et les valeurs religieuses. Selon Weber, les valeurs religieuses peuvent constituer une force puissante influençant le changement social. Ainsi, dans L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, Weber décrit comment la foi motivait les calvinistes à mener une vie de travail et de frugalité ; ces deux qualités ont contribué au développement du capitalisme moderne (le capitalisme, selon Weber, est le type de gestion économique le plus rationnel). En sociologie politique, Weber s'est intéressé aux conflits d'intérêts des différentes factions de la classe dirigeante ; Selon Weber, le principal conflit dans la vie politique d'un État moderne est la lutte entre les partis politiques et l'appareil bureaucratique. Simmel Georg (Simmel) (né le 1er mars 1858 à Berlin) est un philosophe et sociologue allemand, fondateur de la sociologie formelle. Depuis 1901, il est professeur extraordinaire à l'Université de Berlin et depuis 1914, il est professeur à l'Université de Strasbourg. A écrit plus de 30 livres. Son évolution spirituelle est issue du naturalisme, associé à l'influence sur lui du pragmatisme, du darwinisme social et de l'évolutionnisme. Vient ensuite l'étape néo-kantienne avec l'attribution de valeurs culturelles à la sphère située de l'autre côté de la causalité naturelle et la compréhension des activités des sciences humaines comme « création de formes transcendantales » selon diverses formes, la vision de laquelle surgissent différents « mondes » de la culture. Et enfin, la dernière étape est caractérisée par le développement de l'idée de vie, réalisée dans la retenue à travers les formes qu'elle crée elle-même. Au « niveau transvital », la philosophie de la vie se transforme en philosophie de la culture. Le mouvement de nouvelles formes culturelles émergentes sans cesse incarne une série de conflits : contenu et forme, « âme » et « esprit », cultures « subjectives » et « objectives ». La sociologie « formelle » fait partie intégrante du concept philosophique culturel et philosophique général de Simmel. Ses principaux concepts sont le « contenu » (buts, motifs, motivations des interactions humaines) et la « forme » (une manière universelle d'incarner et de mettre en œuvre des contenus historiquement variables), qui, en interaction, réalisent la société. La tâche de la sociologie « pure » est l'étude des formes, la tâche de la sociologie « philosophique » est l'analyse des destinées historiques de ces formes en relation avec des contenus culturellement déterminés. Oeuvres principales : "Philosophie des Geldes" (Lpz. , 1900), "Soziologie" (Lpz., 1908). "Schriften zur Soziologie" (Fr/M., 1983). Les ouvrages « Différenciation sociale : recherche sociologique et psychologique » ont été publiés en traduction russe. (M. 1909) ; « Le problème de la sociologie » (Saint-Pétersbourg, 1913). Décédé le 26 septembre 1918 à Strasbourg. Simmel considérait le sujet de la sociologie comme des formes d'interaction sociale entre les personnes qui restent inchangées malgré tous les changements dans le contenu historique spécifique. En même temps, le social est compris unilatéralement comme un ensemble de relations interindividuelles. Conformément à cette approche, Simmel a analysé la différenciation sociale, les formes sociales (accord, conflit, concurrence, autorité, subordination, etc.), les relations qui naissent au sein de petits groupes. Dans « La philosophie de l'argent », Simmel a donné une analyse socio-psychologique du rôle de l'argent dans le développement de diverses relations entre les personnes comme condition préalable au développement de la personnalité et de la liberté individuelle. La sociologie a été constituée par Simmel comme une méthode permettant d'isoler dans l'ensemble des phénomènes sociaux un nombre particulier de facteurs, les soi-disant formes de socialisation. L'identification de ces formes est suivie par leur ordonnancement, leur systématisation, leur justification psychologique et leur description dans la dimension historique et leur développement. Karl Marx (1818-1883) – philosophe, penseur social et économiste allemand. La principale contribution de Marx à la pensée sociologique était son analyse de la structure sociale de la société, directement basée sur la conviction que l'essence du processus historique est la lutte pour le contrôle de la propriété et de la richesse. Cette lutte est due à la division du travail, qui aboutit à la formation de classes aux intérêts opposés. La nature essentielle des classes change à différentes périodes de l’histoire en fonction du mode de production économique dominant. Ainsi, sous le capitalisme, il existe un conflit entre ceux dont le travail est utilisé pour créer de la richesse et les propriétaires des moyens de production. Selon Marx, dans toute période historique, les tensions entre groupes antagonistes sont la source du changement social. Cela explique pourquoi le capitalisme s’est formé au plus profond de la féodalité. Selon Marx, le socialisme finira par triompher du capitalisme. La lutte en tant que cause du changement social est l’essence de la théorie des conflits de Marx. La contribution de Marx au développement de la pensée sociologique, notamment dans le domaine de l'analyse des classes sociales et du changement social, reste importante aujourd'hui. Dilthey Wilhelm (1833-1911) – historien allemand de la culture et de la philosophie sociale. Représentant de la philosophie de la vie, créateur de ce qu'on appelle la psychologie compréhensive, qui a servi d'impulsion à la création d'une société compréhensive et de l'école de « l'histoire de l'esprit » (histoire des idées) dans l'histoire culturelle allemande de la fin du 19e – début du XXe siècle. Au cœur de Dilthey se trouve le concept de la vie en tant que mode d’existence humaine, réalité culturelle et historique. L'homme, selon Diltego, n'a pas d'histoire, mais il est lui-même l'histoire, qui seule révèle ce qu'il est. Dilthey sépare nettement le monde naturel du monde humain de l’histoire. La tâche de la philosophie (en tant que « science de l’esprit »), selon Dilthey, est de comprendre la « vie » basée sur elle-même. À cet égard, Dilthey propose la méthode de la « compréhension » comme compréhension directe d’une certaine intégrité spirituelle. Dilthey oppose la compréhension, qui s’apparente à une vision intuitive de la vie, à la méthode « d’explication » applicable dans les « sciences naturelles ». Comprendre son propre monde intérieur s'obtient par l'introspection (auto-observation), par la compréhension du monde d'autrui - par « s'habituer à », « ressentir » ; par rapport à la culture du passé, la compréhension agit comme une méthode d’interprétation, appelée herméneutique par Dilthey. (Dans ses travaux ultérieurs, Dilthey a abandonné l'introspection comme moyen psychologique de « comprendre ».) Dilthey, avec Rickert (et plus tard M. Weber), a développé le concept de types idéaux. Il a eu une influence significative sur le développement de la philosophie et de la sociologie du XXe siècle. – sur l'herméneutique philosophique, la sociologie historique, notamment sur M. Weber et en partie G. Simmel. Wundt Wilhelm (Wundt) - né le 16 août 1832 à Neckarau, Baden - psychologue, physiologiste, philosophe, linguiste allemand. Il est responsable du développement de la psychologie physiologique en tant que science spéciale qui utilise la méthode des expériences en laboratoire pour diviser la conscience en éléments et clarifier la connexion naturelle entre eux. Le premier laboratoire de psychologie au monde, qu'il crée en 1879, devient un centre international de psychologie expérimentale. Il étudiait les sensations, le temps de réaction, les associations, l'attention, les sentiments. Wundt considérait que le sujet de la psychologie était l'expérience directe - des phénomènes ou des faits de conscience accessibles à l'introspection ; cependant, les processus mentaux supérieurs (parole, pensée, volonté), selon Wundt, sont inaccessibles à l'expérimentation, et il propose de les étudier en utilisant la méthode historico-culturelle. Il se tenait sur la position du parallélisme psychophysique. Dans le domaine de la conscience, une causalité mentale particulière opère et le comportement est déterminé par l'aperception. Wundt a entrepris l'expérience de l'interprétation psychologique des mythes, de la religion, de l'art et d'autres phénomènes culturels dans la « Psychologie des peuples » en 10 volumes (« Volkerpsychologie », 1900-1920). ). Wundt a défini le langage comme l'une des formes de manifestation de la « volonté collective » ou de « l'esprit populaire ». À cette compréhension du langage en tant que processus dynamique est associée l’identification de l’activité linguistique, plutôt que du système linguistique, comme objet principal de la linguistique. Ses principaux ouvrages en traduction russe comprennent également : « Principaux traits de l'histoire psychologique du développement humain », « Fondements de la psychologie physiologique » (1880-1881), « Conférences sur l'âme de l'homme et des animaux » (1894), « Système de philosophie » (1902), « Essais sur la psychologie » (1912), « Introduction à la psychologie » (1912), « Sciences naturelles et psychologie » (1914). Il décède le 31 août 1920 à Grosbothen, près de Leipzig. Ludwig Gumplowicz (1838-1909) – sociologue et juriste polono-autrichien. Né à Cracovie. Depuis 1882 - Professeur de droit administratif d'État à l'Université de Graz (Autriche). Auteur d'ouvrages scientifiques sur la théorie et l'histoire de la sociologie, la jurisprudence, les questions de droit autrichien et l'histoire de l'éducation en Autriche-Hongrie. Représentant du monisme de la sociologie. Il partageait la position du darwinisme social et considérait les lois sociales comme une forme de manifestation des lois de la nature. Les dispositions les plus importantes de la sociologie de Gumplowicz : le sujet de la sociologie sont les groupes sociaux et leurs relations ; les concepts fondamentaux de la sociologie « race » et « ethnocentrisme » ; le point de départ de la sociologie est la théorie du polygénisme (origines multiples du genre humain) ; un facteur universel de développement social est la lutte constante entre les groupes. À la suite de la lutte entre les hordes primitives, croit Gumplowicz, un État est né, et à partir de ce moment la lutte prend deux formes : interétatique et intraétatique (c'est-à-dire entre groupes, classes, domaines, partis politiques). L’État est l’organisation du pouvoir de la majorité sur la minorité. La famille, la propriété, le droit sont des produits de l'État. Tout droit est un ordre d’inégalité. Dans sa compréhension du processus historique, il attribue un rôle primordial au facteur politique ; il estime que la société dans son développement passe par des étapes de formation, de prospérité et de mort. Le point de vue de Gumplowicz sur l'alternative à l'humanité : l'organisation de la domination basée sur l'inégalité (sous la forme de l'État) ou l'anarchie, insupportable pour l'humanité culturelle. Décédé à Graz. Les œuvres les plus importantes de Gumplowicz : « Race and Staat » (1875) ; « Das Recht des Nationalitat et Sprachen in Osterreich-Ungarn » (1879) ; "Rechtsstaat u. Socialisme" (1881); « Der Rasenkampf » (1883) (traduction russe : « La lutte des races. » 1883) ; "Griindniss der Sozilogie" (1885) (russe) Trad. : « Fondements de la sociologie ». 1899); "La Soziologische Staatsidee (1892)". L. Gumplowicz considérait les groupes sociaux comme le sujet de la sociologie et la lutte continue et impitoyable entre eux comme le facteur principal de la vie sociale. Selon Gumplowicz, la base des processus sociaux en général réside dans le désir d’une personne de satisfaire ses besoins matériels. À l’aube de l’histoire, l’inimitié caractérisait les relations entre des hordes divisées selon des critères raciaux et ethniques. À la suite de l'asservissement d'une horde par une autre, naît un État dans lequel la lutte entre les hordes cède la place à la lutte entre les domaines, les classes, etc., ainsi qu'entre les États. Gumplowicz considérait la société comme une réalité supra-individuelle. Le naturalisme, dans sa compréhension de la société, est étroitement lié à une interprétation fataliste des lois sociales et à une fétichisation de la nécessité historique. Gumplowicz a nié l'existence du progrès social, interprétant le développement social comme un cycle dans lequel chaque société passe par des étapes de formation, de prospérité et de mort. Dans son ouvrage « The Racial Struggle », Gumplowicz a introduit le concept d’« ethnocentrisme », qui a ensuite été développé par Sumner et est entré dans l’appareil conceptuel de la sociologie. Le naturalisme et le matérialisme vulgaire inhérents aux concepts de Gumplowicz sont rejetés dans la plupart des théories sociologiques modernes. Le Bon Gustave (Le Bon) (1841-1931) - Sociologue français, psychologue social, publiciste, auteur de nombreux ouvrages sur la physique et la chimie, docteur en médecine, né à Nogent-le-Rotrou. Il a voyagé à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie, où il a écrit plus de la moitié de ses ouvrages, principalement sur l'anthropologie et l'archéologie. Le dernier d'entre eux - «Les monuments de l'Inde» - fut publié en 1893 à l'âge de 52 ans. Ce n'est qu'après cela qu'il s'intéressa à la psychologie sociale, qui le rendit plus tard célèbre. Les œuvres les plus célèbres sont « Psychologie des Nations » (1894) et « La Foule » (1895). De plus, il a créé un concept philosophique naturel proche de l'énergisme « L'évolution de la matière » (1909). Le Bon a défendu l'idée d'un déterminisme racial dans le développement de la civilisation. Comme fondement de l'évolution sociale, il ne considérait pas l'esprit, mais la sphère émotionnelle irrationnelle-volontaire de la vie mentale - les sentiments et les croyances. De ce point de vue, la psychologie est la base de la connaissance de l’histoire. Le Bon est l'auteur d'une des premières versions de la doctrine de la « société de masse ». Considérant la masse (foule) comme une force destructrice irrationnelle, Le Bon croyait que la civilisation doit toutes ses réalisations aux activités de l'élite et s'opposait à l'idée d'égalité sociale et de socialisme. Selon son concept, le comportement d'un individu dans une foule est inconscient et irrationnel ; il se caractérise par l'intolérance, le dogmatisme, la perte du sens des responsabilités, une émotivité accrue et un primitivisme mental. Au cœur de tout changement social se trouve un changement dans les idées inculquées aux masses par quelques dirigeants par l’affirmation, la répétition et la contagion. Il considérait les révolutions comme des manifestations d’hystérie de masse. Fin XIX - début XX siècles. Le Bon l’a caractérisé comme le début de « l’ère des masses » et a prédit à cet égard le déclin inévitable de la civilisation. Les idées de Le Bon ont influencé le développement de la psychologie sociale, ainsi que les doctrines de la « société de masse » qui se sont répandues dans la sociologie occidentale. Mort à Paris. Le Bon a également traité de questions d'anthropologie, d'archéologie et de sciences naturelles. Il a proposé l'une des premières versions de la théorie de la société de masse. Du point de vue de l'élitisme aristocratique, il s'oppose à l'idée d'égalité sociale et cherche à prouver l'inégalité des différentes races. En identifiant les masses avec la foule, il préfigurait l’avènement de « l’ère des masses » et le déclin de la civilisation qui en découle. Le Bon divise la foule en « hétérogènes » (rue, réunions parlementaires, etc.) et « homogènes » (sectes, classes, castes). Considérant la masse (la foule) comme une force destructrice irrationnelle, il a souligné le caractère inconscient et émotionnel du comportement des individus dans la foule, qui est ici régi par la loi de « l’unité spirituelle de la foule ». Selon Le Bon, le comportement d'un individu dans une foule change radicalement : il est envahi par un sentiment de force irrésistible, d'intolérance et le sens des responsabilités est perdu. Il attribuait le rôle principal dans le développement social aux changements d’idées inculqués aux masses par quelques « dirigeants » par l’affirmation, la répétition et l’infection. Le Bon considérait les révolutions comme une manifestation de l’hystérie de masse. Tarde Gabriel (Tarde) (1843-1904) - Sociologue français, représentant du courant psychologique en sociologie, l'un des fondateurs de la psychologie sociale, auteur de nombreux ouvrages sur la philosophie du droit. Né à Sarly, diplômé en droit en 1869-1894. était en service juridique à Sarli. À partir de 1894, il vécut à Paris, où il dirigea le département des statistiques criminelles du ministère de la Justice et enseigna la philosophie moderne dans les établissements d'enseignement. En 1900, il fut élu membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Principaux ouvrages : « Lois sociales », « Lois de l'imitation », « Opposition mondiale », Logique sociale. » Le point de départ de la théorie sociologique de Tarde est l'interprétation de la socialité comme imitation, qui est une manifestation de la loi fondamentale de toutes choses - répétition universelle. La société est en fin de compte une imitation. Tarde associe la possibilité d'une évolution sociale aux écarts par rapport à la stricte répétition, à l'innovation, c'est-à-dire actes de créativité individuelle, inventions. L'imitation reprend ce qui n'était à l'origine qu'une déviation, et ainsi s'effectue l'évolution de la société. Tarde développa plus tard une théorie des conflits sociaux entre individus ayant des idées et des inventions différentes. Contrairement à Durkheim, Tarde donnait la priorité à l'étude de l'individu plutôt qu'à celle des groupes ou des organisations, et considérait la société comme le produit de l'interaction de créatures individuelles à travers la transmission et l'assimilation de croyances et de désirs. Sur cette base, il pensait qu'il était nécessaire de créer une science - la psychologie sociale, qui devrait explorer l'interaction des consciences individuelles et devenir le fondement de la sociologie. Tarde a apporté une contribution significative à l'étude des mécanismes des relations interpersonnelles, a développé des problèmes d'opinion publique, de psychologie des foules, a étudié les mécanismes d'infection et de suggestion psychologiques ; contribué à l'inclusion de méthodes empiriques dans l'arsenal de la sociologie - analyse de documents historiques et de données statistiques. Les idées sociologiques de Tarde ont influencé E. Ross, C. Ellwood, D. Baldwin, C. Cooley, D. Dewey. Ses concepts ont influencé les théories de la « société de masse », les études sur la communication de masse et la diffusion des innovations. Mort à Paris. Tarde comparait la société à un cerveau dont la cellule est le cerveau de l'individu. Il considérait la conscience collective comme une fonction des consciences individuelles, voyait dans la psychologie la clé pour comprendre les phénomènes sociaux et tentait de jeter les bases d'une psychologie sociale ou collective (interpsychologie), qui traite exclusivement de la relation de notre Je avec les autres Je et de leurs influences mutuelles. . Tarde expliquait la vie sociale et ses processus par l'action de mécanismes mentaux simples. Tarde considérait comme un fait social élémentaire l'état mental d'un individu provoqué par l'influence d'un autre individu. Cette condition est explorée par la psychologie intermentale, que Tarde appelle sociologie. Selon Tarde, la première condition des faits sociaux est l’invention – les actes de créativité qui créent le langage, le gouvernement, la religion, etc. Une autre tendance est le désir d'imiter (nouvelles inventions - nouvelles vagues d'imitation). Tarde attachait une importance particulière à l'influence des moyens de communication tels que le téléphone, le télégraphe et surtout les journaux. Distinguant la psychologie de l'individu de la psychologie de la foule, Tarde a identifié un maillon intermédiaire : le public, qui se forme à l'aide des communications de masse et a une conscience générale de soi. Les concepts de Tarde ont influencé les théories de la « société de masse », les études sur la communication de masse et la diffusion des innovations. Pareto Vilfredo (Pareto) (né le 15 juillet 1848 à Paris) est un économiste et sociologue italien. L'essence de sa méthodologie est de critiquer les jugements et concepts métaphysiques a priori en sociologie, de les réduire à une connaissance empirique de la société, basée sur la description des faits et la formulation de lois exprimant des dépendances fonctionnelles entre les faits. Il a postulé une expression mathématique de ces dépendances. Le point de départ de la théorie sociologique de Pareto est le concept d'action illogique, selon lequel le comportement humain est irrationnel et illogique, ce qui se manifeste clairement au cours de l'histoire. Toutes les théories et idéologies justifient une action et visent à donner à cette dernière un caractère extérieurement logique, cachant ses véritables motivations. Pareto utilise le terme « dérivés » pour signifier qu'il existe des calculs et des explications que les gens font après coup pour prouver le naturel, la logique, l'équité et le caractère raisonnable de leurs actions. Il a qualifié les systèmes idéologiques qui ont de faux contenus de « dérivations », c'est-à-dire dérivés de sentiments (qu’il appelait « résidus »), enracinés dans les couches irrationnelles de la psyché humaine. Ce sont des impulsions biologiques internes qui déterminent le comportement social humain. À l’aide de six classes principales de « résidus », divisées en de nombreux sous-groupes, Pareto a tenté d’expliquer les nombreuses variations du comportement humain. S'appuyant sur le rôle fondamental des sphères de la psyché humaine, il en a tiré des théories sur l'idéologie, la stratification sociale et le changement des élites dirigeantes. Pareto, bien qu’il oppose les « dérivations » à la vérité, a souligné leur signification sociale, leur valeur pour la société dans son ensemble et pour les individus agissant individuellement. Il considérait la société comme un système dans un état d’équilibre dynamique et attachait une importance déterminante aux « vestiges » qui sous-tendent à la fois les « dérivations » et la division de la société en élites et non-élites. L'hétérogénéité sociale était justifiée biologiquement par la présence de certaines qualités biopsychologiques chez les individus. Il considérait la division entre une élite capable de gouverner et une non-élite comme une caractéristique essentielle de toutes les sociétés humaines, et du « cercle » des élites, c'est-à-dire leur stabilisation et leur dégradation - le moteur du développement social qui sous-tend les événements historiques. Le processus de circulation des élites reflète des processus sociaux fondamentaux profonds et, surtout, socio-économiques. Les changements politiques reflètent l'incapacité des groupes au pouvoir à résoudre les problèmes socio-économiques. Les ouvrages fondamentaux de Pareto sont : « Cours d'économie politique » (1896-1897), « Manuel d'économie politique » (1906), Traité de sociologie générale (1916), « Transformation de la démocratie » (1921). Pareto est mort le 20 août. 1923. Seligny, Suisse. Ses travaux n'ont pas été publiés en russe. L'élément principal de la théorie sociologique de Pareto est la théorie de l'action illogique. Dans sa théorie, Pareto a souligné la nature irrationnelle et illogique du comportement humain. Les actions humaines qui composent l'histoire appartiennent à un certain nombre d'actions non logiques. Un individu agit d'une certaine manière parce qu'il a des prédispositions mentales et éprouve des sentiments qui le poussent à se comporter d'une certaine manière. Ces sentiments sont masqués à l'aide de pseudo. -arguments qui constituent le contenu de toutes les théories sociales. Pareto a soutenu que les fonctions sociales de l'idéologie sont basées sur la création de modèles logiques (pseudologiques) de justification d'actions illogiques dans lesquelles les moyens ne correspondent pas aux fins (comme les politiques). doctrines, concepts religieux, etc.). Pareto a créé une théorie biologique des élites, selon laquelle toutes les sociétés humaines sont divisées en une élite (les meilleurs ayant la capacité de gérer la société) et une non-élite. La stabilisation puis la dégradation des élites, de leur « cercle », constituent le moteur du développement social et la base fondamentale de tous les événements historiques. Selon Pareto, les individus dotés de « résidus » spéciaux innés sont capables de manipuler les masses par la ruse, la tromperie ou la violence. Si l’élite ne coopte pas dans ses rangs de nouveaux membres issus des classes inférieures qui disposent des « restes » correspondants, alors une révolution commence (le sens de la révolution, selon Pareto, est de mettre à jour la composition personnelle de l’élite dirigeante). ). Giddings Franklin Henry (Giddings) (né le 23 mars 1855 dans le Connecticut, États-Unis) - Sociologue américain, fut président de l'American Sociological Society (1908). En 1894, il fut le premier aux États-Unis à recevoir le poste de « professeur titulaire » de sociologie à l'Université de Columbia. Au début de sa carrière scientifique, il a aligné ses vues sur l'évolutionnisme psychologique, qui était l'une des orientations de la sociologie psychologique. Selon Giddings, la société est un organisme physique et mental, un type particulier d'organisation, en partie un produit de l'inconscient. évolution, en partie le résultat d’un plan conscient. Lors de l'analyse de la société, la sociologie doit combiner l'étude des facteurs subjectifs-psychologiques et objectifs-naturels. Considérant la « conscience de l’espèce » (conscience collective) comme un élément fondamental de la vie sociale, Giddings utilise ce concept avec le terme « esprit social ». Dans sa conception de l'existence de la « structure sociale », il nomme trois classes : les « classes de vie », les « classes personnelles », les « classes sociales », et pour expliquer l'évolution de l'organisation sociale, il utilise la thèse sur le développement de la société à partir de « association zoogénique » aux « associations démogéniques » modernes. À la fin de son activité, à partir des années 20, Giddings est devenu l'un des promoteurs les plus actifs des nouveaux concepts du positivisme et de la méthode statistique de recherche et a eu une influence significative sur la formation de la sociologie empirique aux États-Unis. Dans le même temps, son interprétation du sujet de la sociologie, qui étudie le « comportement pluraliste », interprété au sens behavioriste - comme un ensemble de réactions d'individus à des stimuli environnementaux, a également changé. Les principaux ouvrages de Giddings sont : « Fondements de la sociologie (analyse des phénomènes d'association et d'organisation sociale) », publié en traduction russe (Kiev-Kharkov, 1898), ainsi que « Études sur la théorie de la société humaine » (N.Y. 1924). . Giddings est décédé le 11 juin 1931 à New York. Tennys Ferdinand (Tunnies) - né le 26/07/1855, ville de Pun, Schleswig - Allemand, sociologue et historien de la philosophie. L'un des fondateurs de la sociologie en Allemagne et fondateurs de la Société sociologique allemande, son président (1909-1933), fondateur et président de la Société Hobbesienne. Depuis 1909 - professeur extraordinaire, depuis 1913 - professeur ordinaire à l'Université de Kiel. La sociologie du tennis est l’une des premières expériences de construction d’un système de catégories formelles et « pures » de sociologie, permettant d’analyser tout phénomène social passé et présent, ainsi que les tendances du changement social. Il divise la sociologie en « générale » et « spéciale ». Il n'examine pas le premier en détail ; il doit étudier toutes les normes de coexistence des personnes communes aux formes de vie sociale des animaux. La seconde, divisée en « pure » (théorique), « appliquée » et « empirique » (sociographie), étudie la vie sociale elle-même. Le social lui-même surgit lorsque les personnes coexistantes sont dans un état d’« affirmation mutuelle ». Le tennis met la volonté à la base de la communication sociale (il fut le premier à inventer le terme de « volontarisme »). Le type de testament détermine le type de connexion. La typologie de la volonté qui s'affirme mutuellement a été développée en détail dans son ouvrage principal, Communauté et société (1897). Il distingue entre la volonté, puisqu'elle contient de la pensée, et la pensée, puisqu'elle contient de la volonté. Le tennis ajoute les notions de « concept social de statut » et de « contrat » (accord). Ces oppositions permettent non seulement de construire un vaste système de catégories sociologiques « pures », mais aussi d'envisager sous cet angle le processus et le sens des changements historiques, ce qui devient la tâche de la 2e partie de sa « sociologie spéciale » - appliquée sociologie. L’idée principale est que la socialité à prédominance « communautaire » est de plus en plus remplacée par la socialité « publique » au cours de l’histoire. De là s’ouvrait la voie à l’analyse du droit, de la famille, de la morale, de l’économie, de la vie villageoise et urbaine, de la religion, de la politique, de l’opinion publique et de l’État. Au fil du temps, il a compliqué le schéma proposé dans l'ouvrage nommé, y compris dans ses caractéristiques : la densité des liens sociaux, le nombre de participants, le caractère fraternel par opposition aux relations de domination et de subordination. Ce schéma est présenté intégralement dans l'un des derniers ouvrages : « Introduction à la sociologie » (1931). Tennis était également largement connu comme sociologue empirique, organisateur de grandes enquêtes statistiques et sociographiques. Décédé le 11/04/1936 à Kiel, Allemagne. Freud Sigmund (1856-1939) - neurologue, psychiatre et psychologue autrichien, est né dans la ville morave de Fribourg. À l'âge de dix-sept ans, il obtient son diplôme d'études secondaires avec mention et entre à l'Université de Vienne. Il s'intéressait particulièrement aux sciences naturelles, dont les réalisations jetèrent les bases des connaissances modernes sur le corps et la nature vivante. Les premiers travaux de Freud étaient consacrés à la physiologie et à l'anatomie du cerveau - son professeur était le physiologiste Ernst Brücke, de renommée européenne. Sous l'influence de représentants de « l'école française », tels que Charcot et Bernheim, Freud s'est occupé dès la fin des années 80 des problèmes des névroses et, à partir du milieu des années 90, il a commencé à développer la psychanalyse - une méthode psychothérapeutique de traitement des névroses basée sur la technique des associations libres et analyse des « actions erronées » et des rêves comme moyen de pénétrer dans l’inconscient. Dans ses travaux, Freud s'est appuyé sur l'expérience pratique acquise en clinique, où il est arrivé après plusieurs années de travail dans un laboratoire de physiologie, maîtrisant les idées théoriques de la physiologie avancée. Freud fut l'un des premiers à étudier les aspects mentaux de la sexualité. Dans les années 1900, il a proposé une théorie psychologique générale de la structure de l'appareil mental en tant que système énergétique, dont la dynamique repose sur le conflit entre la conscience et les pulsions inconscientes. Freud a essayé d'appliquer la psychanalyse à l'étude des problèmes les plus importants de la religion, de la morale, de l'histoire sociale et de la culture humaine. C'est le sujet de ses ouvrages « Totem et tabou » (1913), « Psychologie des masses et analyse du soi humain » (1921), « L'avenir d'une illusion » (1927), « Insatisfaction à l'égard de la culture » (1930). ). Dans les années vingt - la doctrine des caractéristiques psychologiques de l'individu - l'ouvrage "Je et cela" (1923). Freud a utilisé le concept de « sublimation » comme élément central de l’interprétation psychologique de la culture, qui est un compromis inévitable entre réalité et pulsions spontanées. L'évolution idéologique des vues de Freud est passée du « matérialisme physiologique » à l'autonomie du psychisme et aux constructions anthropologiques proches des variétés naturalistes de la « philosophie de la vie ». Les idées de Freud ont influencé divers domaines de la philosophie occidentale, de la sociologie, de la psychologie sociale, de la littérature et de l'art. Sigmund Freud est mort à Hampstead, près de Londres. Fromm Erich (1900-1980) – sociologue, psychologue et philosophe social germano-américain, représentant de l'école de Francfort. Selon Fromm, l'histoire est le développement de l'essence humaine dans les conditions d'une structure sociale qui lui est hostile. Sur cette base, Fromm a développé la doctrine des caractères sociaux comme forme de lien entre le psychisme de l'individu et la structure sociale de la société. Pour Fromm, chaque étape du développement de l'aliénation de soi humaine sous l'influence de la structure sociale correspond à un certain caractère social - accumulatif, exploiteur, réceptif (passif), marchand. La société moderne était considérée par Fromm comme une étape d’aliénation de l’essence humaine à travers la « machinisation », « l’informatisation » et la « robotisation » de l’homme au cours de la révolution scientifique et technologique. Cela détermine l'antitechnicisme prononcé de Fromm. La particularité des vues de Fromm est une attitude critique à l’égard de la société capitaliste en tant que société qui pousse à l’extrême le processus d’auto-aliénation de l’individu. Cooley Charles Horton (1864-1929) - l'un des fondateurs de la sociologie classique américaine, psychologue. Cooley est connu comme le fondateur de la théorie du soi miroir et de la théorie des petits groupes. C. Cooley est diplômé de l'Université du Michigan, où il a ensuite enseigné tout au long de sa vie. Les principaux travaux théoriques de Cooley comprennent ses livres fondateurs Human Nature and Social Order (1902), Social Organization (1909) et Social Process (1918). En ce qui concerne la société, Cooley partait de deux prémisses principales. Premièrement, la société est avant tout un processus de changement constant. Deuxièmement, le changement social s’enracine dans les changements de la conscience individuelle et sociale et se reflète dans le comportement collectif. De plus, toutes les composantes de « l'organisme » social (groupes, individus, organisations) interagissent étroitement les unes avec les autres selon certains principes. Individuel et collectif (social), selon Cooley, appartiennent à une seule intégrité - la « grande conscience ». C'est cela qui garantit l'interdépendance de tous les processus se produisant dans la société. Pour désigner cette intégrité, Cooley propose d’utiliser le terme « vie humaine », dont l’introduction place le sociologue américain dans une certaine dépendance génétique à l’égard de la « philosophie de la vie », ainsi que du pragmatisme américain. L'introduction de l'individu au général commence dans le groupe primaire, ce qui ouvre la voie au processus de socialisation. Cooley a examiné en détail les différentes étapes de la socialisation : le sentiment de soi, les états d'âme, l'imagination. Par ailleurs, la socialisation est « mesurée » par un sociologue en considérant l’émergence d’« images » dans la conscience. Plus tard, les « images » se transforment en « sentiments sociaux », c'est-à-dire en modèles et normes de comportement socialement renforcés et fondés sur le symbolisme de significations générales. Suivant la tradition méthodologique interactionniste générale de la pensée sociale américaine, Cooley a soutenu que le « social » lui-même naît uniquement dans la communication, la communication et l’interaction des sujets d’action. En développant ces principes bien connus, Cooley a développé le concept de « réflexion dans la réflexion » sociale, qui connaît un certain nombre de versions et de formulations terminologiques. Cooley parlait alors de « l’imagination des imaginations », c’est-à-dire du fait que la perception même d’un sujet dépend entièrement de la manière dont les autres le perçoivent. En d’autres termes, l’essence sociale d’une personne est déterminée par son « fonctionnement » dans l’environnement social qui la façonne. Cette théorie de Cooley est entrée dans l’histoire de la sociologie sous le nom de théorie du « miroir de soi ». Le fait est que dans la société, une personne se regarde constamment dans un « miroir » qui est représenté par d'autres personnes - leurs opinions, leur comportement, leurs réactions. Le sujet commence inconsciemment à se concentrer sur ces reflets miroir et à se construire en fonction de ces reflets. Une telle orientation vers les « réflexions », selon Cooley, passe par trois étapes dans sa formation. 1. Construisez votre propre apparence dans votre imagination. Une personne planifie son image extérieure ; il imagine à quoi il ressemble de l'extérieur, il façonne son apparence. Cela s’applique particulièrement aux soi-disant « proches », c’est-à-dire à ceux dont les opinions comptent pour le sujet. 2. Interpréter les réactions des autres. Une personne analyse comment les « autres » réagissent à son égard et si sa perception subjective d'elle-même coïncide avec la perception d'elle par les autres. 3. Construire votre propre image. En combinant la motivation initiale avec les réactions des « autres », une personne se forme sa propre image, qui détermine son comportement social. Les opinions de Cooley ont grandement influencé l'école de Chicago et la sociologie de J.G. Mida. Cooley a introduit la distinction entre groupes primaires (le terme lui-même lui appartient) et institutions sociales secondaires. Les groupes primaires (famille, quartier, groupes d'enfants, communautés locales) sont, selon Cooley, les principales unités sociales et se caractérisent par des liens intimes et personnels, une communication directe, une stabilité et un petit nombre. C'est ici que se produit la socialisation, la formation d'une personnalité qui, au cours de l'interaction, acquiert des valeurs et des normes sociales fondamentales, ainsi que des méthodes d'activité. Cooley a caractérisé la personnalité comme la somme des réactions mentales d’une personne aux opinions des gens qui l’entourent (la théorie du « moi miroir »). Tout en notant à juste titre certaines caractéristiques essentielles de la socialisation et de la formation de la conscience de soi d’une personne, Cooley les réduisait en même temps à tort à l’interaction directe des individus. Les institutions sociales secondaires (partis, classes, nations), selon Cooley, forment une structure sociale où se développent des relations impersonnelles (l'individu formé n'est que partiellement impliqué dans ces relations impersonnelles en tant que porteur d'une certaine fonction). La sociologie de Cooley a influencé le développement de concepts interactionnistes, de théories de psychologie sociale et de théories reliant les éléments de l'organisme et l'interactionnisme (Chicago School of Social Ecology). Sorokin Pitirim Alexandrovitch (1889-1968) – sociologue russo-américain. Leader de l'aile droite du Parti socialiste révolutionnaire. En 1922, il fut expulsé d’URSS. Depuis 1923, il vivait aux États-Unis. Au cœur du concept idéaliste de Sorokin se trouve l’idée de la priorité d’un système superorganique de valeurs, de significations, de « systèmes culturels purs », dont les porteurs sont des individus et des institutions. Le processus historique, selon Sorokin, est une fluctuation cyclique de types de culture, dont chacun est une intégrité spécifique et repose sur plusieurs prémisses principales (une idée sur la nature de la réalité, les méthodes pour la connaître). Sorokin identifie trois principaux types de culture : sensuelle (sensuelle) - elle est dominée par la perception sensorielle directe de la réalité ; idéaliste, dans lequel la pensée rationnelle prédomine ; idéaliste (idéaliste) – le type de connaissance intuitive domine ici. Chaque système de « vérités » s’incarne dans le droit, l’art, la philosophie, la science, la religion et la structure des relations sociales, dont les transformations et les changements radicaux se produisent à la suite des guerres, des révolutions et des crises. Sorokin a associé la crise de la culture « sensuelle » moderne au développement du matérialisme et de la science, et a vu une issue à cette situation dans la victoire future de la culture religieuse « idéaliste ». Sorokin est l'un des fondateurs (ancêtres) des théories de la mobilité sociale et de la stratification sociale. La doctrine de la sociologie « intégrale » développée par Sorokin (englobant tous les aspects sociologiques de la culture) a eu une influence significative sur la sociologie moderne. Mosca Gaetano (1858-1941) – sociologue et politologue italien, l'un des fondateurs du concept moderne d'élite. Mosca a développé l'idée de la nécessité et de l'éternité de diviser chaque société, quelles que soient les formes d'État, les groupes sociaux et les « formules politiques » en deux classes : la « classe politique », c'est-à-dire l’élite dirigeante et la majorité non organisée, la classe contrôlée. En étudiant l'anatomie et la dynamique des élites, Mosca est arrivé à la conclusion que sans leur renouvellement, la stabilité sociale, qui est la base de la société, est impossible. Dans le même temps, toute élite dirigeante tend à devenir « fermée », héréditaire, ce qui conduit inévitablement à sa dégénérescence. De tels processus ne peuvent être empêchés que par la présence de libertés, notamment de discussions libres, qui obligent la « classe politique » à se renouveler, permettent de la maintenir dans certaines limites et de l’éliminer lorsqu’elle ne correspond plus aux intérêts du pays. Moreno Jacob (Jacob) Levy (1892-1974) - psychologue social américain, psychiatre, fondateur de la sociométrie. Depuis 1940, il dirige l'Institut de sociométrie et de psychodrame (Institut Moreno), qu'il a fondé. Moreno est parti du fait qu'en plus de la macrostructure de la société étudiée par la sociologie, il existe une macrostructure informelle interne formée par l'imbrication des pulsions, des attractions et des répulsions individuelles. S’appuyant sur la psychanalyse et la psychologie Gestalt, Moreno pensait que la santé mentale d’une personne est déterminée par sa position dans un petit groupe, dans un système de pulsions interindividuelles, d’aimer et d’aversion. Les procédures de sociométrie (test sociométrique, etc.) permettent d'identifier des liens émotionnels invisibles entre les personnes, de les mesurer et d'enregistrer les résultats dans des matrices, indices et graphiques spéciaux (par exemple, dans un sociogramme). Parsons Talcott (1902-1979) - Sociologue américain, créateur de l'orientation structurelle-fonctionnelle de la théorie sociale. Il a étudié à la London School of Economics de l'Université de Heidelberg. Il a enseigné la sociologie à Harvard. Il a été président de l'American Sociological Association et de l'American Academy of Arts and Sciences. Ouvrages majeurs : « La structure de l'action sociale » (1937), « Le système social » (1951), « Économie et société » (1957), « Sociétés : perspectives évolutives et comparées » (1966), « Le système des sociétés modernes » (1971), « L'action sociale et la condition humaine » (1978). Parsons a tenté de créer une théorie globale de l'action sociale qui couvrirait toute la réalité sociale et tous les types d'activités sociales des personnes. Il s’est appuyé sur les idées de Durkheim, de Pareto et de la théorie de l’action de Weber. Il considérait que la caractéristique la plus essentielle de l’action sociale était son orientation normative. SECTION 2 Qu'est-ce que la sociologie et qu'étudie-t-elle O. Comte L'ESPRIT DE PHILOSOPHIE POSITIVE * * O. Comte L'esprit de philosophie positive. Saint-Pétersbourg, 1910. UN MOT SUR LA PENSÉE POSITIVE SUJET DE CE « MOT » 1. L'ensemble des connaissances astronomiques, jugées jusqu'ici trop isolées, ne devrait désormais laisser plus qu'un des éléments nécessaires d'un nouveau système indivisible de philosophie générale, progressivement préparé au cours des trois derniers siècles, une convergence évidente des résultats de tous les grands travaux scientifiques pour finalement, dans son abstraction, atteindre une véritable maturité. En raison de cette relation étroite encore extrêmement mal comprise, l'essence et le but de ce traité ne pourraient être suffisamment appréciés si ce mot préliminaire nécessaire n'était pas consacré en premier lieu à la définition appropriée du véritable esprit fondamental de cette philosophie, dont l'établissement mondial devrait être l’objectif principal de l’enseignement positif. Puisqu'il se distingue principalement par la prédominance constante, à la fois logique et scientifique, du point de vue historique ou social, je dois d'abord, pour mieux le caractériser, rappeler brièvement la grande loi, qui dans mon Système de positive philosophie que j'ai établie, sur l'évolution intellectuelle complète de l'humanité, loi qui d'ailleurs sera par la suite fréquemment appliquée dans nos recherches astronomiques. Partie I LA SUPÉRIORITÉ DE LA PENSÉE POSITIVE Chapitre premier LA LOI DE L'ÉVOLUTION INTELLECTUELLE DE L'HUMANITÉ, OU LA LOI DES TROIS ÉTAPES 2. Selon ma doctrine fondamentale, toutes nos spéculations, tant individuelles que génériques, doivent inévitablement passer successivement par trois étapes théoriques différentes , qui peut être ici suffisamment défini par les noms usuels : théologique, métaphysique et scientifique, du moins pour ceux qui comprendront bien leur véritable sens général. La première étape, bien qu'au début nécessaire à tous égards, doit désormais toujours être considérée comme purement préliminaire ; la seconde n'est en fait qu'une modification à caractère destructeur, n'ayant qu'un but temporaire : conduire progressivement à la troisième ; C’est précisément à ce dernier stade, le seul tout à fait normal, que la structure de la pensée humaine est au sens plein du terme définitive. 1. STADE THÉOLOGIQUE OU FICTIONNEL 3. Dans leur manifestation initiale, inévitablement théologique, toutes nos spéculations elles-mêmes expriment une préférence caractéristique pour les questions les plus insolubles, les plus inaccessibles à toute étude exhaustive du sujet. En vertu d'un contraste qui à notre époque doit paraître inexplicable à première vue, mais qui en fait était alors en parfaite harmonie avec l'état véritablement infantile de notre esprit, l'esprit humain, à une époque où il était encore incapable de résoudre les problèmes les plus simples. problèmes scientifiques, cherche avidement et presque exclusivement le début de toutes choses, s'efforce de trouver soit la cause initiale, soit la finale, les causes principales des divers phénomènes qui le frappent et la voie principale de leur apparition, en un mot, s'efforce d'obtenir une connaissance absolue. Cette capacité primitive est naturellement satisfaite, dans la mesure où un tel état l'exige, et même dans la mesure où elle pourra jamais être réellement satisfaite, grâce à notre éternel désir de tout revêtir d'images humaines, assimilant tous les phénomènes que nous observons à ceux que nous observons. que nous produisons et qui, de ce fait, commencent à nous paraître, grâce à l'intuition immédiate qui les accompagne, bien connues. Pour mieux comprendre l'esprit purement théologique, qui est le résultat du développement de plus en plus systématique de cet état primitif, il n'est pas nécessaire de se limiter à l'examiner dans la dernière phase, qui se termine sous nos yeux parmi les plus avancés. peuples, mais semble loin d'être la plus caractéristique - il est nécessaire de porter un regard véritablement philosophique sur l'ensemble de son parcours naturel afin d'évaluer son identité fondamentale dans les trois formes principales qui en sont systématiquement caractéristiques. 4. La phase la plus immédiate et la plus prononcée est le fétichisme proprement dit, qui consiste principalement dans l'attribution d'une vie à tous les corps extérieurs, essentiellement semblables au nôtre, mais presque toujours plus énergiques en raison de leur action habituellement plus forte. Le culte des corps célestes caractérise le stade le plus élevé de ce premier stade théologique, d'abord à peine différent de l'état mental auquel s'arrêtent les races supérieures d'animaux. Bien que cette première forme de philosophie théologique apparaisse constamment et successivement dans l'histoire intellectuelle de toutes nos sociétés, elle ne domine désormais directement que parmi la plus petite des trois grandes races qui composent le genre humain. 5. Dans sa deuxième phase principale, la pensée théologique, se déversant dans le polythéisme réel, très souvent confondu par les peuples modernes avec l'étape précédente, représente clairement la libre prédominance spéculative de l'imagination, alors qu'auparavant l'instinct et les sentiments prédominaient dans les théories humaines. La philosophie originelle dans cet état subit la transformation la plus profonde à laquelle la totalité de son objectif réel est accessible - une transformation exprimée dans le fait que les objets matériels sont finalement privés de la vie qui leur est imposée, mystiquement transférée à diverses créatures fictives, généralement invisibles. , intervention continuellement active dont l'existence devient désormais la source directe de tous les phénomènes extérieurs, puis même humains. L'étude de l'esprit théologique durant cette période, qui se développe ici aussi pleinement et uniformément que jamais depuis, est à tous égards l'époque de sa plus grande floraison, tant intellectuelle que sociale. La majorité de notre race n'est pas encore sortie de ce stade, dans lequel elle continue obstinément de se maintenir aujourd'hui, à l'exception d'une partie marquante de la race noire et de la partie la plus avancée de la race blanche, la plus nombreuse des trois races humaines. 6. Dans la troisième phase, théologique, le monothéisme au sens propre du terme commence le déclin inévitable de la philosophie originelle, qui, conservant pleinement pendant longtemps une grande influence sociale, bien que plus apparente que réelle, subit désormais un rapide diminution de sa signification intellectuelle due à une conséquence naturelle qui découle naturellement d'une simplification caractéristique, grâce à laquelle l'esprit commence à réduire de plus en plus l'ancienne domination de l'imagination, permettant le développement progressif d'un sentiment universel jusqu'ici presque imperceptible, en parlant de la nécessaire subordination de tous les phénomènes à des lois immuables. Cette forme extrême de l'ordre préliminaire des choses, sous ses formes extrêmement variées et même totalement incohérentes, continue de rester plus ou moins solidement implantée chez l'immense majorité de la race blanche. Mais, même si son observation aurait dû ainsi être plus facile, les préjugés personnels, qui empêchent une comparaison suffisamment raisonnable et suffisamment impartiale avec les deux formes précédentes, entravent trop souvent sa juste appréciation. 7. Si imparfaite qu'une telle méthode philosophique puisse paraître aujourd'hui, il est très important de relier inséparablement l'état actuel de l'esprit humain à toute la série de ses états antérieurs, en reconnaissant que la méthode théologique devra pendant longtemps être aussi nécessaire qu'elle est inévitable. En nous limitant ici à une simple appréciation mentale, il serait tout d'abord trop long de s'attarder sur la tendance involontaire, qui nous porte encore aujourd'hui bien évidemment à donner des explications essentiellement théologiques, puisque nous voulons toucher directement au secret inaccessible des principes fondamentaux. méthode de formation des phénomènes et, en particulier, la formation de ceux dont nous ne connaissons pas encore les lois réelles. Les penseurs les plus éminents peuvent constater, dans les cas où cette ignorance se combine instantanément en eux avec quelque passion prononcée, leur propre disposition naturelle au fétichisme le plus naïf. Si toutes les explications théologiques ont été soumises à des critiques croissantes et destructrices parmi les nouveaux peuples d'Europe occidentale, c'est uniquement parce que les études mystérieuses qui ont des explications en tête ont été de plus en plus rejetées comme complètement inaccessibles à notre esprit, qui s'est progressivement habitué à les remplacer inévitablement par des connaissances plus valables et plus cohérentes avec nos véritables capacités. Même à une époque où le véritable esprit philosophique a pris le dessus dans les questions concernant les phénomènes les plus simples et un sujet aussi facile que la théorie élémentaire de la collision des corps, l'exemple mémorable de Malebranche nous rappellera toujours la nécessité de recourir à l'intervention directe et constante d'une force surnaturelle chaque fois qu'on tente de remonter à la cause profonde d'un événement. Mais d’un autre côté, de telles tentatives, aussi puériles qu’elles paraissent aujourd’hui à juste titre, constituent véritablement le seul moyen original de déterminer l’essor continu de la spéculation humaine et conduisent naturellement nos esprits hors du cercle vicieux profond dans lequel ils étaient nécessairement enfermés à l’époque. d'abord en raison de l'opposition radicale de deux conditions également urgentes ; car si les peuples modernes proclamaient l'impossibilité de fonder une théorie durable que sur un fondement suffisant d'observations correspondantes, il n'en est pas moins certain que la raison humaine ne pourrait jamais combiner ni même rassembler ces matériaux nécessaires, s'il n'était pas toujours guidé par certaines vues spéculatives préalablement établies. Ces concepts primitifs ne pourraient évidemment être que le produit de la philosophie, qui par nature est étrangère à toute longue préparation et est capable, pour ainsi dire, de surgir spontanément sous la seule pression de l'instinct immédiat, si absurdes que soient les spéculations. être, donc dépourvu de tout fondement de réalité. Tel est l'heureux avantage des principes théologiques, sans lesquels, il faut l'avouer, notre esprit ne pourrait jamais sortir de sa torpeur initiale et qui seuls pourraient permettre, en guidant son activité spéculative, de préparer progressivement une meilleure structure de pensée. Cette faculté fondamentale était cependant grandement favorisée par la tendance innée de l’esprit humain aux questions insolubles, dont s’occupait principalement cette philosophie primitive. Nous ne pouvions connaître l'étendue de nos capacités mentales et, par conséquent, limiter judicieusement leur objectif qu'après qu'elles aient été suffisamment exercées. Et cet exercice nécessaire ne pourrait d'abord avoir lieu, surtout à l'égard des facultés les plus faibles de notre nature, sans la passion inhérente à de telles recherches, où tant de têtes mal éclairées s'obstinent à chercher la solution la plus rapide et la plus complète au problème. questions les plus courantes. Pour vaincre notre inertie innée, il a même fallu longtemps recourir à des illusions tentantes, auto-générées par une telle philosophie, sur le pouvoir presque infini de l'homme de modifier à sa guise le monde, considéré alors comme disposé principalement dans les intérêts de l'homme et qu'aucune grande loi ne pouvait encore se débarrasser du caractère arbitraire suprême des influences surnaturelles. A peine trois siècles s'étaient-ils écoulés que, chez une partie choisie de l'humanité, les espoirs astrologiques et alchimiques, dernière trace scientifique de cette pensée primitive, cessèrent effectivement de servir de motif à l'accumulation quotidienne d'observations pertinentes, comme le montrèrent Kepler et Bertholet. 8. L'importance décisive de ces divers motifs intellectuels pourrait d'ailleurs être grandement renforcée si le caractère de ce traité m'avait permis d'indiquer suffisamment l'influence irrésistible des besoins sociaux importants que j'ai dûment pris en compte dans mon ouvrage susvisé. On peut ainsi d'abord démontrer pleinement comment l'esprit théologique a dû être longtemps nécessaire, surtout pour la combinaison constante d'idées morales et politiques, plus fortement encore que pour toute autre combinaison d'idées, à la fois en raison de leur plus grande complexité et parce que les phénomènes correspondants , initialement très faiblement exprimés, n'ont pu acquérir un développement notable qu'après une croissance extrêmement longue de la civilisation. Une étrange incohérence, difficilement expliquée par la tendance critique inconsciente de notre époque, est la tendance à admettre que les anciens ne pouvaient raisonner sur les sujets les plus simples que dans un esprit théologique, et en même temps à nier, surtout parmi les hommes politiques, qu'il Il est urgent de penser de la même manière dans le domaine des questions sociales. Mais il faut aussi comprendre, bien que je ne puisse l'établir ici, que cette philosophie primitive n'était pas moins nécessaire soit au développement préliminaire de notre société, soit à l'essor de nos facultés mentales, soit à la construction primitive de certains principes généraux. des doctrines sans lesquelles le lien social ne pourrait acquérir ni l'ampleur, ni la constance, ni l'autorité spirituelle auto-exécutable seulement concevable à cette époque. 2. STADE MÉTAPHYSIQUE OU ABSTRAIT 9. Aussi brèves que puissent être ici les explications générales sur le caractère temporaire et le but préparatoire de la seule philosophie correspondant véritablement à l'état naissant de l'humanité, elles peuvent facilement montrer que cette façon de penser originale diffère nettement dans avec tous égards, de cette direction de l'esprit qui, comme nous le verrons, correspond à l'état de maturité de la pensée humaine, et que cette différence est trop profonde pour que le passage graduel d'une méthode à une autre puisse s'accomplir pour la première fois tant dans l'individu et dans toute la race sans le concours croissant d'une philosophie médiatrice, selon une fonction essentiellement limitée à cette fonction temporaire. Une telle participation particulière du stade métaphysique proprement dit à l'évolution fondamentale de notre esprit, qui, sans subir de changements brusques, peut ainsi s'élever presque imperceptiblement d'un état purement théologique à un état ouvertement positif, bien que cette position ambiguë se rapproche, par essence, beaucoup plus de la premier qu'au second. Les spéculations dominantes à ce stade ont conservé le caractère essentiel de la direction caractéristique de la connaissance absolue : seules les conclusions subissent ici une transformation significative qui peut plus facilement faciliter le développement de concepts positifs. En fait, la métaphysique tente, comme la théologie, d'expliquer la nature intérieure des êtres, le commencement et le but de toutes choses, le mode fondamental de formation de tous les phénomènes, mais au lieu de recourir à l'aide de facteurs surnaturels, elle remplace de plus en plus eux avec des entités (entiles ou abstractions personnifiées), dont l'usage vraiment caractéristique permettait de l'appeler souvent sous le nom d'ontologie. Il est maintenant très facile d'observer cette méthode de philosopher qui, tout en étant encore prédominante dans le domaine des phénomènes les plus complexes, donne quotidiennement, même dans les théories les plus simples et les moins arriérées, tant de traces notables de sa longue domination. La signification historique de ces essences découle directement de leur caractère ambigu : car dans chacune de ces essences métaphysiques, inhérentes au corps correspondant et en même temps non mêlées à eux, l'esprit peut, à volonté et selon qu'il est plus proche de le théologique ou à un état positif, pour y voir soit une émanation réelle d'un pouvoir surnaturel, soit simplement un nom abstrait pour le phénomène en question. L'investissement dominant de la pure fantaisie cesse alors, mais la véritable observation n'est pas encore prédominante, seule la pensée acquiert une plus grande acuité et se prépare insensiblement à l'étape métaphysique ; la partie spéculative s'avère d'abord extrêmement exagérée en raison du désir persistant d'argumenter au lieu d'observer, désir qui, dans tous les domaines, caractérise généralement la manière de penser métaphysique, même chez ses représentants les plus célèbres. Un ordre flexible de concepts, qui ne tolère en aucune manière la constance qui a si longtemps caractérisé le système théologique, doit (d'ailleurs très bientôt) parvenir à une unité correspondante par la subordination progressive de diverses essences particulières à une seule essence générale - la nature, la dont le but est de représenter un faible équivalent métaphysique de la vague connexion universelle impliquée par le monothéisme. 10. Afin de mieux comprendre, surtout à notre époque, la puissance historique d'un tel outil philosophique, il est important de reconnaître que, de par sa nature, il n'est en soi capable d'exercer qu'une activité critique ou destructrice, même dans le domaine de la théorie et de la théorie. encore plus dans le domaine des questions sociales, ne pouvant jamais créer quoi que ce soit de positif qui le caractérise exclusivement. Profondément incohérente, cette philosophie ambiguë retient tous les principes fondamentaux du système théologique, les privant cependant de plus en plus de la force et de la constance nécessaires à leur autorité réelle, et c'est dans cette distorsion que réside pour l'instant sa principale utilité temporaire. lorsque l'ancienne façon de penser, qui a longtemps été progressiste pour la totalité de l'évolution humaine, atteint inévitablement un stade où son maintien s'avère néfaste, puisqu'elle cherche à renforcer pour une période indéfinie l'état infantile dans lequel elle se trouvait actuellement. d'abord si heureusement présidé. La métaphysique n’est donc, par essence, rien d’autre qu’une forme de théologie affaiblie par des simplifications destructrices, qui la privent arbitrairement de son pouvoir immédiat d’entraver le développement de concepts spécialement positifs. Mais d’un autre côté, grâce à ces mêmes simplifications destructrices, il acquiert une capacité temporaire à soutenir l’activité de l’esprit généralisateur jusqu’à ce qu’il ait enfin la possibilité de manger mieux. En raison de sa nature contradictoire, la pensée métaphysique ou ontologique se trouve toujours face à une alternative inévitable : soit lutter, dans l'intérêt de l'ordre, pour une vaine restauration de l'état théologique, soit, pour échapper au pouvoir oppressif de la théologie, pousser société vers un état purement négatif. Cette hésitation inévitable, qui ne s'observe plus qu'à propos des théories les plus difficiles, existait autrefois également à l'égard des théories même les plus simples, jusqu'à ce qu'elles franchissent le stade métaphysique, et est due à l'impuissance organique qui a toujours caractérisé cette théorie philosophique. méthode. Si la raison publique ne l'avait pas depuis longtemps exclu de certains concepts de base, on pourrait alors affirmer sans équivoque que les doutes insensés sur l'existence de corps extérieurs qu'il a générés il y a 20 siècles se seraient répétés encore aujourd'hui, car elle ne leur a jamais donné de solution décisive. la dispute ne s'est pas dispersée. L’état métaphysique doit donc être considéré comme une sorte de maladie chronique, naturellement inhérente à l’évolution de notre pensée – individuelle ou collective – à la frontière entre l’enfance et la virilité. 11. Puisque la spéculation historique parmi les nouveaux peuples ne remonte presque jamais au-delà de l'époque du polythéisme, la pensée métaphysique doit paraître presque aussi ancienne que la pensée théologique. En effet, il a inévitablement dirigé, bien que secrètement, la transformation initiale du fétichisme en polythéisme, afin d'éliminer la domination exclusive de forces purement surnaturelles, qui, étant ainsi directement éloignées de chaque corps individuel, doivent par là laisser en chacun une essence correspondante. Mais comme aucune véritable discussion n'a pu avoir lieu au cours de cette première révolution théologique, l'intervention continue de l'esprit ontologique n'est devenue tout à fait caractéristique que dans la révolution ultérieure avec la transformation du polythéisme en monothéisme, dont il devait être l'instrument naturel. Son influence croissante doit d'abord, tant qu'il reste soumis à la pression théologique, apparaître organique, mais son caractère essentiellement destructeur doit alors apparaître de plus en plus à mesure qu'il tente peu à peu de porter la simplification de la théologie au-delà même du monothéisme ordinaire qui constitue nécessairement le phase extrême et véritablement possible de la philosophie primitive. Ainsi, au cours des cinq derniers siècles, l'esprit métaphysique, agissant négativement, a favorisé l'essor principal de notre civilisation moderne, désintégrant progressivement le système théologique, devenu complètement rétrograde vers la fin du Moyen Âge, lorsque le pouvoir social du régime monothéiste était essentiellement épuisé. Malheureusement, après avoir rempli le plus complètement possible cette fonction nécessaire mais temporaire, les concepts ontologiques, agissant trop longtemps, ont dû aussi s'efforcer de contrecarrer toute autre organisation réelle du système spéculatif ; de sorte que l'obstacle le plus dangereux à l'établissement définitif de la vraie philosophie vient aujourd'hui en réalité de la même manière de penser, qui s'arroge encore souvent un privilège presque exclusif dans le domaine de la philosophie. 3. ÉTAPE POSITIF OU RÉEL 1. Caractéristique principale : La loi de subordination constante de l'imagination à l'observation 12. Cette longue chaîne de phases nécessaires conduit enfin notre esprit progressivement libéré à son état final de positivité rationnelle. Il faut ici caractériser cet état de manière plus détaillée que les deux étapes précédentes. Ayant spontanément établi, à partir de tant d'expériences préparatoires, la futilité complète des explications vagues et arbitraires caractéristiques de la philosophie originelle, tant théologique que métaphysique, notre esprit abandonne désormais la recherche absolue, appropriée seulement à son état infantile, et concentre ses efforts dans le domaine de l'observation réelle, qui accepte désormais une portée de plus en plus large et étant la seule base possible pour les connaissances dont nous disposons, raisonnablement adaptées à nos besoins réels. La logique spéculative a été jusqu'ici l'art de raisonner plus ou moins habilement d'après des principes vagues, qui, inaccessibles à toute preuve satisfaisante, suscitaient sans cesse des disputes sans fin. Désormais, elle reconnaît comme règle fondamentale que toute phrase qui ne peut être transformée avec précision en une simple explication d'un fait particulier ou général ne peut représenter aucune signification réelle et intelligible. Les principes qu'elle utilise ne sont eux-mêmes que des faits réels, mais plus généraux et plus abstraits que ceux dont ils sont censés former le lien. Quelle que soit d'ailleurs la méthode rationnelle ou expérimentale de leur découverte, leur puissance scientifique dérive toujours uniquement de leur correspondance directe ou indirecte avec les phénomènes observés. L'imagination pure perd alors irrévocablement son ancienne primauté dans le domaine de la pensée et se soumet inévitablement à l'observation (il se crée ainsi un état logique tout à fait normal), sans cesser néanmoins de remplir dans la spéculation positive une fonction tout aussi importante et inépuisable dans le sens de créer ou des moyens d'amélioration comme connexion finale et préliminaire des idées. En un mot, la principale révolution qui caractérise l'état de maturité de notre esprit consiste essentiellement dans le remplacement généralisé de la définition inaccessible des causes au sens propre du terme par une simple étude des lois, c'est-à-dire relations permanentes existant entre les phénomènes observés. Quoi qu'il en soit, des conséquences les plus minimes ou les plus importantes, de collision et de gravité, ou de pensée et de moralité, nous ne pouvons en réalité connaître que les diverses connexions mutuelles inhérentes à leur manifestation, sans jamais pouvoir pénétrer le secret de leur formation. 2. Le caractère relatif de la philosophie positive 13. Non seulement nos recherches positives dans tous les domaines doivent essentiellement se limiter à une évaluation systématique de ce qui est, en refusant d'en découvrir la cause première et le but final, mais il est également important de comprendre qu'il s'agit d'une philosophie positive. l'étude des phénomènes, au lieu de devenir toujours absolue, doit toujours rester relative selon notre organisation et notre position. Reconnaissant de ce double point de vue l'inévitable imperfection de nos divers moyens spéculatifs, nous voyons que, loin de pouvoir étudier dans son intégralité une quelconque existence réelle, nous ne pouvons pas être sûrs de pouvoir constater, même de manière extrêmement superficielle, toutes les existences réelles, la plupart dont doit peut-être nous rester complètement caché. Si la perte d'un sens important suffit à nous cacher complètement toute une série de phénomènes naturels, alors il est tout à fait approprié de croire qu'au contraire, l'acquisition d'un nouveau sens nous révélerait une classe de faits sur lesquels nous n’en avons maintenant aucune idée ; du moins penser que la variété des sentiments, si différents entre les principales espèces d'animaux, est amenée dans notre corps au plus haut degré que pourrait exiger une connaissance complète du monde extérieur - une proposition évidemment infondée et presque dénuée de sens. Aucune science ne peut mieux que l’astronomie confirmer ce caractère inévitablement relatif de toutes nos connaissances réelles ; puisque l'étude d'un phénomène ne peut s'effectuer ici que dans un seul sens, il est très facile d'évaluer les conséquences spéculatives provoquées par son absence ou son anomalie. Aucune astronomie ne pourrait exister chez une espèce aveugle, aussi intelligente soit-elle; de même, nous ne pourrions avoir de jugement ni sur les corps célestes obscurs, qui sont peut-être les plus nombreux, ni même sur les luminaires, si seulement l'atmosphère à travers laquelle nous observons les corps célestes restait toujours et partout brumeuse. Tout au long de ce traité, nous aurons souvent l'occasion, sans aucun effort, d'apprécier avec suffisamment de clarté cette dépendance intime, où l'ensemble des conditions internes et externes de notre propre existence retarde inévitablement nos investigations positives. 14. Afin de caractériser suffisamment ce caractère nécessairement relatif de toutes nos connaissances réelles, il importe d'ailleurs de noter, du point de vue le plus philosophique, que si l'un de nos concepts doit être lui-même considéré comme un phénomène humain, et surtout sociales, alors elles sont en fait déterminées par une évolution collective et continue, dont tous les éléments et phases sont essentiellement adjacents les uns aux autres. Si, d'une part, on reconnaît que nos spéculations doivent toujours être dépendantes des diverses conditions fondamentales de notre existence personnelle, alors nous devons également admettre, d'autre part, qu'elles ne sont pas moins soumises à la totalité de l'évolution continue. cours des idées sociales, de sorte qu'elles ne peuvent jamais rester dans l'état de parfaite quiétude proposé par les métaphysiciens. Mais comme la loi générale du mouvement fondamental de l'humanité à cet égard est que nos théories tendent à représenter de plus en plus fidèlement les objets extérieurs de nos constantes investigations, étant cependant privées de la possibilité d'apprécier pleinement la véritable structure de chacun d'entre eux. Pour eux, le progrès scientifique doit donc être limité au désir de se rapprocher de cette limite idéale dans la mesure où nos divers besoins réels l'exigent. Ce deuxième type de dépendance, inhérent à la spéculation positive, se révèle aussi clairement que le premier dans tout le cours des recherches astronomiques, qui montrent par exemple un certain nombre de concepts de plus en plus satisfaisants obtenus depuis la naissance de la géométrie céleste sur la figure. de la terre, sur les orbites planétaires, etc. Ainsi, même si, d'une part, les doctrines scientifiques sont nécessairement d'un caractère suffisamment instable pour éliminer toute prétention à la connaissance absolue, leurs évolutions progressives ne représentent, d'autre part, aucun arbitraire qui pourrait provoquer un scepticisme encore plus dangereux. ; chaque changement successif au-delà de ce seuil assure en soi aux théories correspondantes un pouvoir infini de fournir les phénomènes qui les sous-tendent, du moins dans la mesure où le degré originel d'exactitude réelle ne doit pas être dépassé. 3. Le but des lois positives : la prospective rationnelle 15. Après que la subordination constante de l'imagination à l'observation ait été unanimement reconnue comme la première condition fondamentale de toute saine spéculation scientifique, les interprétations erronées ont souvent conduit à un abus excessif de ce grand principe logique. transformant la vraie science en une sorte d’accumulation stérile de faits incohérents, dont le mérite inhérent ne pouvait résider que dans son exactitude partielle. Il importe donc de bien comprendre que le véritable esprit positif n'est fondamentalement pas moins éloigné de l'empirisme que du mysticisme ; c'est précisément entre deux fausses voies également désastreuses qu'il doit toujours se frayer un chemin ; la nécessité d'une telle prudence constante, aussi difficile qu'importante, suffit d'ailleurs à confirmer, conformément à nos explications originelles, combien la véritable positivité doit être mûrement préparée, pour qu'elle ne ressemble en rien à l'état primitif de l'humanité. C'est dans les lois des phénomènes que réside véritablement la science, dont les faits au sens propre du terme, aussi précis et nombreux qu'ils soient, ne sont toujours que la matière première nécessaire. Compte tenu de la finalité constante de ces lois, on peut dire sans aucune exagération que la vraie science, loin de pouvoir se former à partir de simples observations, s'efforce toujours d'éviter autant que possible la recherche directe, en remplaçant celle-ci par la prévision rationnelle, qui en tout respects constitue le principal trait caractéristique de la philosophie des sciences positives. L’ensemble des connaissances astronomiques nous le montre clairement. Une telle prévoyance, résultant nécessairement des relations constantes ouvertes entre les phénomènes, ne permettra jamais que la science réelle se confonde avec cette érudition inutile qui accumule mécaniquement les faits sans chercher à déduire les uns des autres. Cette propriété importante de toutes nos spéculations claires concerne leur utilité réelle non moins que leur propre dignité ; car l'étude directe des phénomènes accomplis, sans nous donner la possibilité de les prévoir, ne saurait nous permettre d'en changer le cours. Ainsi, la vraie pensée positive consiste avant tout dans la capacité de voir pour prévoir, d'étudier ce qui est, et de là conclure ce qui devrait arriver selon la position générale de l'immuabilité des lois naturelles. 4. Diffusion générale de la doctrine fondamentale de l'immuabilité des lois naturelles 16. Ce principe de base de toute philosophie positive, bien que loin encore d'être suffisamment étendu à l'ensemble des phénomènes, a heureusement commencé à devenir si courant au cours des trois derniers siècles que jusqu'à présent, en raison d'habitudes absolues précédemment inculquées, sa véritable source a presque toujours été ignorée, tentant, sur des bases vides et une argumentation métaphysique confuse, de présenter comme une sorte de concept inné ou du moins primitif ce qui pouvait clairement découler d'une induction lente et graduelle, à la fois collective et individuelle. Non seulement aucun motif rationnel, indépendant de toute investigation extérieure, ne nous montre d'abord l'immuabilité des relations physiques, mais, au contraire, il ne fait aucun doute que l'esprit humain éprouve, au cours de sa longue enfance, une tendance extrêmement forte à ignorer ce phénomène. immuabilité même en cas d'observation impartiale, elle se serait révélée d'elle-même s'il n'avait été entraîné par son désir nécessaire d'attribuer tous les événements de toute nature, et surtout les plus importants, à des désirs arbitraires. Dans tout cercle de phénomènes, il y a sans doute des phénomènes suffisamment simples et suffisamment ordinaires pour que leur observation spontanée inspire toujours le sentiment vague et incohérent de quelque régularité secondaire ; de sorte qu'un point de vue purement théologique ne pourra jamais être strictement universel. Mais cette conviction partielle et accidentelle s'étend longtemps à des phénomènes très peu nombreux et très subordonnés, qu'elle ne peut alors même pas protéger des perturbations fréquentes attribuées à l'intervention dominante de facteurs surnaturels. Le principe de l'immuabilité des lois naturelles n'a commencé à acquérir réellement quelque base philosophique que lorsque les premiers travaux véritablement scientifiques ont pu découvrir la complète exactitude de ce principe pour toute une classe de phénomènes importants ; cette circonstance n'a pu se produire pleinement qu'à partir du moment de la création de l'astronomie mathématique, au cours des derniers siècles du polythéisme. A la suite de cette introduction systématique, cette règle fondamentale a sans doute eu tendance à s'étendre par analogie à des phénomènes plus complexes, avant même que leurs lois propres puissent être connues d'une manière ou d'une autre. Mais outre sa stérilité réelle, cette vague anticipation logique possédait alors trop peu d'énergie pour résister adéquatement à la domination active que les illusions théologico-métaphysiques entretenaient dans le domaine de la pensée. La première expérience particulière d'établissement de lois naturelles pour chaque classe principale de phénomènes fut alors nécessaire pour conférer à ce concept la force inébranlable qu'il commence à représenter dans les sciences les plus avancées. Cette conviction ne pourrait même devenir suffisamment forte que lorsque toutes les spéculations fondamentales auraient été effectivement soumises à un traitement similaire, puisque le doute qui subsistait encore sur les plus complexes devait alors plus ou moins infecter chacune d'elles. Il est impossible d'ignorer cette réaction inconsciente même aujourd'hui, alors que, en raison de l'ignorance encore répandue dans le domaine des lois sociologiques, le principe de la constance des relations physiques est parfois soumis à de grossières distorsions même dans les études purement mathématiques, où l'on voit, par exemple, comment le calcul imaginaire des chances est invariablement loué, caché, ce qui implique l'absence de toute loi réelle par rapport aux événements connus, en particulier lorsqu'une intervention humaine a lieu. Mais lorsque cette diffusion générale est enfin suffisamment préparée, condition qui est maintenant déjà remplie chez les esprits les plus avancés, ce grand principe philosophique acquiert immédiatement une complète complétude, bien que les lois réelles de la plupart des cas particuliers doivent rester longtemps inconnues ; car l'analogie, qui ne peut être rejetée, applique alors d'avance à tous les phénomènes de chaque classe ce qui a été établi pour quelques-uns d'entre eux, pourvu seulement qu'ils aient l'importance qui leur convient. Chapitre deux LE BUT DE LA PENSÉE POSITIVE 17. Après avoir examiné la relation de la pensée positive avec les objets externes de notre spéculation, nous devons compléter sa caractérisation par une évaluation de son objectif interne - satisfaire continuellement nos propres besoins liés à la vie contemplative ou active. . 1. ÉTABLISSEMENT COMPLET ET FORT DE L'HARMONIE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DANS LE DOMAINE DE LA PENSÉE PAR RAPPORT À L'HUMANITÉ 18. Bien que les exigences purement mentales soient, sans aucun doute, le moins énergique de tous les besoins inhérents à notre nature, leur existence directe et constante dans tous les gens qui pensent sont les mêmes, cela n'en est pas moins certain : ils donnent la première impulsion nécessaire à nos divers efforts philosophiques, trop souvent attribués d'abord à des impulsions pratiques ; ces derniers contribuent pourtant à leur développement, mais ne sauraient y donner naissance. Ces besoins mentaux, liés comme tous les autres à l'accomplissement régulier des fonctions correspondantes, exigent toujours une heureuse combinaison de solidité et d'activité, d'où découlent simultanément les besoins d'ordre et de progrès, ou de connexion et d'expansion. Durant la longue enfance de l'humanité, les concepts théologico-métaphysiques furent les seuls capables, selon nos explications précédentes, de satisfaire provisoirement, quoique de manière extrêmement imparfaite, à cette double condition fondamentale. Mais lorsque l'esprit humain est enfin suffisamment mûr pour renoncer ouvertement aux recherches hors de sa portée et concentrer sagement ses activités dans un domaine dont l'appréciation est vraiment à notre portée, alors la philosophie positive lui offre véritablement à tous égards une vision réelle beaucoup plus complète. satisfaction de ces deux besoins fondamentaux. C'est évidemment, de ce nouveau point de vue, le but direct des lois des divers phénomènes découverts par lui et de la prévoyance rationnelle qui en est inséparable. Pour chaque type d'événements, ces lois doivent à cet égard distinguer deux classes, selon qu'elles relient par similitude des événements qui coexistent ou qui se succèdent par continuité. Cette différence nécessaire correspond fondamentalement dans le monde extérieur à ce qui nous apparaît toujours naturellement entre les états corrélatifs de l'existence et du mouvement ; de là, dans toute science réelle, découle la principale différence entre les évaluations statistiques et dynamiques de n'importe quel sujet. Les deux types de relations contribuent également à l'explication des phénomènes et conduisent également à la possibilité de les prévoir, bien que les lois de l'harmonie semblent d'abord destinées avant tout à l'explication, et les lois de cohérence à la prescience. En fait, tout ce dont nous parlons s'explique |
Populaire:
Nouveau
- Visage de l'hiver Citations poétiques pour les enfants
- Leçon de langue russe "Signe doux après le sifflement des noms"
- L'Arbre Généreux (parabole) Comment trouver une fin heureuse au conte de fées L'Arbre Généreux
- Plan de cours sur le monde qui nous entoure sur le thème « Quand viendra l'été ?
- Asie de l'Est : pays, population, langue, religion, histoire En tant qu'opposant aux théories pseudoscientifiques sur la division des races humaines en inférieures et supérieures, il a prouvé la vérité
- Classification des catégories d'aptitude au service militaire
- La malocclusion et l'armée La malocclusion n'est pas acceptée dans l'armée
- Pourquoi rêvez-vous d'une mère morte vivante: interprétations des livres de rêves
- Sous quels signes du zodiaque sont nées les personnes nées en avril ?
- Pourquoi rêvez-vous d'une tempête sur les vagues de la mer ?