Sections du site
Choix des éditeurs:
- Papillon - photos et caractéristiques de l'existence de chaque espèce Comment le papillon pond ses œufs
- Comment identifier les complications des piqûres d'insectes après une piqûre d'insecte
- Comment et comment retirer la teigne des aliments dans un appartement
- Tout sur les cafards, la structure, les organes sensoriels
- Remède contre les punaises de lit ecokiller
- D'où venaient les tiques des forêts?
- Comment détecter les fourmis dans un appartement
- Petites puces noires dans un appartement ou dans une maison - d'où elles viennent et comment s'en débarrasser
- Cafards blancs: description, causes et méthodes de lutte.
- Tique - description, espèces, où ils vivent, ce qu'ils mangent, photo Quelle est la différence entre les tiques des animaux
La publicité
| À propos de la peau, par Curzio Malaparte |
|
À la mémoire du colonel Henry G. Cumming, diplômé de l'Université de Virginie, et de tous les braves, bons et honnêtes soldats américains, mes amis d'armes de 1943 à 1945, morts en vain pour la liberté européenne N'adorant que les dieux et les temples des vaincus, Les gagnants seront enregistrés. Eschyle. Agamemnon La maison d'édition remercie Ekaterina Ulyashina, sans le soutien de laquelle cette publication n'aurait pas été possible © Eredi Curzio Malaparte, 2015 © Fedorov G., traduction, 2015 © LLC Ad Margin Press, 2015 C'étaient les jours de la «peste» à Naples. Tous les jours à cinq heures de l'après-midi, après une séance d'entraînement d'une demi-heure avec une balle de boxe et une douche chaude dans la salle de sport PBS, le colonel Jack Hamilton et moi sommes descendus dans le quartier de San Ferdinando, ouvrant nos coudes dans une foule bondée du petit matin jusqu'au couvre-feu sur Via Tolède. Propres, lavés et bien nourris, Jack et moi nous sommes retrouvés au milieu d'une terrible foule napolitaine de gens misérables, sales, affamés et en lambeaux que les soldats libérateurs de toutes les races et tribus de la terre poussaient et réprimandaient de toutes les manières possibles. Le destin a honoré le peuple napolitain de l'honneur d'être l'un des premiers à être libéré en Europe, et, pour célébrer une récompense si bien méritée, mes pauvres Napolitains, après trois ans de faim, d'épidémies et de bombardements brutaux, par amour pour la mère patrie ont pris sur eux un fardeau enviable pour remplir le rôle d'un peuple vaincu: chantez, frappez des mains, sautez de joie sur les ruines de leurs maisons, agitez des drapeaux ennemis hier et des fenêtres de douche aux couleurs des gagnants. Mais, malgré l'enthousiasme sincère universel, pas un seul Napolitain dans toute la ville ne s'est senti vaincu. Il m'est difficile d'imaginer qu'un sentiment aussi étrange puisse surgir dans l'âme de ce peuple. Sans aucun doute, l'Italie, et donc Naples, a perdu la guerre. Cependant, il est clair que la guerre est plus difficile à perdre qu'à gagner. Gagner une guerre est tout possible, mais tout le monde n'est pas capable de la perdre. Et il ne suffit pas de perdre la guerre pour avoir le droit de se sentir comme un peuple vaincu. Et dans leur sagesse ancienne, nourrie par des siècles d'expérience amère, dans leur modestie inacceptable, mes pauvres Napolitains n'ont pas du tout empiété sur le droit d'être vaincu par le peuple. C'était, bien sûr, une grande absence de tact de leur part. Mais les alliés peuvent-ils prétendre que les peuples qu'ils ont libérés sont également obligés de se sentir vaincus? À peine. Et il serait injuste de blâmer les Napolitains pour cela, d'autant plus qu'ils ne ressentent ni l'un ni l'autre. En me promenant aux côtés du colonel Hamilton, je semblais incroyablement ridicule dans mon uniforme militaire anglais. L'uniforme du Corps de libération italien est un vieil uniforme kaki anglais fourni par le commandement britannique au maréchal Badoglio, repeint, très probablement, afin de cacher les taches de sang et les trous des balles, dans une couleur lézard vert vif. L'uniforme a en effet été retiré aux soldats anglais tombés à El Alamein et Tobrouk. Sur ma tunique, il y avait trois trous de balles de mitrailleuses. Ma chemise, ma chemise et mon slip étaient tachés de sang. Mes chaussures viennent aussi d'un soldat anglais mort. En les mettant pour la première fois, j'ai senti quelque chose me poignarder le pied. Il y avait un os de mort, ai-je pensé tout de suite, mais il s'est avéré que c'était un clou. Il serait probablement préférable que ce soit vraiment un os: il serait plus facile de le retirer et il a fallu une demi-heure pour trouver des tiques et pour retirer un clou. Inutile de dire que pour nous, cette stupide guerre s'est bien terminée. Ça ne va pas mieux. Notre vanité des vaincus a été sauvée: ayant perdu notre guerre, maintenant nous avons combattu aux côtés des alliés pour gagner leur guerre avec eux, il est donc naturel de porter l'uniforme des soldats alliés, que nous avons tués. Lorsque j'ai finalement réussi à faire face au clou, l'entreprise, que je devais prendre sous commandement, avait déjà été construite dans la cour de la caserne. Un ancien monastère, détruit par le temps et les bombardements, servait de caserne aux environs de Torretta, au-delà de Mergellina. La cour, comme il sied au monastère, était entourée sur trois côtés par une galerie de colonnes maigres de tuf gris, au quatrième il y avait un haut mur jaune parsemé de taches vertes de moisissure avec d'énormes plaques de marbre, sur lesquelles de longues colonnes de noms s'étiraient sous de grandes croix noires. Autrefois, pendant l'épidémie de choléra, le monastère servait d'infirmerie et les noms des morts étaient jetés sur des assiettes. De grandes lettres noires sur le mur indiquaient: REQUIESCANT IN PACE. Le colonel Palese - un homme grand, mince et complètement aux cheveux gris - voulait me présenter à mes soldats, après avoir célébré l'une de ces simples cérémonies, qui est si chère aux anciens guerriers. Il me serra la main en silence et, avec un soupir triste, sourit. Les soldats construits au milieu de la cour (presque tous très jeunes, qui ont combattu courageusement contre les alliés en Afrique et en Sicile et c'est pourquoi ils ont été choisis pour former le noyau du Corps de libération italien) se sont tenus devant moi et m'ont regardé attentivement. Ils étaient également en uniforme et à la place des soldats anglais tombés à El Alamein et Tobruk. Ils avaient des visages pâles et émaciés et des yeux blanchâtres, gelés et ternes, comme s'ils étaient constitués d'un matériau doux et opaque. Ils me regardèrent à bout portant, semblait-il, sans cligner des yeux. Le colonel Palese a fait signe, le sergent a crié: - R-r-rota, paix-rrrna! Le regard du soldat au poids douloureux était fixé sur moi, comme le regard d'un chat mort. Les corps étaient engourdis et étendus sur commande «tranquillement». Des mains pâles et exsangues agrippaient une arme, une peau molle pendait du bout de ses doigts, comme des gants trop grands. Le colonel Palese a commencé: "Je vous présente votre nouveau capitaine ..." Et pendant qu'il parlait, j'ai regardé les soldats italiens sous la forme retirée des Anglais morts, leurs mains exsangues, leurs lèvres pâles et leurs yeux blanchâtres. Il y avait des taches noires de sang sur leurs vestes et pantalons. Je me suis soudainement pris dans la terrible pensée que les soldats étaient morts. Ils dégageaient une odeur de moisi de tissu moisi, de peau pourrie et de chair séchée au soleil. J'ai regardé le colonel Palese - il est également mort. Une voix froide sortit de sa bouche, humide et moite, comme des sanglots terribles qui jaillirent de la bouche d'un mort si vous posez une main sur son ventre. «Commandez-le librement», a déclaré le colonel Palese au sergent à la fin de son court discours. - Rota, gratuit! Cria le sergent. Les soldats ont détendu leur jambe gauche, prenant une pose lente, et ont continué à me regarder avec des yeux encore plus loin et encore plus instables. "Et maintenant", a déclaré le colonel Palese, "votre nouveau capitaine va vous parler avec un petit mot." J'ai ouvert la bouche, un sanglot amer est descendu de mes lèvres, les mots étaient sourds, flasques, épuisés. J'ai dit: "Nous sommes des volontaires de la Libération, des soldats de la nouvelle Italie!" Nous devons combattre les Allemands, les expulser de notre maison, les jeter au-delà de nos frontières! Les yeux de tous les Italiens sont fixés sur nous: nous devons à nouveau lever la bannière qui est tombée dans la boue, devenir un exemple pour tous dans cette disgrâce, nous montrer dignes des temps à venir et du devoir que la Patrie nous a confié! Quand j'ai fini, le colonel a dit: "Et maintenant, l'un de vous répétera ce que votre capitaine a dit." Je veux être sûr que vous comprenez. Voilà, a-t-il dit en désignant un soldat, répétez ce que le commandant a dit. » La peau Curzio Malaparte (Aucune évaluation pour le moment)
À propos de la peau, par Curzio MalaparteLe célèbre écrivain, journaliste, cinéaste italien Curzio Malaparte (Kurt Erich Zucker) est né le 9 juin 1989. À l'âge de quatorze ans, il écrit son premier poème et le publie. Dès sa jeunesse, Curzio Malaparte n'aimait pas obéir aux ordres généralement acceptés, il avait toujours un esprit rebelle et aventuriste. Il a participé à la Première Guerre mondiale, où il a été blessé. Pendant quelque temps, il était engagé dans le journalisme. Curzio Malaparte, qui signifie «part du mal», a pris son pseudonyme comme l'opposé du nom de famille de Bonaparte, qui se traduit par «bonne volonté». Le travail de l'écrivain "Skin" est écrit dans le genre des "classiques étrangers" et a une limite d'âge qui permet aux personnes de plus de dix-huit ans de lire le roman. Le livre est une suite logique du roman "Kaput", qui a été écrit dans l'avant-dernière année de la Grande Guerre patriotique et a parlé des événements sur le front de l'Est. Le travail commence par une description de la ville italienne. Il se trouve que les Napolitains ont eu l'honneur d'être les premiers habitants libérés d'Europe. Ils ont dû traverser beaucoup de choses au cours des trois dernières années: épidémies, faim, bombardements constants. L'auteur décrit de façon très intéressante la situation. La guerre se termine, Naples débarque à Naples, certains des envahisseurs sont remplacés par d'autres. Qui est le vainqueur, qui est le vaincu? L'air est saturé de l'atmosphère de la mort, de l'espoir et du désir d'oublier rapidement toute cette horreur sanglante. Curzio Malaparte parvient également à ajouter des éléments d'excellente humeur, malgré la gravité de la situation. L'auteur de l'ouvrage décrit la nature particulière de la peste, apparue de nulle part. Le pire, c'est qu'il n'a pas touché le corps, mais l'âme d'une personne qui, sous une coquille apparemment normale, a commencé à se décomposer et à puer. Les femmes ont été les premières à être infectées. Les hommes, infectés par eux, ont complètement perdu leur dignité: ils ont craché sur la bannière de leur pays d'origine, vendu leurs épouses, filles, mères. Le roman révèle le côté obscur de l'homme, quand il est prêt à tout pour survivre et atteindre de meilleures conditions d'existence. Le livre a été publié pour la première fois en France en 1949, et seulement un an plus tard en Italie. L'écrivain a été accusé d'antipatriotisme et d'immoralité. Le travail est tombé dans la catégorie des livres interdits. Et ce n'est qu'après la sortie d'un film italo-américain sur la base de l'intrigue du roman, où le célèbre acteur italien Marcello Mastroianni a joué le rôle principal, que l'auteur a retrouvé sa renommée et sa renommée. Mario Corti: Oui, il était fasciste, oui, il est devenu antifasciste. Mais il n'a jamais, même fasciste, permis les méchancetés. (Du roman) J'en ai assez de voir des gens se faire tuer. Pendant quatre ans, je n'ai rien fait - j'ai juste regardé des gens se faire tuer. C'est une chose de regarder comment les gens meurent et une autre de regarder comment ils sont tués. Vous vous sentez du côté des tueurs - comme si vous-même en faisiez partie. J'en ai assez de ça, je ne pouvais plus. À ce moment-là, j'étais malade à la vue des cadavres - non seulement par l'horreur et le dégoût, mais par la rage et la haine. J'ai commencé à détester les cadavres. Sergey Yurenen: À la mémoire du colonel Henry Caming de l'Université de Virginie. En mémoire de tous les braves, gentils et dignes soldats américains qui ont été mes camarades soldats de la 43e à la 45e année, et qui ont donné leur vie pour la liberté de l'Europe - ceci est une dédicace au roman de Curzio Malaparta "The Skin". "Naples était en proie à la peste. Chaque jour, à cinq jours, après une demi-heure d'entraînement avec un sac de boxe et une douche chaude dans le gymnase du BSP - la section de base de la péninsule - le colonel Jack Hamilton et moi nous sommes dirigés vers San Ferdinando, poussant mes coudes à travers la foule luxuriante, bondé Via Toledo de l'aube jusqu'au couvre-feu. Nous avions l'air propres, bien entretenus et bien nourris, Jack et moi, faisant notre chemin parmi la répugnante napolitaine dégoûtante - un mendiant, sale, affamé, en lambeaux, obstrué et insulté dans toutes les langues et dialectes du monde par des soldats de l'Armée de libération, recrutés dans toutes les races qui n'existent que sur la terre. L'honneur d'être le premier de tous les peuples libérés d'Europe revient au peuple de Naples; et dans les triomphes pour avoir gagné une récompense si bien méritée, mes pauvres Napolitains bien-aimés, après trois ans de famine, d'épidémies et de raids aériens féroces, avec facilité et patriotisme ont accepté l'honneur tant attendu et chéri, consistant à jouer le rôle du peuple conquis, chanter, applaudir , sautant de joie au milieu des ruines de leurs propres maisons, agitant des drapeaux étrangers qui personnifiaient les ennemis hier, et jetant des fleurs par les fenêtres aux têtes des gagnants. Mais malgré l'enthousiasme sincère universel, il n'y avait pas un seul homme ou femme dans tout Naples qui se sentirait vaincu. Je ne peux pas dire comment cette étrange sensation est survenue chez les gens dans la poitrine. L'Italie, et donc Naples, la guerre était perdue - ce fait ne faisait aucun doute. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile de perdre une guerre que de la gagner. Mais perdre une guerre ne donne pas en soi au peuple le droit de se considérer comme vaincu. Dans leur sagesse ancienne, tirée de la triste expérience de plusieurs siècles, et dans leur véritable modestie, mes pauvres Napolitains bien-aimés n'ont pas permis de voir comment cela pouvait être considéré comme conquis. Ici, ils ont sans aucun doute montré un manque de tact. Mais comment les alliés peuvent-ils revendiquer la libération du peuple et en même temps l'obliger à se considérer vaincu? Le peuple doit être libre ou conquis. Il serait injuste de reprocher aux Napolitains de ne pas se considérer libres ou conquis. Le colonel Palese s'est porté volontaire pour me présenter personnellement à mes soldats lors d'une de ces simples cérémonies que les anciens domestiques adorent. C'était un homme grand et mince, aux cheveux complètement blancs. Il me serra silencieusement la main et sourit, soupirant tristement. Presque tous les soldats étaient très jeunes. Ils se sont bien battus contre les Alliés en Afrique et en Sicile - c'est pourquoi les Alliés les ont choisis comme premier personnel du Corps de libération italien. Le colonel Palese a hoché la tête et le sergent a crié: "Rota est tranquille!" Le regard de toute la société était fixé sur moi; il était lugubre et tendu, comme le regard d'un chat mort. Le colonel Palese a commencé le discours. "Voici votre nouveau commandant", a-t-il dit, et pendant qu'il parlait, j'ai regardé ces soldats italiens en uniformes tirés de cadavres britanniques, leurs mains exsangues, leurs lèvres pâles et leurs yeux blancs. Ici et là, ils se sont présentés sur sa poitrine, son estomac, ses jambes des taches noires de sang. Soudain, j'ai réalisé, à mon horreur, que ces soldats étaient morts. Ils sentaient faiblement les vêtements moisis, la peau et la chair pourries, flétries par le soleil. J'ai regardé le colonel Palese - lui aussi était mort. Une voix qui continuait de s'échapper de lui lèvres, sonnaient aqueuses, froides, gommeuses, comme un terrible b lkane sortant de la bouche d'un homme mort, si vous mettez une main sur son ventre. «Dites-leur librement», a déclaré le colonel Palese au sergent. "Rota, gratuit!" cria le sergent. Les soldats pendaient sur leurs talons gauches dans des poses languissantes et languissantes, et encore, sans cligner des yeux, me fixaient, seuls leurs yeux devenaient plus doux et absents. "Et maintenant", a déclaré le colonel Palese, "votre nouvel officier vous dira quelques mots." J'ouvris la bouche et un bruit de gargouillis terrible s'éleva de là; mes mots étaient maladroits, gonflés, détendus. J'ai dit: "Nous sommes des volontaires de la liberté, des soldats de la nouvelle Italie. Il est de notre devoir de combattre les Allemands, de les chasser de notre pays, de les renvoyer au-delà de nos frontières. Les yeux de tous les Italiens sont tournés vers nous. Il est de notre devoir de lever le drapeau, abandonné dans la boue, pour donner l'exemple à tous au milieu d'une si grande honte, pour montrer que nous sommes dignes de l'heure actuelle et de la mission que notre pays nous a confiée. " Quand j'ai fini, le colonel Palese s'est adressé aux soldats: "Maintenant, laissez l'un de vous répéter ce que votre officier vous a dit. Je dois être sûr que vous comprenez tout." Le soldat me regardait; il était pâle, il avait les lèvres minces et exsangues d'un homme mort. Lentement, d'une terrible voix gargouillante, il a déclaré: "Il est de notre devoir de montrer que nous sommes dignes de la honte de l'Italie". Le colonel Palese s'est approché de moi. "Ils ont compris", dit-il dans un demi-murmure, et s'éloigna. Sur son aisselle gauche, il avait une tache de sang noir qui s'est répandue progressivement sur le tissu de l'uniforme. J'ai regardé la tache noire de sang se propager progressivement, j'ai regardé à travers les yeux d'un vieux colonel italien, dont l'uniforme appartenait à un Anglais, maintenant mort, et l'ai regardé s'éloigner tranquillement, j'ai écouté le craquement de ses bottes, les bottes d'un soldat britannique mort, et le nom de l'Italie elle-même mûrissait avec moi dans les narines. Des groupes de femmes échevelées et peintes, accompagnées de foules de soldats noirs aux mains pâles, parcouraient la Via Toledo de haut en bas, coupant l'air au-dessus de la rue grouillant de gens aux cris aigus: "Hé, Joe! Hé, Joe!" Les barbiers de la rue erraient autour de l'embouchure des ruelles. Ils se sont alignés en longues rangées, chacun se tenant derrière une chaise. Sur les sièges, les yeux fermés et la tête jetée derrière le dos ou tombée sur la poitrine, étaient assis des noirs athlétiques avec de petits crânes ronds et des bottes jaunes, brillant comme les jambes des anges dorés sur l'église de Santa Chiara. Des troupeaux de garçons en lambeaux agenouillés devant de petits tiroirs en bois, décorés d'écailles de nacre, de coquillages et de fragments de miroirs, pilonnés sur les couvercles avec des poignées de brosse, criant: "Cirage de chaussures! Cirage de chaussures!" Avec des mains minces et gourmandes, ils ont saisi le pantalon des soldats noirs qui passaient, vacillant leurs hanches. Des groupes de soldats marocains étaient accroupis le long des murs, enveloppés dans leurs robes sombres, leurs visages parsemés de variole, leurs yeux jaunes scintillant de creux profonds et ridés, et respiraient dans leurs narines tremblantes l'odeur sèche qui était saturée d'air poussiéreux. Des femmes flétries aux visages morts et aux lèvres peintes, aux joues rouges et flasques - une vision terrible et misérable - se pressaient au coin des ruelles, offrant aux passants leurs malheureux biens. Il s'agissait de garçons et de filles de huit ou dix ans, que les soldats - marocains, indiens, algériens, malgaches - caressaient, glissant leurs doigts entre les boutons de pantalons courts ou intimidant leurs robes. «Deux dollars par garçon, trois dollars par fille», ont crié les femmes. "Dis-moi franchement - tu veux une petite fille pour trois dollars?" Ai-je demandé à Jack. "Tais-toi, Malaparte." "C'est un peu, trois dollars pour une petite fille. Deux livres de bœuf coûtent beaucoup plus cher. Je suis sûr qu'une petite fille à Londres ou à New York vaut plus qu'ici - n'est-ce pas, Jack?" "Tais-toi!" - explosa Jack. Ces derniers jours, les prix des filles et des garçons ont chuté - et ont continué de baisser. Alors que les prix du sucre, du beurre, de la farine, de la viande et du pain ont bondi et ont continué d'augmenter, la valeur de la chair humaine s'effondrait de jour en jour. Des filles de vingt à vingt-cinq ans, valant dix dollars il y a une semaine, ne marchaient maintenant que pour quatre, os ensemble. Chaque jour, des groupes de jeunes filles à fleurs fortes arrivent à Naples, dans des charrettes tirées par de petits ânes malheureux, presque tous des paysannes attirées par des mirages dorés. Ils venaient de Calabre, des Pouilles, de la Basilicate et de Molisa. Et donc les prix de la chair humaine sur le marché napolitain se sont effondrés, et il y avait un risque que cela puisse sérieusement affecter l'ensemble de l'économie de la ville. (Rien de tel n'a jamais été vu à Naples. C'était définitivement une honte qui a fait que la plupart des bons Napolitains peignent de honte. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait cette peinture sur les joues des autorités alliées qui étaient maîtres de Naples?) Je m'arrêtai au milieu de la piazzetta à la Chapelle de Vecchia et levai les yeux vers les fenêtres de Lady Hamilton, serrant fermement la main de Jeanlui. Je ne voulais pas baisser les yeux et regarder autour de moi. Je savais que je verrais en face, au pied du mur entourant la cour du côté de la synagogue. Je savais qu'ici, devant nous, à quelques mètres de l'endroit où je me tenais, j'entendais les rires des enfants bruissants et les voix rauques des Bédouins - il y avait un marché pour enfants ici. Je savais qu'aujourd'hui, comme n'importe quel autre jour, à cette même heure, en ce moment, des garçons à moitié nus de huit à dix ans se sont assis devant des soldats marocains qui les ont examinés attentivement et, en choisissant, sont allés négocier avec de terribles femmes édentées, propriétaires de tarissement desséché les personnes qui ont échangé ces petits esclaves. Cela n'a jamais été vu à Naples pendant tous les siècles d'adversité et d'esclavage. Depuis des temps immémoriaux, tout a été vendu à Naples, mais jamais les enfants. Les enfants de Naples sont sacrés. C'est la seule chose sainte à Naples. Le peuple de Naples est un peuple généreux, le peuple le plus humain du monde. C'est le seul peuple au monde dont on puisse dire que même les familles les plus pauvres élèvent avec leurs enfants, avec leurs dix ou douze enfants, des petits orphelins pris à Ospedale degli Innocenti. Et ces orphelins sont les plus sacrés, les mieux habillés, les mieux nourris, car ce sont les «enfants de la Madone», et ils font le bonheur des autres enfants. Et maintenant, la piazzetta de la chapelle de Vecchia, au cœur de Naples, est devenue une étendue pour les soldats marocains qui viennent acheter des enfants napolitains pour quelques soldats. Alors, je suis allé avec Jimmy pour regarder la "vierge" napolitaine. La scène était un lieu de rencontre au bout d'une ruelle près de la Piazza Olivella. Une petite foule de soldats alliés a poussé à la porte de la cabane. À l'entrée se tenait un homme d'âge moyen vêtu de noir. Sur ses magnifiques cheveux gris, il y avait un chapeau de feutre minable, vêtu d'un style élégant, son angle d'inclinaison était soigneusement pensé. Ses bras étaient croisés sur sa poitrine, ses doigts agrippant un épais paquet de billets de banque. "Pour chaque dollar", a-t-il dit. "Cent lires par personne." Nous sommes entrés et avons regardé autour de nous. Une fille était assise au bord du lit et fumait. Ses jambes pendaient du lit, elle fumait en silence, réfléchissant profondément, posant ses coudes sur ses genoux, cachant son visage dans ses mains. Elle avait l'air très jeune, bien que ses yeux soient plutôt ternes, les yeux d'une vieille femme. La coiffure correspondait au style baroque qui a prospéré grâce aux efforts des barbiers des quartiers les plus pauvres - le style des coiffures caractéristiques des Madones napolitaines du XVIIe siècle. Les cheveux bouclés et brillants étaient étalés avec des rubans et du crin et rembourrés de fil. Ils surplombaient sa tête comme un château, créant l'illusion qu'une haute mitre noire repose sur son front. Il y avait quelque chose de byzantin dans ce visage long et étroit, dont la pâleur brillait à travers une épaisse couche de peinture. Mais les lèvres gonflées, agrandies par un éclat éclatant de rouge à lèvres, ont donné une expression de visage mélancolique raffinée et statuaire d'un sensuel et provocateur. Quand je suis entrée, elle a fixé ses yeux sur mes capitaines trois étoiles et a souri avec mépris, tournant son attention vers le mur avec un mouvement à peine perceptible. Nous étions dix dans la salle. J'étais le seul téléspectateur italien. Personne n'a dit un mot. "C'est ça. Les cinq prochaines minutes", fit la voix de l'homme derrière le rideau rouge. Puis il passa sa tête dans le trou du rideau: "Prêt?" La jeune fille jeta une cigarette sur le sol, saisit le bord de sa jupe du bout des doigts et la souleva lentement. Viennent d'abord les genoux, doucement saisis par un bas de soie dense, puis la peau nue des hanches. Elle se figea un instant dans cette pose, une Veronica triste avec un visage sévère et une bouche méprisante à moitié ouverte. Puis, se tournant lentement sur le dos, elle se coucha et s'allongea sur le lit. "C'est une vierge. Vous pouvez toucher. N'ayez pas peur. Elle ne mord pas. C'est une vierge", a déclaré l'homme, la tête dans le trou des rideaux. Le nègre tendit la main. Quelqu'un a ri et a semblé le regretter. La "Vierge" ne bougeait pas, elle regardait le Noir avec des yeux pleins de peur et de dégoût. J'ai regardé autour de moi. Tout le monde était pâle - pâle de peur et de dégoût. La jeune fille se leva brusquement, baissa sa robe et, avec un coup de foudre, arracha une cigarette de la bouche d'un marin anglais debout près du lit. "Sortez, s'il vous plaît", a déclaré le chef de l'homme, et nous nous sommes tous tranquillement déplacés vers la sortie ... "Dis-moi franchement, Jimmy, tu ne te sentirais pas comme des gagnants sans de telles scènes." "Naples a toujours été comme ça", a déclaré Jimmy. "Non, il n'a jamais été comme ça", ai-je répondu. "Cela ne s'est jamais produit à Naples auparavant. Si vous n'aimiez pas de telles choses, si de telles scènes ne vous divertissaient pas, elles ne seraient pas à Naples." "Nous n'avons pas créé Naples", a déclaré Jimmy. "Nous l'avons trouvé prêt." "Vous n'avez pas créé Naples, mais cela," objectai-je, "n'a jamais été comme ça auparavant. En Amérique, les choses seraient pires si vous perdiez la guerre." "Pardonne-moi, Jimmy, - Je déteste ça pour toi et pour moi. Ce n'est pas ta faute et pas la nôtre, je sais. Mais je tombe malade quand je pense à de telles choses. Tu n'aurais pas dû m'emmener regarder cette fille avec moi. Je Je ne devrais pas aller avec toi pour regarder cette horreur. Je déteste ça pour toi et moi, Jimmy. Je me sens misérable et lâche. Vous, les Américains, vous êtes des gars sympas, et il y a des choses que vous comprenez mieux que les autres. y a-t-il des choses que vous comprenez aussi? " "Oui, je comprends", a déclaré Jimmy, serrant ma main fermement. " Sergey Yurenen: Le deuxième des célèbres romans de Malaparte prolonge la fresque infernale de la Seconde Guerre mondiale, commencée par le livre "Kaput". Il y avait le Front de l'Est, ici - l'Ouest. Exemption. L'honnêteté de l'écriture est sans précédent pour la littérature née de la guerre. En 1980, l'adaptation cinématographique du roman de Liliana Cavani avec des stars telles que Claudia Cardinale, Bert Lancaster et Marcello Mastroianni dans le rôle de Malaparte a choqué le public. Vous pouvez imaginer l'effet de "Skins" dans l'année de sortie - dans le 49e. Le Vatican a inclus "Skin" dans l'index des livres interdits. L'année de la victoire, découragée par le spectacle de l'Italie, Malaparte se rend à Paris avec la volonté d'écrire désormais en français. Ses pièces «Vers Proust» et «Capital» n'ont pas réussi à Paris. Au début des années 50, il est retourné en Italie. Après avoir voyagé en République populaire de Chine en 56, où les médecins de Pékin ont sauvé la vie du célèbre italien, il a exprimé sa sympathie pour le communisme. Malaparte est décédé le 19 juillet 1957. Il avait moins de 60 ans: cœur, poumons - les effets des chocs d'obus, des blessures et de l'empoisonnement au gaz pendant la Première Guerre mondiale. Pendant quatre mois, il a combattu la mort à Rome, enregistrant l'expérience de l'agonie sur un magnétophone. 4 jours avant sa mort, le protestant Curzio Malaparte s'est converti au catholicisme. Du roman "Skin": La mer s'accrochait au rivage et me regardait. Il me regarda avec ses énormes yeux verts, respirant fortement, accroché au rivage, comme une sorte de créature en colère. Il dégageait une odeur étrange, une odeur impérieuse de bête sauvage. Loin à l'ouest, où le soleil tombait déjà vers l'horizon enfumé, des centaines et des centaines de navires à vapeur sautaient de haut en bas, ancrés derrière la baie. Ils étaient enveloppés d'un brouillard gris dense, dilué de mouettes blanches étincelantes. Au loin, d'autres navires labouraient les eaux de la baie, noircissant contre le fantôme bleu transparent de Capri. Une tempête est venue du sud-est; il remplit peu à peu le ciel d'une masse de nuages \u200b\u200ben colère cousue de traits de lumière jaune verdâtre, de soudaines fissures vertes étroites et de cicatrices sulfuriques éblouissantes. Une vision a brillé devant moi - des voiles blanches fuyant avec consternation la tempête, cherchant refuge dans le port de Castellammare. La vue était triste et toujours animée, avec des navires crachant de la fumée loin à l'horizon, des voiliers courant devant des éclairs jaunes et verts dans des nuages \u200b\u200bd'orage noirs, et une île lointaine, naviguant lentement dans l'abîme bleu du ciel. C'était un panorama fabuleux; et quelque part sur son bord Andromeda a pleuré, enchaîné à un rocher, et quelque part Persée a tué un monstre. La mer me regardait avec d'énormes yeux suppliants, respirant fortement, comme une bête blessée; et j'ai frissonné. Pour la première fois, la mer me regardait comme ça. La première fois que j'ai senti ces yeux verts se poser sur moi, pleins d'une telle tristesse omniprésente, d'un tel tourment, d'une telle douleur inconsolable. Il me regarda, haletant; il s'accrochait au rivage, ressemblant à une bête blessée; et je tremblais d'horreur et de pitié. J'étais épuisé par la vue de la souffrance humaine, la vue de gens qui saignaient avec des gémissements balayés sur le sol. J'étais épuisé par leurs plaintes et par ces mots incroyables qu'un homme mourant babille, souriant à l'agonie. J'étais épuisé par la vue des gens qui souffraient, et des animaux aussi, et des arbres, et du ciel, et de la terre, et de la mer. J'étais épuisé de leurs souffrances, de leurs souffrances inconscientes et futiles, de leur peur, de leur agonie sans fin. J'étais épuisé par mon horreur, épuisé par ma pitié. Oh dommage! J'avais honte de ma pitié. Et pourtant je tremblais de pitié et d'horreur. Au-delà de l'arc lointain du golfe, le Vésuve se tenait nu et fantomatique, avec des pentes striées de flammes et de lave, avec de profondes blessures saignantes, d'où s'échappaient des langues de feu et des nuages \u200b\u200bde fumée. La mer s'accrochait au rivage et me regardait avec de grands yeux suppliants, respirant fortement. Il était complètement recouvert d'écailles vertes, comme un reptile géant. Et je tremblais de pitié et d'horreur, écoutant les plaintes rauques du Vésuve flottant au-dessus. Les garçons assis sur les marches de Santa Maria Novella; un troupeau de badauds autour de l'obélisque; au pied de l'escalier menant à l'église, il y a un chef partisan chevauchant un banc, reposant ses coudes sur une table de fer apportée d'un café sur la place; un détachement de jeunes partisans avec des carabines automatiques de la division communiste Potente, alignés sur le site devant des cadavres empilés en tas - il semblait qu'ils étaient tous peints par Masaccio sur du stuc gris. Dans la lumière trouble crayeuse suintant du ciel nuageux au-dessus de leurs têtes, tout le monde semblait silencieux et immobile, tout le monde regardait dans un sens. Un mince filet de sang coulait sur les marches de marbre. Les nazis, assis sur les marches menant à l'église, étaient des garçons de quinze à seize ans, fronçant les sourcils, échevelés, avec des yeux brillants sombres sur leurs visages pâles et allongés. Le plus jeune, vêtu d'un sweat-shirt en laine noire et d'un pantalon court qui ne couvrait pas ses longues jambes maigres, avait presque l'air d'un enfant. Parmi eux, il y avait une fille. Très jeune, aux yeux sombres et éparpillé librement sur les épaules les cheveux de cette couleur châtain doré, que l'on retrouve souvent chez les femmes toscanes ordinaires. Elle s'assit, penchant la tête en arrière, regardant les nuages \u200b\u200bd'été au-dessus des toits de Florence, luisant de la pluie dans un ciel crayeux sombre, qui s'ouvrait de temps en temps, de sorte qu'il ressemblait au ciel de Masaccio sur les fresques de Carmina. À mi-chemin de la Via della Scala, près d'Orty Orisellari, nous avons entendu des coups de feu. Parti sur la place, nous nous sommes arrêtés au pied de l'escalier menant à Santa Maria Novella, derrière le dos du chef partisan qui était assis à la table de fer. Lorsque les freins de nos deux jeeps se sont mis à crier, ce chef n'a pas tiré l'oreille. Il pointa du doigt l'un des garçons: "C'est ton tour. Quel est ton nom?" "Mon tour est aujourd'hui", dit le garçon en se levant, "mais tôt ou tard, le vôtre viendra." "Quel est ton nom?" "Cela ne me concerne que", répondit le garçon. "Pourquoi parles-tu à un fou?" - a demandé à son ami assis à côté de lui. "Pour lui apprendre à se comporter", a déclaré le garçon en essuyant la sueur du dos de sa main. Il était pâle, ses lèvres tremblaient. Mais il rit hardiment, regardant le chef partisan avec un regard instable. Le patron baissa la tête et commença à dessiner avec un crayon sur la table. Les garçons ont commencé à discuter et à rire. Les paroles de San Frediano, Santa Croce et Palazzolo ont été clairement entendues dans leur discours. Le chef partisan leva les yeux: "Vivez! Ne perdez pas mon temps. C'est votre tour." "Si votre temps est si précieux," dit le garçon d'un ton moqueur, "j'arrive." Et, enjambant ses camarades, il prit sa place devant les partisans, qui, avec des fusils automatiques, se tenaient prêts au tas de cadavres, juste dans une mare de sang qui rampait le long de la plateforme de marbre. "Ecoute, ne salis pas tes chaussures!" cria l'un des camarades du garçon, et tout le monde rit. Jack et moi avons sauté de la jeep. "Attends!" cria Jack. Mais à ce moment un garçon criant "Vive Mussolini!" est tombé criblé de balles. "Merde!" cria Jack, pâle comme la mort. Le chef partisan leva les yeux et regarda Jack de la tête aux pieds. "Officier canadien?" a-t-il demandé. À son signe, des soldats canadiens ont entouré les garçons, les poussant le long des marches de l'église vers des jeeps. Avec un visage pâle, le chef partisan regarda Jack, serra les poings. Soudain, il tendit la main et attrapa Jack par le coude. "Mains!" "Non," répondit-il sans bouger. A cette époque, un moine a quitté l'église. C'était un enfant énorme - grand, solidement assemblé, rose. Il avait un balai dans les mains et il a commencé à balayer la cour, recouvert de morceaux de papier sale, de paille et de cartouches de cartouches. Quand il a vu un tas de cadavres et de sang couler le long des marches de marbre, il a arrêté de balayer, écarta les jambes et s'est exclamé: "Qu'est-ce que c'est?" Se tournant vers les partisans, qui se tenaient devant les cadavres avec des mitrailleuses suspendues sur leurs épaules dans une rangée, il a crié: "Qu'est-ce que cela signifie? Tuer des gens aux portes de mon église? Sortez d'ici, ruine!" "Facile, frère!", A déclaré le chef partisan, lâchant Jack. "Ce n'est pas le moment de plaisanter." "Ah, pas le temps de plaisanter?" Cria le moine. "Je vais vous montrer quelle heure il est!" - Et, levant le balai, il se mit à frapper le chef partisan sur la tête. Au début, calmement, avec une colère calculée, mais se mettant progressivement en colère, il pesa généreusement les coups, criant: "Venez profaner les marches de mon temple? Allez travailler, destroyers, au lieu de tuer des gens chez moi!" Et, alors que les femmes au foyer chassaient les poules, entassaient un balai sur la tête de l'officier ou sur son peuple, sautant de l'un à l'autre avec un cri: "Shu-u! Shu-u! Sortez d'ici, hooligans! Shu-u! Shu-u!" Enfin, restant le maître du champ de bataille, le moine se retourna et, lançant des surnoms insultants et des insultes aux "destroyers" et aux "loafers", commença une vengeance acharnée sur les marches sanglantes de marbre. J'en ai assez de voir des gens se faire tuer. Pendant quatre ans, je n'ai rien fait - j'ai juste regardé des gens se faire tuer. C'est une chose de regarder comment les gens meurent et une autre de regarder comment ils sont tués. Vous vous sentez du côté des tueurs - comme si vous-même en faisiez partie. J'en ai assez de ça, je ne pouvais plus. À cette époque, j'étais malade à la vue des cadavres - pas seulement par l'horreur et le dégoût, mais par la rage et la haine. J'ai commencé à détester les cadavres. Ma compassion était épuisée; c'était une façon de détester. Haine pour le cadavre! Pour apprécier tout l'abîme du désespoir dans lequel une personne peut plonger, vous devez évaluer ce que signifie haïr un cadavre. Pendant les quatre années de la guerre, je n'ai jamais tiré sur un homme, mort ou vivant. Je suis resté chrétien. Rester chrétien pendant toutes ces années signifiait trahir la cause. Être chrétien signifiait être un traître, car cette sale guerre n'était pas une guerre contre les gens, mais une guerre contre le Christ. Pendant quatre ans, j'ai vu des groupes de gens armés chasser le Christ, comme un chasseur traque le gibier. Pendant quatre ans en Pologne, en Serbie, en Ukraine, en Roumanie, en Italie et dans toute l'Europe, j'ai vu des escouades d'hommes pâles errer sans relâche dans les maisons, les bosquets, les forêts, les montagnes et les vallées, essayant de chasser le Christ et de le tuer, comme un chien fou est tué . Mais je suis resté chrétien. Quand j'ai vu le pauvre Campbell allongé sur une route poussiéreuse dans une mare de sang, j'ai réalisé ce que les morts attendaient de nous. Ils veulent quelque chose d'étranger à l'homme, quelque chose d'étranger à la vie elle-même. Deux jours plus tard, nous avons traversé le Pô et, chassant les arrière-gardes allemandes, avons atteint Milan. La guerre a pris fin, le massacre a commencé - ce massacre monstrueux d'Italiens par des Italiens - dans les maisons, dans les rues, dans les champs et les forêts. Mais c'est ce jour-là quand j'ai vu Jack mort que j'ai finalement compris ce qui se mourait autour et en moi. Mourant, Jack sourit, il me regarda. Quand la lumière a disparu de ses yeux, j'ai senti, pour la première fois de ma vie, qu'un homme était mort pour moi. Le jour de notre entrée à Milan, nous avons rejoint la foule en hurlant et en faisant rage sur la place. Me levant dans la jeep, j'ai vu Mussolini suspendu par les jambes à un crochet. Il était gonflé, blanc, énorme. Je me sentais malade dans la jeep: la guerre était finie et je n'avais plus rien à faire pour les autres, plus pour mon pays - rien, je ne pouvais que tomber malade. En quittant l'hôpital militaire américain, je suis retourné à Rome et suis resté avec mon ami, le Dr Pietro Martial, un obstétricien, sur la Via Lambro, 9. Sa maison était à la périphérie d'une nouvelle banlieue qui s'étend, négligée et froide, pour Piazza Square. C'était une petite maison, avec seulement trois chambres, et j'ai dû dormir dans le bureau, sur le canapé. Des étagères avec des livres sur la gynécologie s'étalaient le long des murs du bureau, et des instruments obstétricaux et diverses grosses pinces, ainsi que des récipients en verre avec un liquide jaunâtre, se rangeaient en rangées le long des bords des étagères. Un embryon humain flottait dans chaque vaisseau. Pendant plusieurs jours, j'ai vécu dans une société d'embryons, supprimée par l'horreur; parce que les embryons sont des cadavres, quoique issus de la race des monstres: ce sont des cadavres qui ne sont jamais nés et ne sont jamais morts. Sur la table d'à côté se tenait, comme un vase à fleurs, un grand vaisseau dans lequel le roi de cette étrange communauté naviguait, un Tricephalus effrayant mais amical, un embryon féminin à trois têtes. Ces trois têtes - petites, rondes, cireuses - me hantaient de leurs propres yeux, me souriant avec des sourires tristes et timides, pleines de modestie timide. Chaque fois que je me promenais dans la pièce, le sol en bois tremblait légèrement et les trois têtes rebondissaient de grâce inquiétante. Les embryons restants étaient plus mélancoliques, plus concentrés, plus vicieux. Une nuit, j'ai été attaquée par une forte fièvre. Il me semblait que la communauté d'embryons est sortie de leurs vaisseaux et se déplace dans la pièce, grimpant sur un bureau et des chaises, grimpant sur des rideaux et même sur mon lit. Peu à peu, ils se sont tous rassemblés par terre au milieu de la salle, assis en demi-cercle, comme les juges de la séance; ils inclinaient la tête vers la droite et vers la gauche pour murmurer quelque chose d'une oreille à l'autre, me regardant avec leurs yeux ronds de grenouille, dévisagés et invisibles. Leurs têtes chauves brillaient terriblement dans la faible lumière de la lune. L'embryon géant était toujours debout devant moi, me regardant à travers les yeux d'un chien aveugle. "Maintenant, vous voyez ce qu'ils sont vraiment", at-il dit après un long silence. "Personne n'a pitié de moi." "Dommage? Qu'avez-vous dans cette pitié?" "Ils m'ont coupé la gorge, ils ont accroché mes jambes à un crochet, ils m'ont couvert de crachats", a déclaré l'embryon d'un air étouffé. "J'étais aussi à Piazzale Loreto", ai-je répondu à voix basse. "Je vous ai vu accroché par les jambes à un crochet." "Et tu me détestes?" demanda l'embryon. "Je ne suis pas digne de haïr", ai-je répondu. "Seuls les purs ont le droit de haïr. Ce que les gens appellent la haine n'est que méchanceté. Chaque personne est essentiellement sale. L'homme est une chose terrifiante." "Moi aussi, j'étais une chose terrifiante", soupira l'embryon. "Il n'y a rien de plus dégoûtant dans le monde," dis-je, "que l'homme dans la gloire que la chair humaine régnait sur le Capitole. Tout ce que l'homme donne à l'homme est de la terre", ai-je dit. "Même l'amour et la haine, le bien et le mal "- c'est tout. La mort qu'un homme donne à un homme est aussi de la saleté." Le monstre baissa la tête et se tut. "Et le pardon?" demanda-t-elle alors. "Le pardon est aussi une sale chose." Deux embryons ressemblant à des voyous se sont approchés, et l'un d'eux, abaissant la main du monstre sur son épaule, a dit: "Allons-y." L'embryon géant a levé la tête et, en me regardant, a pleuré doucement. "Au revoir," dit-il, et, trébuchant, s'éloigna entre les deux voyous. En partant, il s'est retourné et m'a souri. Mario Corti: Des mères napolitaines vendent leurs jeunes enfants, garçons et filles, à des soldats marocains, des guérilleros réparent le massacre d'adolescentes devant une église à Florence. Tout cela se passe sous les yeux de l'armée indifférente des libérateurs. Les alliés ont libéré l'Italie du fascisme et des envahisseurs allemands. En même temps, ils se conduisent avec condescendance, voire mépris, envers les personnes qu'ils libèrent. Les exigences morales élevées que les alliés se font en tant que représentants de ce qu'ils pensent être des peuples plus civilisés ne lui sont pas présentées. Silva Sprigi, traductrice du «coup d'État technique» en anglais et citoyenne du pays des libérateurs, a un jour accusé Malaparta d'immoralité: pourquoi il a si facilement déménagé d'un camp à l'autre. Malaparte a répondu, citant le relativisme moral des Italiens. "Nous", écrivait Malaparte, "manquons d'éducation morale". On peut contester cette déclaration des damnés toscans sur l'exemple de Malaparte lui-même. Oui, il était fasciste, oui, il est devenu antifasciste. Mais il n'a jamais, même fasciste, permis les méchancetés. Marina Tsvetaeva a écrit: "Parce que nous sommes perfides, que nous sommes fidèles à nous-mêmes." Curzio Malaparte À la mémoire du colonel Henry G. Cumming, diplômé de l'Université de Virginie, et de tous les braves, bons et honnêtes soldats américains, mes amis d'armes de 1943 à 1945, morts en vain pour la liberté européenne N'adorant que les dieux et les temples des vaincus, Eschyle. Agamemnon Ce qui m’intéresse n’est pas toujours ce qui m’importe. La maison d'édition remercie Ekaterina Ulyashina, sans le soutien de laquelle cette publication n'aurait pas été possible © Eredi Curzio Malaparte, 2015 © Fedorov G., traduction, 2015 © LLC Ad Margin Press, 2015 C'étaient les jours de la «peste» à Naples. Tous les jours à cinq heures de l'après-midi, après une séance d'entraînement d'une demi-heure avec une balle de boxe et une douche chaude dans la salle de sport PBS, le colonel Jack Hamilton et moi sommes descendus dans le quartier de San Ferdinando, ouvrant nos coudes dans une foule bondée du petit matin jusqu'au couvre-feu sur Via Tolède. Propres, lavés et bien nourris, Jack et moi nous sommes retrouvés au milieu d'une terrible foule napolitaine de gens misérables, sales, affamés et en lambeaux que les soldats libérateurs de toutes les races et tribus de la terre poussaient et réprimandaient de toutes les manières possibles. Le destin a honoré le peuple napolitain de l'honneur d'être l'un des premiers à être libéré en Europe, et, pour célébrer une récompense si bien méritée, mes pauvres Napolitains, après trois ans de faim, d'épidémies et de bombardements brutaux, par amour pour la mère patrie ont pris sur eux un fardeau enviable pour remplir le rôle d'un peuple vaincu: chantez, frappez des mains, sautez de joie sur les ruines de leurs maisons, agitez des drapeaux ennemis hier et des fenêtres de douche aux couleurs des gagnants. Mais, malgré l'enthousiasme sincère universel, pas un seul Napolitain dans toute la ville ne s'est senti vaincu. Il m'est difficile d'imaginer qu'un sentiment aussi étrange puisse surgir dans l'âme de ce peuple. Sans aucun doute, l'Italie, et donc Naples, a perdu la guerre. Cependant, il est clair que la guerre est plus difficile à perdre qu'à gagner. Gagner une guerre est tout possible, mais tout le monde n'est pas capable de la perdre. Et il ne suffit pas de perdre la guerre pour avoir le droit de se sentir comme un peuple vaincu. Et dans leur sagesse ancienne, nourrie par des siècles d'expérience amère, dans leur modestie inacceptable, mes pauvres Napolitains n'ont pas du tout empiété sur le droit d'être vaincu par le peuple. C'était, bien sûr, une grande absence de tact de leur part. Mais les alliés peuvent-ils prétendre que les peuples qu'ils ont libérés sont également obligés de se sentir vaincus? À peine. Et il serait injuste de blâmer les Napolitains pour cela, d'autant plus qu'ils ne ressentent ni l'un ni l'autre. En me promenant aux côtés du colonel Hamilton, je semblais incroyablement ridicule dans mon uniforme militaire anglais. L'uniforme du Corps de libération italien est un vieil uniforme kaki anglais fourni par le commandement britannique au maréchal Badoglio, repeint, très probablement, afin de cacher les taches de sang et les trous des balles, dans une couleur lézard vert vif. L'uniforme a en effet été retiré aux soldats anglais tombés à El Alamein et Tobrouk. Sur ma tunique, il y avait trois trous de balles de mitrailleuses. Ma chemise, ma chemise et mon slip étaient tachés de sang. Mes chaussures viennent aussi d'un soldat anglais mort. En les mettant pour la première fois, j'ai senti quelque chose me poignarder le pied. Il y avait un os de mort, ai-je pensé tout de suite, mais il s'est avéré que c'était un clou. Il serait probablement préférable que ce soit vraiment un os: il serait plus facile de le retirer et il a fallu une demi-heure pour trouver des tiques et pour retirer un clou. Inutile de dire que pour nous, cette stupide guerre s'est bien terminée. Ça ne va pas mieux. Notre vanité des vaincus a été sauvée: ayant perdu notre guerre, maintenant nous avons combattu aux côtés des alliés pour gagner leur guerre avec eux, il est donc naturel de porter l'uniforme des soldats alliés, que nous avons tués. Lorsque j'ai finalement réussi à faire face au clou, l'entreprise, que je devais prendre sous commandement, avait déjà été construite dans la cour de la caserne. Un ancien monastère, détruit par le temps et les bombardements, servait de caserne aux environs de Torretta, au-delà de Mergellina. La cour, comme il sied au monastère, était entourée sur trois côtés par une galerie de colonnes maigres de tuf gris, au quatrième il y avait un haut mur jaune parsemé de taches vertes de moisissure avec d'énormes plaques de marbre, sur lesquelles de longues colonnes de noms s'étiraient sous de grandes croix noires. Autrefois, pendant l'épidémie de choléra, le monastère servait d'infirmerie et les noms des morts étaient jetés sur des assiettes. De grandes lettres noires sur le mur indiquaient: REQUIESCANT IN PACE. Le colonel Palese - un homme grand, mince et complètement aux cheveux gris - voulait me présenter à mes soldats, après avoir célébré l'une de ces simples cérémonies, qui est si chère aux anciens guerriers. Il me serra la main en silence et, avec un soupir triste, sourit. Les soldats construits au milieu de la cour (presque tous très jeunes, qui ont combattu courageusement contre les alliés en Afrique et en Sicile et c'est pourquoi ils ont été choisis pour former le noyau du Corps de libération italien) se sont tenus devant moi et m'ont regardé attentivement. Ils étaient également en uniforme et à la place des soldats anglais tombés à El Alamein et Tobruk. Ils avaient des visages pâles et émaciés et des yeux blanchâtres, gelés et ternes, comme s'ils étaient constitués d'un matériau doux et opaque. Ils me regardèrent à bout portant, semblait-il, sans cligner des yeux. Le colonel Palese a fait signe, le sergent a crié: - R-r-rota, paix-rrrna! Le regard du soldat au poids douloureux était fixé sur moi, comme le regard d'un chat mort. Les corps étaient engourdis et étendus sur commande «tranquillement». Des mains pâles et exsangues agrippaient une arme, une peau molle pendait du bout de ses doigts, comme des gants trop grands. Le colonel Palese a commencé: "Je vous présente votre nouveau capitaine ..." Et pendant qu'il parlait, j'ai regardé les soldats italiens sous la forme retirée des Anglais morts, leurs mains exsangues, leurs lèvres pâles et leurs yeux blanchâtres. Il y avait des taches noires de sang sur leurs vestes et pantalons. Je me suis soudainement pris dans la terrible pensée que les soldats étaient morts. Ils dégageaient une odeur de moisi de tissu moisi, de peau pourrie et de chair séchée au soleil. J'ai regardé le colonel Palese - il est également mort. Une voix froide sortit de sa bouche, humide et moite, comme des sanglots terribles qui jaillirent de la bouche d'un mort si vous posez une main sur son ventre. «Commandez-le librement», a déclaré le colonel Palese au sergent à la fin de son court discours. - Rota, gratuit! Cria le sergent. Les soldats ont détendu leur jambe gauche, prenant une pose lente, et ont continué à me regarder avec des yeux encore plus loin et encore plus instables. Page actuelle: 1 (le total du livre compte 21 pages) [passage disponible pour la lecture: 12 pages] Curzio Malaparte |
| Lire: |
|---|
Populaire:
Traitements herbicides
|
Nouveau
- Comment tuer les punaises de lit, ainsi que leurs œufs Comment tuer les punaises de lit à la maison
- Comment se débarrasser des boucliers en bois?
- Description des cloportes - ce qu'ils mangent, ce qui est dangereux, comment ils se reproduisent et combien ils vivent La structure des cloportes
- Des moyens efficaces pour faire face à la poussière dans la maison
- Comment se débarrasser définitivement des poux à la maison - rapidement et facilement
- Comment déterminer extérieurement qui a mordu et que faire? Y a-t-il un avantage à une piqûre de guêpe?
- Les premières manifestations de piqûres d'insectes
- Reproduction et cycle de vie des cafards domestiques
- Comment se débarrasser définitivement des insectes dans l'appartement
- Les puces dans la maison: d'où viennent-elles et comment y faire face?
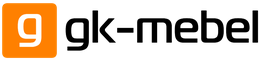
 Titre: Skin
Titre: Skin 



